Véronique Bergen, Écume, Onlit-Éditions / Équateurs Roman, 2023.

« Quel genre de lecteur êtes-vous ? Du type cétacé ou du type pinnipède ? […] Avez-vous peur des marées ? Peur de vous-mêmes ? Si la réponse est “oui”, abordez le texte à tribord. Si la réponse est “non”, partez à la recherche des chapitres écrits à l’encre de seiche. » Entrez dans ce texte par bâbord ou par tribord, mais comme on monte à l’abordage ; plongez-y avec ivresse ou angoisse, mais sans tâter du bout de l’orteil la température de l’eau ; noyez-vous dans les quelque quatre cents pages sans tenter de surfer sur leur vague. Mais allez-y, bon Dieu, allez-y ! Vous ne rencontrerez pas deux livres de cette puissance dans la bouillabaisse invertébrée que chaque rentrée littéraire régurgite sur les étals des marchands de pommade à se récurer le nombril. Noyez-vous, oui, qu’importe ? Un peu plus tôt, un peu plus tard, de toute façon, « d’ici une dizaine d’années, l’humanité sera rayée de la Terre ».
C’est de cela qu’il est question, sans doute, et de mille autres choses, dans un bouillon qui de tout fait plancton, dans une « Ode à l’océan, aux êtres qui le peuplent », une « anti-odyssée » qui nous évoque Joyce tout autant d’Homère. Bien sûr, il y a des sillages, des trajets qui se croisent et que l’on suit, comme dans un roman. Trois itinéraires complémentaires, si l’on tente de structurer cette épopée au verbe puissant et aux figures titanesques : celui de la migration des baleines ; celui d’Ismaël et de son bateau, la Mirabelle, sur les traces de Moby Dick pour un rendez-vous annuel auquel elle se dérobe pour la première fois depuis vingt ans ; celui d’Anaïs, prostituée qu’il a embarquée à Amsterdam et qui le quitte régulièrement pour retrouver sa compagne Natalie, ou d’autres escort-girls d’« industriels au nombril côté en Bourse », dans tous les bordels de luxe du Brésil à la Thaïlande. Herman Melville, avec son capitaine Achab poursuivant Moby Dick sous l’œil du narrateur Ismaël, sert bien entendu le point de fuite qui ordonne le roman.
Trois quêtes, trois fuites. Ismaël porte le nom du héros de Melville, mais surtout du premier fils d’Abraham, chassé dans le désert. Il fuit le monde des hommes, d’Achab l’exterminateur de baleines, de Yahvé le législateur, de tous ceux qui détruisent les océans, la Nature, la vie animale, y compris l’humanité. Son but n’est pas seulement la rencontre avec Moby Dick, c’est une quête de paradis perdu, d’innocence originelle, qu’il poursuit avec la baleine, « la déesse des mers, de l’immémorial, de l’harmonie édénique », espérant retrouver « les années durant lesquelles le cachalot sillonnait les mers avec insouciance ». Une quête impossible, mais dont l’aboutissement surprendra le lecteur.
En fuite, Anaïs, bien sûr, de celui qu’on surnomme l’Achab II. En fuite d’un prédateur d’un autre genre, le « play-boy de Maman » qui, comme le chasseur de baleines, lance des « regards harpons ». Et qui finit par violer la fillette en se moquant de la chute de ses dents de lait. En fuite du souvenir, des « nappes d’enfance qui trouent [son] présent », mais en fuite aussi du personnage grandi, vieilli, qu’elle ne reconnaîtrait peut-être pas s’il se présentait comme un client. En fuite ? Ou en quête ? La nuance ne se fait pas vraiment dans son esprit, mais si quête il y a, quelle en est la motivation ? Dans le maelström des haines et des fantasmes, il ne faut pas tenter de rationaliser les comportements. Quant à l’aboutissement, il laissera, fort heureusement, le lecteur dans le doute.
Et Moby Dick ? En fuite, bien sûr, devant l’extension industrielle de la chasse aux baleines. Chaque année elle s’adapte à des profondeurs plus grandes, inaccessibles, à moins qu’elle n’ait succombé au vertige suicidaire des cétacés auxquels aucune autre voie de sortie n’est laissée. Mais dans la grandiose scène finale, on comprend que cette fuite est aussi une sorte de quête.
Ne cherchons donc pas à comprendre. Ne partageons pas cette « fatuité des humains de penser comprendre ceux que nous exterminons depuis l’aube de l’univers… ». L’auteur nous met en garde : « certains d’entre vous échafauderont hypothèses à la chantilly et cartographies zodiacales à l’huile de baleine. » Gardons-nous-en ! C’est le piège dans lequel est tombé Ismaël (« Très jeune, le démon de la comparaison, ou plutôt de l’analyse, me visita ») et dont le guérit Anaïs. Peut-être est-ce ce démon qui a mis en fuite la baleine, et son exorcisme qui a permis la rencontre finale, quasi mystique. Car il nous faut pénétrer dans la pensée symbolique pour comprendre Moby Dick. La baleine blanche devient l’icône du matriarcat, elle incarne les dieux primitifs, les forces anarchiques originelles, « que Yahvé doit balayer pour établir son règne de la Loi ». Sa fuite s’inscrit dans la désertion de la blancheur sur une Terre souillée, elle répond à la disparition des neiges l’on croyait éternelles, à la fonte de la banquise, à la mort des tigres blancs et des ours polaires. Elle prend une dimension cosmique de déesse vengeresse. « Moby Dick, c’est le chant de la mer qui n’en peut plus, qui demande à la baleine de lui venir en aide, de la protéger des actions humaines, de couler baleinières, chalutiers, plateformes de pétroles, piliers de forages, sous-marins, de saccager les câbles, les mines, les sonars. »
Ce « roman vortex » n’est pas un essai, ni un pamphlet, peut-être un cri de rage, pas même désespéré, dans un fatalisme au-delà du désespoir. Il est trop tard, le naufrage a eu lieu, on ne peut qu’en contempler les débris éparpillés sur la mer en attendant qu’elle les engloutisse. Mais dans cette contemplation se dessine un autre univers, avec une autre logique, de l’ordre du symbolique plutôt que du rationnel. À force de scruter les « déchirures de l’océan » et les « fissures d’Anaïs », Ismaël se demande s’il n’y a pas des correspondances secrètes entre les migrations « sexotoniques » de la jeune fille et celles du cétacé. Après avoir lentement et systématiquement déréglé tous ses sens, peut-être a-t-elle acquis des capacités sensorielles inouïes. Elle voit par les pores de sa peau, traduit les sons des cétacés en images — nous introduit dans une autre vision du monde, une autre version de sa grande épopée. Peut-être est-ce le message optimiste de ce roman. Plutôt que de rabâcher une apocalypse inéluctable, peut-être faut-il se rappeler que le terme signifie d’abord « révélation ». Peut-être faut-il sortir du cadre, comme dans l’énigme des neuf points, pour pénétrer les enjeux réels du livre que l’on tient en main, ou du monde qui tourne nos pages, car c’est la même chose.
Et tout, dans ce livre, brise les cadres de la littérature, des conventions romanesques comme de l’écriture et de la langue. Dans une juxtaposition de narrations, de poèmes, de correspondances, de proférations, d’envolées lyriques ou épiques, tous les sujets d’actualité sont abordés, dans ce qui pourrait passer à première (et simpliste) vue comme un pamphlet du monde actuel. L’écologie et la cause animale, bien sûr, à travers Ismaël ; les violences envers les femmes, la pédophilie, le sado-masochisme, sans doute, à travers Anaïs ; mais aussi le problème des migrants, à travers Moby Dick, si l’on se souvient de Jonas réfugié dans le ventre de la baleine : a-t-elle ouvert son corps aux naufragés des boat-people ? En passant par la 5G, les pollutions sonores, lumineuses, l’explosion démographique, le terrorisme écologique — « Quand des Mesrine de l’écologie se lèveront-ils, balayant les écocidaires ? » De subites et érudites digressions ressuscitent les animaux massacrés, listant les espèces disparues ou rappelant de tristes records, comme celui de la palourde Ming, doyenne du monde animal, âgée de 507 ans lorsque des chercheurs l’ont tuée « par mégarde » en tentant de définir son âge.
Oui, c’est tout cela, ce livre, dans une énumération accablante, et des débordements de juste colère. Mais c’est aussi un roman, avec ses nuances, sa volonté de comprendre, d’entrer dans la psychologie des plus ignobles personnages. « Se vouloir l’anti-Achab, c’est avoir de l’Achab en soi » : le rôle du romancier est aussi de réveiller en lui le germe du prédateur, de lui donner la parole, ce qui ne suppose ni excuse ni justification. Profondément féministe, le roman peut aussi s’emporter contre les « #metooien.nes, désolée pour l’écriture inclusive, laquelle ne brille pas par sa beauté et son intelligence mais ces deux qualités sont de nos jours mises au ban de la société ». Solidaire des femmes maltraitées, violées, prostituées, il peut aussi fustiger le reflux puritain, « la fuck fashion d’un érotisme aseptisé, la fadeur d’un sexe inclusif ». Imprégné de toutes les rages et de toutes les révoltes, il peut railler les « générations gnangnans » qui « ânonnent le catéchisme de luttes intersectionnelles ». En totale empathie avec les multiples facettes de l’identité sexuelle, il peut aussi mettre en garde contre l’idéologie ultra-libérale qui récupère les revendications des trans pour tester sur eux « le devenir mutant de l’homo sapiens ». Il y a de tout cela, car il ne faut pas demander à tous les personnages croisés dans ces pages d’être les porte-parole de la même idéologie. Ils se contredisent, ne sont pas sûrs eux-mêmes de leurs convictions, de leurs désirs, se cherchent et se combattent. Même les deux Achab ont droit à la parole.
Et parmi ces mondes qui s’entrechoquent et qui font la force de ce roman total, il y a les plaques tectoniques des niveaux de langue et de culture. Incollable sur le monde des ladyboy, des tomboys, des katoï, sur toutes les nuances de la transidentité, Véronique Bergen l’est tout autant sur toutes les strates de la culture classique et moderne. « La littérature me perdra », constate Anaïs avec peut-être un clin d’œil à sa romancière. Il faut dire qu’elle glisse dans les lettres à ses amantes des vers de Michaux, d’Adonis, de Tsévaïeva, sans oublier Hélène Cixous à laquelle Véronique Bergen a consacré un remarquable essai… Alors, oui, la mythologie, l’histoire, la littérature font une virée dans tous les bordels où Anaïs exerce ses talents. Avec un humour de situation dont les éclats tiennent de la grenade. « Nue, tenue en laisse, au sol, je lis Spinoza tandis que Jaran me décortique le mode de pensée thaï. »
De l’humour, il n’en manque pas dans cette épopée de rage et de révolte. Comment résister au strip-tease qu’entreprend Anaïs pour Napoléon à l’approche de Sainte-Hélène : « Ça me démange de ne pas savoir si un spectre a une bonne vue », explique-t-elle, s’attirant cette réplique d’Ismaël : « Si tu te beauharnaises, il ne nous lâchera plus jamais. » Dans une tempête hurlante, les paroles n’arrivent que par bribes, mais peut-on se demander si Anaïs crie « cet océan sera notre tombeau » ou… « ce cormoran a conchié mon paréo » ? La leçon, c’est qu’en ces circonstances, une envolée hugolienne est tout aussi déplacée qu’une éructation scatologique. Leçon de l’humour, aussi, dans ce souvenir d’enfance d’Anaïs qui glisse une photo de sa maîtresse dans la cage dont elle vient de délivrer un hamster, avec ce mot « Bienvenue en captivité, mademoiselle Poquelin. »
Un roman total, incontournable, qu’il serait criminel de quitter sans dire un mot de l’écriture, qui s’affirme avec une vigueur croissante de livre en livre de l’autrice. Une écriture qui, elle aussi, sort du cadre, mais pour assumer toutes les richesses lexicographiques, syntaxiques, morphologiques de la langue française. Cette écriture totale et apparemment déstructurée est dans la logique du roman total. Il faut brutaliser la syntaxe « comme la vie nous brutalise », et tant pis pour les bonnes âmes qui s’en offusqueraient. « Les phrases avec tutu que tu me souffles, je vais les punching-baller strip-tease musclé. »
Mais pourquoi s’en formaliser ? Académicienne, Véronique Bergen maîtrise parfaitement la langue française et ne fait qu’en exploiter les richesses, poussant à l’extrême ses possibilités comme ses exceptions. On sait que les frontières entre les catégories grammaticales n’ont pas toujours un contour défini. Véronique Bergen plante résolument ses camps dans ces no man’s lands. Ses mots sont à l’image des protagonistes transgenres. Ils ne veulent pas décider entre le verbe et le substantif : « je libère des cruautés qui la nirvana », « chewing-gume le président coiffé d’une banane jaune fluo » (toute ressemblance avec une autre banane serait bien sûr fortuite)… Les patronymes eux-mêmes sont de la partie, avec une audace jouissive : « j’ulysse dans leurs chevaux de Troie, surtout quand ils s’échinent à pénéloper la tapisserie de guingois ». Même no man’s land entre le substantif et l’adverbe : « pour l’écarteler crucifixion ».
L’attribut, qui copule traditionnellement avec son sujet (ou un complément) par l’intermédiaire d’un verbe d’état, peut très bien s’accommoder d’un verbe d’action — l’exemple classique est « tomber mort ». Le cas est relativement rare. Il devient presque ici la règle : Anaïs « gémit koala avant de se trémousser liane » quand elle n’ondule pas pony-girl. On se dissout flocon d’avoine ou on gicle roches éruptives !
Mais, insistons sur ce point, rien de gratuit dans cette langue. L’explosion verbale est en rapport strict avec le bouleversement du monde ; l’incertitude morphologique épouse celle des genres. Et un sens bien plus précis que le pauvre lexique humain ne peut en fournir jaillit soudain d’une rencontre inattendue. « Il m’embrouille » ne suffit plus lorsqu’on change de logique : en fait, « il m’omelette mes idées claires ». Le moindre signe prend sens, tel le tréma sur les prénoms d’Ismaël et d’Anaïs, qui symbolise le lien essentiel qui les unit, mais aussi l’impossible fusion, puisqu’il sanctionne l’hiatus, au point d’être déclaré « bisexuel » !
Et cette richesse linguistique n’est possible que dans une langue où les mots s’incarnent, se matérialisent, où l’on peut trouver « trois adverbes dans la culasse d’un fusil ». Si les verbes sont édentés, les substantifs enchaînés, il peut suffire de les intervertir pour les libérer. Quant au lexique, il faut parfois ouvrir les jambes du dictionnaire. Cela vaut bien le bonnet rouge du père Victor…
Retour au sommaire
Voir aussi : Icône H. Clandestine. Moctezuma.
Laurent Binet, Perspective(s), Grasset, 2023.
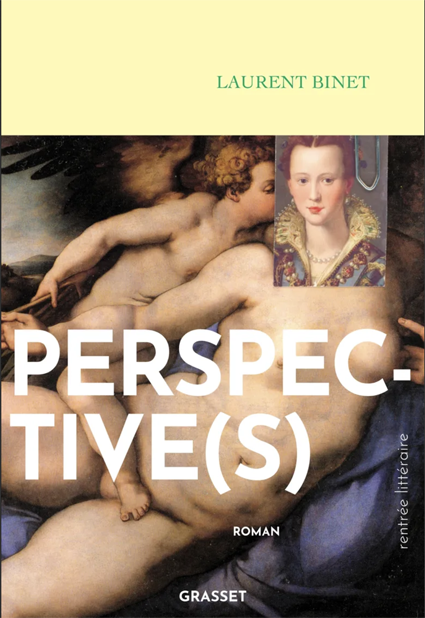
Cela s’annonce comme un roman historique, avec deux cartes et un index biographique des principaux personnages. Rassurez-vous, on peut très bien passer ces pages et lire ce roman… comme un roman. Cela se poursuit comme un de ces thrillers en costume à la mode, qui utilisent le cadre historique comme écrin à une énigme policière. Rassurez-vous, c’est bien plus que cela. Cela prend la forme d’une correspondance fictive aux protagonistes célèbres (Catherine de Médicis, Michel-Ange, Cellini…) ou obscurs (sœur Plautilla, Marco Moro…). Rassurez-vous, ces lettres croisées se suivent avec une stupéfiante limpidité.
Alors, oui, il y a un meurtre, celui du peintre Jacopo da Pontermo, tandis qu’il travaille aux fresques de la chapelle des Médicis, San Lorenzo, à Florence. Pas de quoi émouvoir ses commanditaires, même si l’iconographie de ces fresques se révèle audacieuse, presque hérétique, en tout cas scandaleuse, à une époque où la Contre-Réforme songe à « rebraguetter » son confrère Michel-Ange. Mais pourquoi une partie apparemment insignifiante de la fresque a-t-elle été retravaillée ? Et surtout, le maître défunt laisse aussi une impudique Vénus nue, aux cuisses ouvertes, à laquelle il a donné les traits de la fille aînée du duc. Et là, la bataille diplomatique pour la possession de ce tableau devient féroce.
Toutes ces énigmes vont mobiliser les cercles politiques (jusqu’à Catherine de Médicis, devenue reine de France), religieux (dans les émois de deux dominicaines à l’exaltation parfois déroutante et ma foi fort plaisante), artistiques (l’enquête brouillonne de Vasari guidé par son maître Michel Ange, ou les fourberies de Cellini, aussi fringant aventurier qu’habile graveur), et même corporatistes, car un grand mouvement de protestation germe alors parmi les aides des peintres et les préparateurs de couleurs. Un mouvement presque syndical, puisqu’il entend créer une organisation transversale et non plus verticale pour défendre de nouveaux droits… dont un salaire minimum.
L’intrication de toutes ces thématiques, la succession des rebondissements croisés, l’ingéniosité de l’intrigue policière et des démêlés diplomatiques suscitent en permanence la curiosité du lecteur. On s’amuse tout autant des clins d’œil à la société actuelle, au « fanatisme borné » (en l’occurrence du Concile de Trente), aux revendications sociales ou féministes (« Dieu n’a-t-il pas fait les hommes libres ? Et les femmes ne sont-elles pas, elles aussi, créatures de Dieu ? »). Mais c’est surtout la réflexion sur l’art, portée par les plus grands noms de leur époque, qui donne son épaisseur au roman. Chacun avec son caractère et son rôle dans l’intrigue. Bronzino, chargé d’achever les fresques de son maître assassiné, se sent « comme Eurydice qui marche derrière Orphée ». Vasari, pris dans une escarmouche, a soudain la révélation de la perspective en tendant son arbalète. Et Michel-Ange, pris dans les menaces pesant sur ses fresques de la Sixtine, a une vision quasi mystique du rôle de l’artiste, « fenêtre de Dieu » sur terre. « C’est la perspective qui permet de voir l’infini, de le comprendre, de le sentir. La profondeur sur un plan coupant perpendiculairement l’axe du cône visuel, c’est l’infini qu’on peut toucher du doigt. » Moins éblouissant, moins virtuose peut-être que Civilizations, ce roman est sans doute plus profond et confirme la maîtrise de Laurent Binet à concevoir des intrigues complexes, originales, sans jamais y perdre son lecteur.
Voir aussi : Civilizations.
Retour au sommaire
Myriam Leroy, Le Mystère de la femme sans tête, Seuil, 2023
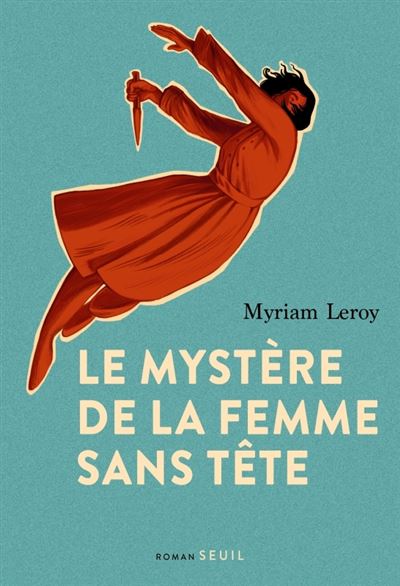
Au cimetière d’Ixelles est enterrée une femme décapitée à la hache en 1942. La découverte de sa tombe éveille la curiosité, puis l’intérêt de l’autrice, qui fut journaliste pendant quinze ans et qui s’interpelle ici à la deuxième personne du singulier. Elle ne savait pas que l’on décapitait pendant la guerre. « Mais au fond, que sais-tu de la guerre ? » L’enquête s’impose. La femme porte un nom russe, Marina Chafroff-Maroutaëff. Elle a poignardé un fonctionnaire allemand. Devant les menaces de représailles, elle est allée se dénoncer.
Le roman conjugue adroitement les faits historiques retrouvés au cours de l’enquête, les anecdotes inventées pour donner chair aux personnages, les réflexions que suscite l’aventure chez l’autrice actuelle, le récit à la deuxième personne de ses recherches… Marina est née en Lettonie en 1908. Une injustice subie dans son enfance forge sa sensibilité et sa conscience sociale. À Bruxelles, elle rencontre Youri, Russe immigré, jeune boxeur et ouvrier portant la honte d’un père officier tsariste : elle fonde avec lui une famille, avant de se rendre compte qu’elle a épousé « un drôle de coco », qui oscille entre l’adolescent attardé et le flibustier. Une partie du roman est consacrée au tableau de ce milieu familial, entre mari et enfant, mère et belle-mère. C’est la partie la plus romanesque de l’histoire. Les relations entre Ludmilla (la mère) et Marie (la belle-mère), l’une pianiste de salon, l’autre cantatrice de concert, l’une bourgeoisement distinguée, l’autre « jouisseuse et chipie », ne manquent pas de piquant.
À cette histoire se superpose une analyse du nazisme et de la résistance, très juste et nuancée mais un peu en décalage avec le récit. Marina, avec le souvenir de l’injustice subie dans sa jeunesse, ne peut supporter le sort réservé aux juifs, même si cela ne la touche pas directement. Le refus de s’accommoder de la situation devient pour elle un élan vital. Elle nourrit sa colère en écoutant la radio russe, commence par de petits actes de résistance, de petites insubordinations dérisoires, indiquer un faux chemin à un Allemand, dévisser les noms des rues… Mais à force de dessiner des V sur les murs, on finit par planter un couteau dans le dos d’un Allemand…
À côté d’elle, les réactions sont diverses et en fin de compte peu idéologiques. Certains s’habituent aux discours d’Hitler comme des grenouilles placée dans l’eau froide s’accoutument peu à peu à la chaleur jusqu’à se retrouver « cuites » sans s’en rendre compte. De « petites dames » ne connaissaient l’actualité que par les propos de leur mari ; des « intellectuels de cafés » tranchent sans savoir ; le bourgmestre pense à son bilan et à son image dans l’Histoire. Quant à Youri, il opère une synthèse personnelle de tout ce qui se passe autour de lui : « dédaigneux des femmes, méfiant envers les Juifs, hostile aux Allemands et à toute forme d’autorité ».
Parallèlement à l’histoire de Marina et à l’analyse de la résistance à l’occupation se profile l’histoire de la journaliste qui enquête et qui s’investit dans son récit. Ce sont d’abord de petites coïncidences. Youri lui évoque Antonio, un ancien ami, mais aussi Nicolas, « un garçon russe d’une beauté douloureuse », qu’elle a connu près de Morsaint où, justement, déménage la famille de Marina. « Vous avez cette géographie commune avec Marina, sur laquelle tu peux superposer vos silhouettes. » Parallélisme de circonstance également : l’enquête commence durant le confinement, lorsque les cafés sont fermés et les réunions surveillées par la police, ce qui ne manque pas d’évoquer les représailles des Allemands à la mort d’un des leurs.
Peu à peu, ce parallélisme devient obsessionnel. L’enquêtrice ressent le besoin « d’une Marina intérieure », qui lui communique sa colère. Elle sent que son écriture lui est comme dictée par son sujet : « tu sens que ce que tu écris, quelque part d’en haut, on te le souffle ». Et pour comprendre son personnage, elle sonde son propre ressenti. « Ici, il manque probablement quelque chose. Le déclic. L’instant où ton héroïne s’embrase. » Il faut une scène « à la fois anodine et cruelle », et ressuscite en elle le souvenir d’une humiliation subie dix ans plus tôt. Elle investit son héroïne — « Tu lui prêtes tes affects » — sans se soucier de la critique « anti-woke ». Cette expérience, au fond commune à tous les romanciers et analysée avec intelligence, doit ici être assumée par une autrice qui a encore un pied dans le journalisme. Elle garde les scrupules de l’enquêtrice : « Tu sais qu’il faut se garder de juger hier avec les lunettes d’aujourd’hui » ; elle connaît même un moment d’abattement, « tu te dis que jamais tu ne sauras qui était Marina et que ton roman n’est qu’une histoire, rien qu’une histoire, aussi partisane, idiote ou distraite que les autres ».
Mais une idée la rassure : en tant que femme, elle peut mieux comprendre une femme. « Tu ne te préoccupes pas de ceux qui vont taxer ce parallèle d’obscénité, parce que s’il y a une chose dont tu ne doutes plus, c’est qu’il existe un lien d’humiliation unissant toutes les femmes, comme un cordon, qui se déploie de cou en cou à travers les âges. Une communauté secrète dont les archives, qu’on s’emploie à détruire, dégoulinent de pisse, de bave et de sperme. Tu ne sais plus où tu as lu que le point commun entre les femmes, le seul peut-être, c’est qu’on les traite comme des femmes. Tu ne saurais mieux dire. » et cette conviction oriente la lecture du passé. Pourquoi la mémoire de son héroïne a-t-elle été occultée alors que tant d’hommes, du modeste curé courageux au petit aviateur évadé, ont droit à la mémoire collective ? « C’est cette anomalie qui a attiré ton attention. Une femme, ici. Une femme, toute seule. » La mère de Marina n’imagine-t-elle pas que sa fille s’est accusée pour sauver son voyou de mari ? « Elle présumait que c’était son gendre le terroriste car c’était bien son genre à ce communiste, d’aller blesser un inconnu comme ça dans la rue et de s’enfuir sans assumer. » D’ailleurs, une femme n’a-t-elle pas pour unique mission de « s’esclavager avec joie dans sa cuisine et dans son lit » ? On peut penser que le titre du roman fait allusion à la vieille plaisanterie sur la femme sans tête, où « tout est bon ».
L’analyse n’est pas inintéressante, loin de là, mais, en souscrivant, volontairement ou inconsciemment, à un des plus vicieux présupposés des genders studies, selon lequel seule une femme peut comprendre ce qu’a ressenti une autre femme, Myriam Leroy aboutit à un paradoxe dont elle ne parvient pas à s’échapper. Consciente que l’imagination finit par gauchir la vérité, elle rencontre les descendants survivants de Marina, qui lui racontent une tout autre histoire. « Tu avales de travers. Tu ne sais pas quoi dire. Tu ne t’attendais pas à une histoire familiale aussi triste. Tu ne pensais pas remuer de la boue, tu imaginais juste donner vie à quelques visages figés sur des photos. » Ici encore, un raisonnement exact, mais captieux, lui permet de s’en sortir. L’un d’eux assure que sa mère est née à Saint-Pétersbourg, quand des documents indéniables parlent de Lettonie. C’est bien la preuve qu’on ne peut se fier à des témoignages directs mais imprécis. Cela lui donne le meilleur prétexte pour assumer sa subjectivité — « tu prends la liberté de trancher, à partir de ce que tu crois » — et en particulier de refuser toute image qui ne correspond pas à sa vérité — « Ce genre de texte, tu n’en as pas envie ». Jusqu’à l’aveu ultime : « Toi [tu] écris pour ça, aussi, pour être entendue mais pas seulement : pour savoir qui tu fus. » En fin de compte, la journaliste assume son statut de romancière, mais le roman tout entier, pris dans les sursauts de ses scrupules, en devient un peu trop démonstratif pour convaincre.
Reste l’écriture. Myriam Leroy a parfois du mal à trancher, ici aussi, entre l’envolée romanesque et la précision journalistique. Il y a de superbes formules (« des yeux qui te voient là où tu ne veux pas être vue »), une grande sensibilité, notamment, pour exprimer le désir d’une femme pour un homme ou la découverte de la nudité conjugale. Une très belle analyse de l’angoisse montante et peu à peu obsessionnelle jusqu’à la dépression, comparée à un aigle qui « s’invitait au-dessus de la tête de la jeune mère, déployant son ombre et des serres qui venaient la chatouiller. » Mais cela peut tourner au maniérisme, notamment dans la prédilection pour les moments de rupture, subits et violents. L’aigle planant au-dessus de sa tête tout à coup « fond sur elle » jusqu’à ce qu’elle se retrouve « recroquevillée sur le carrelage de la cuisine ». Soit. L’image est jolie. Mais on se rappelle que le mot « décapitée », au début du roman, a « claqué au visage comme une rafale de mitrailleuse », que le même mot « chute sur l’estomac comme un petit cadavre », que la peur tombe dessus « comme un piano d’un étage », que l’on tombe amoureux « comme on marche sur un râteau, un coup de manche au milieu du front »… Dans la construction comme dans l’écriture, on ne peut s’empêcher de trouver que l’autrice en fait un peu trop pour convaincre ou toucher son lecteur.
Retour au sommaire
Georges-Olivier Châteaureynaud, Ici-bas, Grasset, 2023
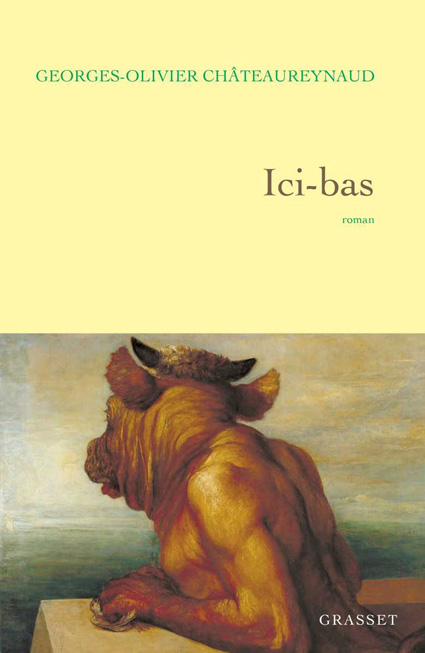
Bienvenue à Écorcheville-sur-Styx, pour notre troisième et, hélas, dernier voyage dans ce monde castelrénaldien. Dans la petite ville qui « n’appartient pas à part entière à la géographie », nous retrouverons les trois familles dominantes qui se partagent le pouvoir et la richesse, les Bussetin, les Estéral, les Propinquor, ou plus exactement leurs enfants et petits-enfants, plus ou moins mâtinés de créatures fantastiques venues de « L’autre rive », au rythme des viols ou dévergondages. Le roman tourne d’ailleurs autour du bal organisé pour les vingt ans d’Angelina, qui lime soigneusement ses cornes et dissimule ses pieds de chèvre dans des bottines orthopédiques. Nous sommes vingt ans après l’incendie du château de Thétis d’Épervay qui clôturait le deuxième tome, À cause de l'éternité. Il y a quelques morts et disparus, sans doute (ce qui nous permet d’élaguer un peu l’index des quelque 70 personnages de la saga !), mais à côté des descendants, nous retrouvons quelques-uns de nos héros vieillissants, convertis à la bigoterie, comme Bételgeuse, ou un peu pitoyables, comme sa jumelle Alcyone, restée splendide dévergondée, mais surnommée « Mammy Cougar » ou « pécheresse hype ».
Nous y retrouverons donc l’atmosphère devenue familière de ce monde si semblable au nôtre, situé en France, mais sur la rive du Styx. Mais le romancier est de plus en plus attentif aux petits détails qui pimentent notre actualité : il y a des rodéos urbains, des concours de sirènes entre ambulances, police et pompiers, des androgynes auquel ne correspond que le pronom dit inclusif « iel ». Bienvenue dans notre monde, donc, avec ce léger décalage qui permet tantôt l’humour, tantôt la réflexion, tantôt la poésie.
Et surtout, bienvenue dans la parodie grandiose d’un roman apocalyptique à la mode. Car cette fois, ce n’est plus un château qui est menacé par l’incendie, c’est l’ensemble de la ville, et peut-être de l’humanité, qui risque d’être victime d’un authentique Déluge. Joyeux prétexte pour étudier les réactions des personnages à ce dérèglement climatique qui nous renvoie à notre propre actualité : agacement, angoisse, « frénésie de vivre », climatoscepticisme (« On n’allait pas se laisser embêter par un bête Déluge »), récupération religieuse ou administrative… Pour l’évêque, le Déluge devient le symbole « d’un débordement mental, d’une catastrophe spirituelle », mais il n’est pas loin de l’interprétation qu’en donne un haut-commissaire venu de Paris : « Si j’étais poète, je dirais que c’est en nous, en nous tous, que le Styx coule et qu’il déborde aujourd’hui ! ». Quant au romancier, il nous laisse entendre que cette « crue de l’arrière-monde » pourrait bien symboliser l’étrange rapport que nous entretenons aujourd’hui avec l’imaginaire. Fantastique et science-fiction n’ont jamais autant séduit, mais l’hyperréalisme leur fait contrepoids, tandis que l’imaginaire, le symbolique, le métaphorique, qui jettent des ponts entre les deux répertoires, semblent engloutis dans ce double déluge.
La question sociale n’est pas éludée. Certes, les crues et inondations nous sont hélas familières, mais les débordements du Styx sont bien plus effrayants que ceux d’un torrent des Pyrénées. La puanteur qui s’en dégage, comme si la ville « dégorgeait le contenu de ses entrailles », ajoute à la confusion et annonce l’encombrement des morts devant la barque de Charon. Comme dans un film catastrophe, tout finit par un cataclysme et une évacuation de la ville dans l’organisation la plus stricte mais le plus grand désordre.
Bien sûr, ces catastrophes (sur)naturelles provoquent des vagues d’immigration. Comme dans les précédents tomes de la saga, des personnages étranges continuent à débarquer « de l’autre rive ». Petite différence cependant : il s’agit de plus en plus de personnages vivants, qui ne dissimulent plus leurs attributs mythologiques. « Aujourd’hui c’est différent, ce ne sont plus des naufragés, ni des charognes poussées jusqu’ici par vents et courants. [Les créatures] apparaissent un beau jour amènes et fringantes, sans s’être en aucune manière annoncées, et elles s’installent parmi nous. » Les trois Moires ont ainsi fondé une maison de haute couture où Atropos peut sans inquiéter jouer du ciseau ; Janus Bifrons dirige une clinique psychiatrique sans voiler ses deux visages, et le Minotaure qui devait se cacher dans un labyrinthe souterrain dans le précédent opus ne choque ni n’effraie plus grand monde. Venu d’un autre univers, aussi, mais sur la même rive, un haut-commissaire dépêché de la capitale pour prendre des mesures face au Déluge, au nom emblématique d’Ivredeau…
Mais les jeunes ne pensent plus comme les vieux. L’acceptation de la différence correspond à la sensibilité actuelle où la normalité devient hors norme. Cela a ses bons côtés, notamment dans le regard sur cette nouvelle forme d’émigration. Le clin d’œil à notre société est clair et se teinte d’humour lorsqu’on se rend compte que les sans-papiers sont des divinités antiques ! Certains « ont bénéficié d’une naturalisation ». Bien sûr, d’autres, comme les harpyes, ne peuvent se fondre dans la masse. Elles restent effrayantes, sauvages et sanguinaires, on n’ose parler de terrorisme ou de délinquance des banlieues... Faut-il pour autant les abattre comme des animaux, malgré leurs touchantes figures de jeunes filles marquées des stigmates de la vieillesse ? Certes, elles sont cauchemardesques : mais « c’est précisément ce cauchemar que je veux préserver, pour la raison qu’il a longtemps hanté les nuits de l’humanité, et qu’il les hante encore sous d’autres dehors, sous tant de variantes… » Le roman est profondément humaniste et, discrètement, nous invite à réfléchir à la violence qui constitue aussi notre part d’humanité et que l’on pourrait comprendre chez l’autre.
Le religieux prend aussi plus de place dans ce roman, en la personne de Monseigneur Propinquor, bien embarrassé lorsqu’il doit s’asseoir dans la barque de Charon comme si le paradis chrétien n’existait pas... Le catholicisme dévot s’incarne soudain dans l’arrivée d’un ange, un poupon désarmé avec d’authentiques petites ailes qui passe son temps à dormir en suçant son pouce, quand il n’urine pas sur la robe de chambre de Monsignor Propinquor. Curieusement, personne ne se demande s’il ne s’agit pas du petit Éros. Son apparition répond tellement aux rêves de salut d’une religion déboussolée : « enfin un prodige chrétien, après tant de prodiges païens ! »
Cette sensibilité moderne, cette tolérance qui n’empêche pas certaines formes de violence ou de fanatisme, est étudiée à travers la fiction et l’imaginaire. Elle porte surtout une interrogation plus poussée sur la normalité — « normal, clean, straight, normal, quoi ! » À Écorcheville comme chez nous, il y a des métis qui ne sont ni noirs ni blancs, des androgynes qui ne sont ni hommes ni femmes, mais aussi des satyres qui ne sont ni hommes ni animaux… « Vous êtes vous aussi des ni… ni… », résume l’un d’eux avec un petit clin d’œil à un président hypernormal qui n’a pourtant que ces mots à la bouche ! « Mais mon vieux, la normalité c’est dépassé ! En réalité tu es incolore, sans relief, sans personnalité ! » Avoir cinq orteils au lieu d’un bon onglon chèvrepied, c’est être victime « d’une anatomie passéiste et insipide » : « Bientôt tu seras partout minoritaire, has-been, fossile d’une espèce éteinte. Fin de race blanche, va ! »
Ces jeux subreptices avec les codes de notre époque projetés dans un monde imaginaire engendrent un humour efficace. Ils forgent un monde où il devient difficile de distinguer le vrai du faux, comme pour cette jeune fille volante qui gagne sa vie dans des cirques en limitant ses prouesses à ce qui reste vraisemblable pour les humains, « fausse trapéziste et vraie jeune fille-oiseau ». En fait, ces personnages singuliers se ressemblent par leur différence même, ce sont des « créatures-hapax », qui se moquent du mainstream, comme les romanciers de la Nouvelle Fiction, naguère, s’étaient regroupés parce qu’ils étaient tous singuliers dans un univers littéraire uniforme. À Écorcheville-sur-Styx, nous sommes à la frontière poreuse entre deux mondes. Et la plus perméable est celle qui sépare le rêve de la réalité. Le personnage le plus touchant de ce roman, et du précédent de la trilogie, est sans conteste Astérion, le Minotaure, qui ne sait plus s’il a rêvé toute son aventure « au-delà du Styx » ou la partie restée en-deçà. Le roman, au détour d’une conversation, peut devenir philosophique, ou en tout cas poser des questions existentielles cruciales. « Peut-être les notions d’étendue et de durée n’existent-elles nulle part ailleurs que dans la conscience exiguë des mortels accrochés à l’idée rassurante d’une réalité à leur mesure ? En nous isolant d’une immensité vertigineuse, les quatre dimensions de l’espace-temps délimitent autour de chacun un cube salvateur pour sa santé mentale… » Au-delà de cette réalité restreinte, il n’y a que des questions qui tourmentent les poètes et les mystiques. Bien sûr, ces rares et courtes escapades dans le roman philosophique ne sont pardonnables que si elles débouchent sur une pirouette humoristique — par exemple, au spectacle des morts attendant sous la pluie la barque de Charon, « claquant en silence du souvenir de leurs dents dorénavant immatérielles. » La question fondamentale arrive subrepticement à la fin de roman, où il faut, dans la débâcle d’Écorcheville, « choisir sa rive ». Bien sûr, la ville se reconstruira, la vie reprendra le dessus, mais qu’en est-il de ce petit miracle de la frontière abolie, ou simplement perméable, entre réalité et fiction ? Le lecteur aussi devra choisir sa rive, car le cycle d’Écorcheville s’arrête à ce troisième roman. Ou pas.
Cet épisode grandiose dans une saga complexe nous fascine autant par l’écriture que par l’intrigue et les questions qu’il nous pose. Les personnages, jusqu’au plus secondaires, sont croqués en une phrase — « il avait cohabité avec sa sœur, vieille fille à confitures et napperons au crochet, toute dévouée à son frère ». — ou en une formule éloquente — « un squatteur lunaire », « une sorte de païen frotté de Bible »… On y retrouve Brumaire, bien sûr, le conteur à l’imagination débordante qui joue « un rôle insolite et plaisant » dans ce beau monde. « Le bruit courait qu’il avait publié des romans dans une vie antérieure, ce que nul ne s’était soucié de vérifier. » Le lecteur attentif remarquera toutefois que le titre de certains apparaît dans la bibliographie de Georges-Olivier Châteaureynaud. Quant aux contes dont il divertit la bonne société d’Écorcheville… « Voyons, ne laissez pas votre imagination prendre ainsi le dessus… » Certes, certes… Mais n’est-ce pas, à l’inverse, une « marotte peut-être sacrilège de tirer au clair ce qui devrait être laissé dans l’ombre » ?
Le ton particulier de Georges-Olivier Châteaureynaud tient à cette alchimie qui lui est propre entre humour et poésie. Certains passages nous entraînent dans les sphères les plus éthérées, comme dans les envolées de l’Hespéride Aeglé, une jeune fille douée de lévitation affrontant la tempête : un passage extrêmement sensible qui s’achève sur un juron lorsqu’elle tombe sur l’asphalte. Les personnages les plus touchants n’échappent pas à ce clin d’œil, l’angelot poupin (« Langer un ange, fantasme majeur d’une groupie d’évêque »), l’épouse du maire qui s’interdit tout écart de parole mais non de pensée (« elle grattait le palimpseste incessamment corrigé de sa conscience ») ou le conteur qui chipe une chips et la croque « à titre de ponctuation ». On savoure une discrète allusion littéraire (Monsignore Propinquor, « opinément surgi des caves du Vatican ») ou l’autodérision qui renvoie au titre du roman en évoquant un tube à la mode qui revient comme une scie, Hirbilo, entendez here below, « en ce bas monde ». Le premier tome se centrait sur « l’autre rive », celui-ci est résolument consacré à celle-ci, l’ici-bas. Et la belle idée de jeter un pont sur le Styx est définitivement abandonnée. Ou pas.
Voir aussi : les deux autres tomes de la trilogie : L'autre rive, À cause de l'éternité
Autres romans et nouvelles : Petite suite cherbourgeoise, Singe savant tabassé par deux clowns, Le corps de l'autre, Résidence dernière, Le goût de l'ombre. Aucun été n'est éternel, Contre la perte et l'oubli de tout. À cause de l'éternité, Nouvelles d'un front. Ce parc dont nous sommes les statues. Ici-bas. De l'autre côté d'Alice. Un beau diable.
Retour au sommaire
Christine Bini, C’est la fin de la nuit et je rêve un poète, Lire Sylvestre Clancier, La Rumeur Libre, 2023.

Dans une époque d’immédiateté qui a tendance à reléguer la veille dans un passé révolu, il est excessivement rare qu’un critique littéraire replace un livre dans l’œuvre d’un écrivain. Le travail de Christine Bini en est d’autant plus précieux. Elle a déjà consacré, en 2016, un livre à l’œuvre de Sylvestre Clancier, dont elle a par ailleurs traduit un recueil en espagnol. Le parcours qu’elle propose ici est thématique et pénètre toujours plus en profondeur dans une œuvre dont l’apparente simplicité révèle au fur et à mesure des approches une réflexion subtile. Comme dans le labyrinthe de Salomon, ou les sept chambres des frères en Saint-Jean, chaque approche nous renvoie au même ensemble mais avec à chaque fois un degré d’approfondissement supérieur. L’approche ésotérique n’est pas à négliger chez un poète qui s’est choisi Nerval pour « phare » et dont la recherche symbolique a passé par une appartenance explicite à la franc-maçonnerie. Pour autant, la poésie de Sylvestre Clancier est d’un abord accessible, d’une simplicité revendiquée, qui se prête parfaitement à une lecture pédagogique, « à quelque niveau que ce soit ». « Mais la simplicité n’est pas la facilité, elle en est même l’exact contraire », nuance Christine Bini qui propose ici quelques « clés d’entrée et de déchiffrement ».
Comme dans les chambres de Saint-Jean, l’enceinte extérieure est la plus évidente. Elle ancre le poète dans sa vie et dans son temps. Chacune des cinq approches s’intégrera ensuite dans la précédente, comme un jeu de matriochkas qui nous conduit au noyau compact de l’œuvre. « Poète de l’enfance », Clancier a d’abord utilisé sa matière personnelle, dans de petits souvenirs-flashes, qui semblent anecdotiques, à première lecture. L’enfance s’inscrit dans la tradition familiale, le royaume de la mère, le grand-père aimant, le père « immuable » (Georges-Emmanuel, dont la célébrité pèse sur l’homme comme sur le poète) « distrait, peu intéressé par son fils ». Mais « plutôt qu’une nostalgie, l’enfance est un état d’éternité ». Elle s’inscrit dans un rêve d’Éden, dans une réflexion centrale sur le temps, qui ne se réduit pas au passé.
Ainsi pénètre-t-on dans le deuxième cercle d’analyse, le rapport au paysage. « Découlant directement de l’évocation de l’enfance, voici venir le paysage. » L’inspiration (dans laquelle il faut voir l’air que l’on inspire et non la muse romantique) de Clancier est fortement enracinée dans le Limousin ancestral. Mais il ne s’agit pas d’une approche régionaliste, même si une lecture au premier degré reste toujours possible. Le paysage est sexué — « La terre limousine est dédiée aux femmes » — il peut être rédigé au futur — le rapport au temps, toujours — autant de signes qui nous invitent à décrypter la réalité brute. Ainsi s’éveille notre conscience, qui constitue le troisième cercle concentrique de cette approche. « Le monde est une construction qui conduit à l’apparition de la conscience », à travers les trois règnes, minéral, végétal, animal. Bien sûr, les pierres symbolisent la permanence, mais elles ne resteront que des pierres si l’homme n’y ajoute la conscience, qui les transmue en sculptures. Dans un « crescendo émotionnel », Clancier scrute l’éveil de l’émotion et de la conscience dans le monde. Jusqu’à cette rupture entre l’homme et le monde que manifestent les dérèglements climatiques. « Quelque chose s’est rompu dans l’ordre du monde, que la poésie contemporaine […] souligne et interroge. » La poésie est précisément le lieu de cet éveil de la conscience, parce qu’elle participe au présent en restant dans une tradition.
Ainsi s’ouvre la quatrième porte. « L’éveil de la conscience n’est rien sans la possibilité d’une transmission. » Or celle-ci doit dépasser le contingent de la description pour s’ouvrir au mythe. Clancier est particulièrement sensible à trois mythes complémentaires que Christine Bini suit de recueil en recueil. Isis, qui « remembre » le corps de son époux Osiris, transformant le rassemblement des membres épars en célébration de la mémoire, la remembrance. Ulysse, symbole du voyage rappelant que l’éveil de la conscience est « la sortie hors de chez soi ». Le Christ, dont l’Ascension prolonge dans la verticale le voyage horizontal d’Ulysse et qui incarne « l’aspiration à une humanité totale, réconciliée, consciente de sa trajectoire terrestre et ne s’en contentant pas, soucieuse de l’union du corps et de l’esprit ». Les trois mythes célèbrent à la fois une victoire sur la mort et l’éveil à une conscience supérieure. Nous sommes ici au sommet de l’analyse, dans la chambre intérieure que toute société initiatique entend révéler.
Et c’est alors qu’il faut briser le système symbolique pour le transcender. La cinquième et la sixième approches, qui semblent paradoxales, sont nécessaires : la fantaisie et la poésie, l’émerveillement qui rompt la rationalité apparente de la quête. « Toute l’œuvre poétique de Sylvestre Clancier est une tentative d’ordonnancement du chaos », analyse Christine Bini, avant de conclure par cette citation qu’elle a choisie pour titre : « C’est la fin de la nuit et je rêve un poète ». Le poète n’est pas celui qui rêve, mais celui que l’on rêve.
L’analyse de Christine Bini est rigoureuse et lumineuse, car elle ne se contente pas de répertorier les thèmes, mais montre leur lien profond, leur progression, et leur traduction dans l’écriture. Car à l’analyse thématique répond systématiquement une analyse formelle qui montre comment l’écriture traduit la pensée, ou plus exactement comment pensée et écriture forment un tout indissoluble : la structure du poème, qui peut souligner les paradoxes ; l’usage du « tu », qui n’est pas une simple interpellation du lecteur ; celui du « on », qui ne se confond pas avec le « nous » ; les « mots surgis », qui « ne trichent pas » ; le choix de la conjugaison, temps ou mode… Tout devient significatif et nous rappelle que la vraie poésie n’est ni un jeu d’idées désincarnées, ni un jeu d’écriture gratuit, mais une constante recherche du sens à travers leur union.
Voir aussi : Le Voyage et la Demeure. Sous le nom de Christine Balbo : Les Gorges rouges. Deux nouvelles italiennes.
Retour au sommaire
Lisette Lombé, Eunice, Seuil, 2023
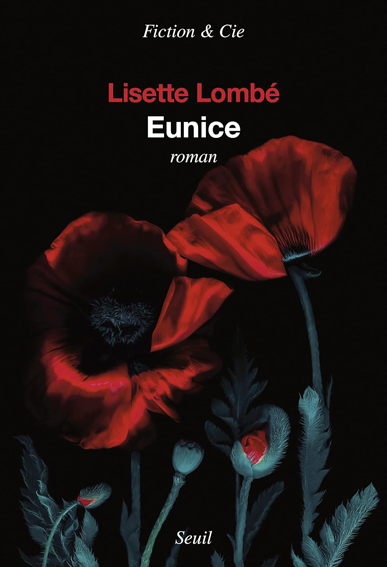
À dix-neuf ans, la vie d’Eunice se brise par deux fois, simultanément. Rupture amoureuse et mort de la mère. Double rupture — le mot ouvre le roman — l’une et l’autre sans élégance. L’homme aimé est un mufle. La mère, Jane, qui refusait de vieillir, est tombée à l’eau après une nuit de guindaille sur une péniche. Comment sortir de tout cela, surtout quand l’entourage n’a que condoléances compassées et tendresse de commande ? La vraie rupture est là : non dans ce qu’on a perdu, mais dans l’expulsion de soi-même, le détachement subit d’avec la vie. « Tu remercies mécaniquement. Tu fais le job. Ramassis de platitudes pour ne pas te décomposer. » Voilà pour les condoléances. Quant à l’ex : « L’Eunice qui léchait, avec des paillettes dans les yeux, le nombril de ce garçon-là est morte en même temps que sa mère. Next ! » Une bonne douche, une bonne cuite, un bon coup de cynisme pour arroser tout cela (« Mourir après avoir fait la fête toute la nuit, c’est quand même mieux que mourir grabataire dans un home, oubliée par ses propres enfants, non ? »), et l’on voudrait passer à autre chose. Après tout, Eunice est une sprinteuse remarquée aux championnats de Belgique. Il faut pour cela de l’énergie, de la volonté. On passe chez la coiffeuse comme un défi. « Tu es une killeuse avec des cheveux courts, maintenant. »
Pas facile. Car il y a d’autres découvertes, insoupçonnées. Les proches que l’on voit différemment. Le père, figure tutélaire soudain décomposée. « Dans le monde des morts, on peut faire ça. Laisser son père s’effondrer en silence dans ses bras. » La tante maternelle, Madou, « la féministe de la famille », artiste exubérante qui « foutait la frousse » avec ses allures de sorcière, mais qui soudain s’effondre et dont on découvre les secrets bien cachés.
Et puis, surtout, il y a l’agenda de la mère, que l’on ne retrouve pas, dont la perte engendre mille élucubrations, que l’on découvre par hasard, oublié chez la coiffeuse, et qui révèle, une fois par mois, un rendez-vous dans un hôtel et deux lettres mystérieuses, T.M. L’imagination s’enflamme, ça sent l’adultère, on enquête, un autre intérêt s’éveille pour le lecteur. L’enquête est bien menée, avec ses fausses pistes, le collègue dont les initiales pourraient correspondre à celles de l’agenda, mais qui est gay jusqu’au trognon ; la Tante Madou, bien sûr, piste qui n’est jamais exploitée mais qui s’impose au lecteur ; le pense-bête idiot, Téléphoner à Maman, que contredit la facture téléphonique… Tout cela n’aboutit à rien, sinon à faire bouger les lignes de fracture familiale jusqu’aux deux grands-mères d’Eunice. La rupture initiale devient une constante familiale, avec ses variantes dans des générations qui vivaient un bonheur de façade contraint. Le père et la mère qui s’étaient cru obligés d’inventer un coup de foudre. Une grand-mère qui « s’est coltinée pendant trois décennies un empaffé d’égoïste, un joueur, un dragueur impénitent ». Une autre qui a peut-être empoisonné son mari qui refusait le divorce.
La fracture qui court tout le long du roman prend un autre sens. Lorsqu’Eunice, coureuse invétérée non seulement sur le stade mais dans sa vie affective, se découvre soudain une passion pour une jeune femme, Jennah, « déesse métisse queer ». Pas besoin d’avoir lu Lacan pour établir un rapport symbolique avec le prénom de la mère, Jane. Pas besoin d’avoir lu Freud pour se rappeler le rêve érotique et saphique des premières pages, interrompu par un coup de téléphone annonçant la mort de Jane. La fracture est en Eunice, depuis le début, et sa réduction passera par un nouvel amour qui effacera en même temps le jeune mufle et la mère disparue. Malgré les digressions, le roman répond à une structure rigoureuse.
Il y a un vrai tempérament de romancier chez Lisette Lombé. Peut-être devrait-elle s’épargner, pour le laisser mûrir, les concessions aux thèmes d’actualité qui n’apportent pas grand-chose et qui finissent par briser la structure de l’intrigue — MeToo, l’inceste, les réunions réservées aux femmes, les collectifs autogérés, les ateliers d’écriture, le sort des artistes précaires, les concours de slam, la froideur anonyme des conseillers bancaires… il ne manque rien pour rappeler qu’on est en phase avec son temps, mais c’est au détriment de la construction pourtant solide.
Il en va de même pour l’écriture, très démonstrative, qui ne manque ni de force ni de pudeur pour rendre sensible sans lourdeur d’analyse les déchirements d’Eunice et les malaises familiaux. Le rythme saccadé du slam, les désarticulations syntaxiques, la crudité des fantasmes sexuels font allégeance à une forme galvaudée de modernité qui n’apporte rien à une écriture par ailleurs parfaitement maîtrisée. On suivra avec beaucoup d’intérêt les promesses d’une jeune autrice encore en quête de sa personnalité littéraire.
Retour au sommaire
Nathalie Heinich, Le wokisme serait-il un totalitarisme, Albin Michel, 2023.

Conformément à son origine anglo-saxonne (woke, éveillé), le mot wokisme, d’introduction récente, désigne une sensibilité nouvelle, fort développée dans les jeunes générations, attentive à des inégalités sociales, en particulier dans le domaine du féminisme ou du racisme. En quelques années, les dérives de ce mouvement aux fondements légitimes ont inquiété les milieux artistiques et universitaires, sinon l’ensemble de la société. La question s’est politisée et radicalisée, d’autant plus paradoxalement qu’elle divise l’ensemble des forces politiques en présence, de gauche comme de droite. L’usage même du terme woke devient un marqueur politique, la gauche radicale ne le reconnaissant pas et rejetant son emploi sur l’extrême-droite. Un état des lieux impartial serait urgent pour apaiser la situation. Force est de constater qu’il est actuellement impossible. D’emblée, il faut prendre parti pour ou contre le phénomène et voir son analyse, aussi juste soit-elle, aussitôt rejetée par la partie adverse.
Ce livre ne fait pas exception. Même s’il souligne, du bout des lèvres, la légitimité première de la démarche, il s’agit d’un réquisitoire à charge. Cela n’enlève rien à sa valeur : les faits rapportés sont exacts, les analyses intelligentes, les conclusions implacables. Force est pourtant de constater qu’il ne peut que mettre de l’huile sur un foyer déjà bien embrasé. S’il peut nous aider à analyser le phénomène et à en corriger les dérives, il relève bel et bien du pamphlet et non de l’analyse sociologique. L’autrice elle-même reconnaît que sa « prise de position contre le wokisme » la fait sortir de la neutralité, mais le justifie par des publications « qui ne prétendent pas être des productions scientifiques mais des réflexions d’intellectuel engagé dans un problème de société ».
Nathalie Heinich commence par énumérer des traits propres au wokisme. Elle en distingue sept : un rapport entièrement idéologisé au monde ; une confusion entre le registre descriptif du discours (qui dit ce qui est) et le registre normatif (qui dit ce qui doit être) ; l’alliance entre la normativité moralisante et des intérêts mercantiles ; l’ignorance de la spécificité de la fiction (qui relève de la représentation et non de la réalité) ; l’ignorance du contexte historique pour juger les œuvres du passé ; le mépris du droit moral de l’auteur ; le fanatisme de ses tenants. Les cinq parties analysent ces traits comme un idéologisme et un totalitarisme, en examinent les conséquences (la censure et la création d’une atmosphère totalitaire) et la résistance qu’on peut y apporter.
Ne nous attardons pas sur les faits rapportés qui sont, répétons-le, indéniables et bien documentés. Déplorons seulement leur présentation trop restreinte (ce qui est inévitable dans un livre synthétique) et trop partiale (seuls les éléments à charge étant retenus, ce qui les caricature inévitablement). Il en résulte cependant que ce pamphlet ne sera utile qu’à ceux qui ont déjà une connaissance extérieure des événements.
L’intérêt du livre réside d’abord dans l’élaboration, ou le rappel, de quelques concepts fondamentaux. La différence entre le communautarisme anglo-saxon et la laïcité à la française a fait couler beaucoup d’encre. L’un et l’autre ont le même but, l’instauration de la paix sociale dans des sociétés multiculturelles. Si les positions radicales rêvent d’un retour à une culture unique par l’exclusion (voire le massacre) de tout ce qui ne leur ressemble pas, il faut se faire une raison : les cultures sont de plus en plus appelées à se côtoyer et à se mélanger. Le modèle anglo-saxon pense que la paix sociale « passe par le respect des droits de toutes les communautés », donc par l’interdiction de tout ce qui peut les heurter. Le système français pense qu’elle passe par la « suspension des affiliations communautaires dans le cadre civique », qu’il existe donc un espace neutre où celles-ci n’ont pas à se manifester. Les dérives du communautarisme ont engendré une « politique des identités », un « identitarisme » qui exacerbe un sensibilité victimaire et conduit à une « régression civilisationnelle » puisqu’elle interdit la création d’une conscience citoyenne en assignant chaque individu à son identité et sa culture. Ainsi les réunions « citoyennes » qui excluent une catégorie de la population (les hommes ou les blancs) empêchent paradoxalement toute réflexion citoyenne.
L’intérêt du livre réside ensuite dans les pistes d’analyse, en particulier dans les paradoxes et les contradictions qu’il relève entre des courants trop dispersés pour être uniformes. Le rêve de l’alliance des luttes entre catégories de minorités victimisées est mis à rude épreuve par la segmentation des identités — menant par exemple des féministes, au nom de la convergence des luttes, à considérer le voile comme une liberté pour la femme musulmane. La louable volonté d’inclusion et le respect de la diversité sont contredits par l’exclusion systématique, dans des safe-spaces voire des réunions syndicales, de tout ce qui n’appartient pas à la minorité que l’on est censé défendre — caricaturalement, le mâle blanc de plus de cinquante ans, hétérosexuel et cisgenre. Paradoxe aussi que la priorité donnée aux minorités sous-représentées, qui se trouvent courtisées pour leurs caractéristiques (sexe ou origine ethnique) et non pour leur valeur : quel affront, pour une femme, d’être choisie dans un jury de thèse parce qu’il « manque une femme » et non parce qu’elle maîtrise le sujet.
L’analyse de l’idéologie est tout aussi juste dans son principe. L’université doit rester un lieu neutre dans lequel la recherche de la vérité scientifique prime sur toute idéologie. On ne peut effectivement tolérer la « confusion des arènes », l’arène académique où l’on débat rationnellement de la justesse d’une démonstration et l’arène politique où l’on juge la moralité d’une opinion, la légalité d’une prise de position. L’une ressortit à la liberté académique, l’autre à la liberté d’expression. Mais il ne s’agit pas d’un phénomène nouveau et l’on peut regretter que dans l’énumération historique ne figurent que des exemples empruntés aux idéologies de gauche (marxisme, gauchisme, anti-libéralisme, anti-étatisme…) en oubliant que des idéologies racistes, religieuses, ultralibérales ont aussi, par le passé sinon dans le présent, envahi l’arène académique. Soyons d’accord avec le constat : « La séparation de la science d’avec l’idéologie — qu’elle soit religieuse ou politique — a constitué un progrès majeur dans la civilisation occidentale ». Ajoutons qu’elle a commencé au XIIIe siècle par la mise en évidence d’une « double vérité » dans les milieux aristotéliciens de l’université de Paris et qu’elle a aussitôt été condamnée par l’autorité religieuse. Le « progrès majeur » a été opéré par des penseurs et des scientifiques résolument progressistes au terme de luttes autrement plus féroces que celles que nous vivons actuellement. Ajoutons que, dans la pratique, elles ont été l’œuvre d’hommes blancs qui ont « scientifiquement » prouvé, pendant plusieurs siècles, la supériorité de leur sexe et de leur ethnie. Cela n’excuse en rien les excès actuels du wokisme, mais cela relativise la notion de « progrès », qui n’a jamais été une question de raison mais, hélas, une question de combat. On peut regretter, dans le même ordre d’idée, que les exemples de dictatures soient cherchés à gauche (le Venezuela de Maduro ou la Russie de Poutine) en oubliant qu’un Bolsonaro ou un Trump peuvent aussi entrer dans la catégorie bananière. Cela n’ôte rien à la justesse du raisonnement, mais cela le… gauchit.
S’il faut combattre le wokisme — les dérives des différents mouvements de prise de conscience, mais non cet éveil d’une nouvelle sensibilité — ce n’est pas, me semble-t-il, en caricaturant les positions, ce qui ne peut qu’engendrer des réactions épidermiques, mais en identifiant et résolvant les problèmes auxquels il apporte de mauvaises réponses. Je ne puis admettre la mode des sensivity readers, mais je ne résumerais pas leur travail en disant qu’ils sont « payés pour caviarder des textes littéraires afin de les mettre au goût du jour woke ». Je me suis battu contre les accusations injustes d’appropriation culturelle, mais il faut d’abord entendre la douleur de ceux qui se sentent, à tort ou à raison, spoliés ou méprisés. On peut trouver ridicule l’attitude de François Cusset, qui refuse l’orthographe inclusive, qui rendrait son livre illisible, et qui prie de l’en excuser « celleux qui en seraient indigné.e.s », comme si deux mots suffisaient à le dédouaner. Mais il faut aussi donner une réponse à ce malaise. Et la jeune génération, dont l’exigence morale peut être récupérée par des exploiteurs sans scrupules, peut participer à un combat commun contre les exploiteurs du wokisme. Car, c’est vrai, en grattant l’indignation de surface, il y a un marché juteux dans la récriture des livres ou les programmes de formation. Prenons le pari de la sincérité du plus grand nombre pour combattre les excès et corriger réellement les injustices qui les ont engendrés.
Retour au sommaire
Debora Levyh, La version, Allia, 2023.
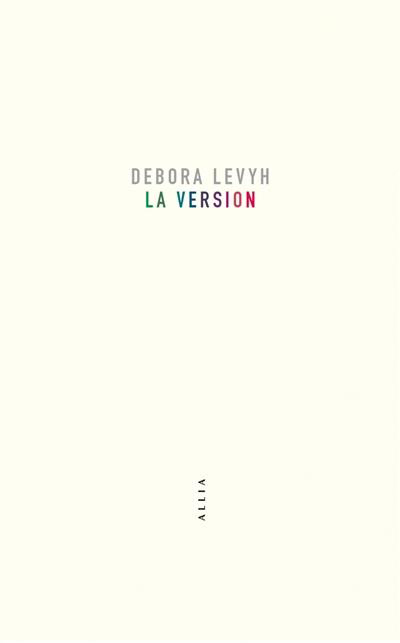
Comment parler d’un peuple qui n’existe pas et qui échappe à toutes les catégories de la langue comme de la sociologie ? On pénètre dans ce récit comme dans une étude anthropologique, à la rencontre d’un monde nouveau, décrit par une narratrice qui y a longtemps vécu. Mais tout lui échappe encore dans ce monde apparemment indifférencié (« Je dis “eux”, mais je pourrais dire “elles”, peu importe »), qui ne donne aux événements ni début ni fin, qui ne trace pas de frontière nette entre aliments comestibles ou non…
Parfois, on se sent dans une caricature amusée de notre monde moderne, parfois devant un exercice de style parfaitement maîtrisé mais un peu gratuit. Le plus souvent, on se laisse transporter par l’indéniable poésie qui émane de ce petit peuple aux contours fuyants. Un de leurs principaux rites — mais le terme est aussitôt jugé « mal choisi »…— consiste à suivre toute la journée un de leurs congénères et de transcrire par un système de notation complexe ses moindres mouvements. Le soir, ceux qui ont pisté un autre rejouent jusqu’au matin tous ses mouvements, mais comme tout le décor a disparu, on peut voir « les gestes nus ». La fête du lavage, les ébats avec des « entités », l’échange des souvenirs… autant de scènes d’une touchante délicatesse qui nous invitent à sortir de nos certitudes. Aucun mot n’ayant une acception stable, il ne peut y avoir de dictionnaire, mais il existe « un outil d’administration du sens pour les mots délicats »…
La gestion du temps est la grande affaire de ce monde aux concepts fluctuants. Car il a compris (contrairement à nous !) que « les erreurs de temps sont une source de désastres ». Pour cela, il faut des mots pour désigner le temps durant lequel on repousse légèrement la satisfaction d’un désir, ou la durée trop courte pour aller d’un endroit dans un autre. On se rend compte alors que ce peuple étrange a inventé une troublante sagesse qui nous fait défaut.
Bien sûr, il y a des récits, des événements, des personnages. Mais rien ne peut être précis — « C’était un jour intercalé au hasard dans la succession sans fin des jours homogènes »… Tout nous surprend — on lance un dé qui compte trop de faces, on introduit dans un appareil étrange de la matière que l’on ne peut jeter, « parce qu’elle encapsule une réminiscence, une pensée, une joie »… On s’occupe beaucoup de son corps et de la matière, on y trouve beaucoup de joie et de sensualité, mais tout cela est évanescent, sans réelle importance. De toute façon, après la mue, on change de nom, et de temps en temps on se fait mouler le visage… C’est sublime, c’est affolant, l’observateur commence à avoir des idées de meurtre — mais « les tuer ne servirait à rien. Ça me permettrait de survivre mais pas de parler. » Le contact avec ce « peuple intercalaire » devient inquiétant, l’impossibilité d’en parler angoissante. Comme ce peuple sans identité mais si lourd d’existence, la narratrice finit par perdre ses repères. Le lecteur aussi, sans doute. Et c’est un plaisir trouble.
Retour au sommaire
Éléonore de Duve, Donato, José Corti, 2023.
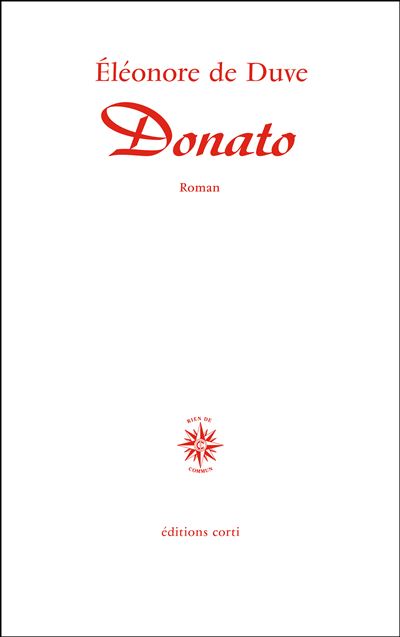
Mais quand le récit commence, Donato est encore un paysan de Cisternino, en Calabre. Il ne parle guère, déjà. C’est son caractère. Est-ce une raison pour ne pas avoir vécu ? « Parle, parle. Existe » : telle est l’injonction qui traverse le roman. Car Clio ne peut oublier qu’avant la maladie, elle aurait pu interroger le vieil homme. Elle ne l’a pas fait. « Clio était ailleurs... Quand la maladie ne régnait pas, oui, elle avait mieux, tellement mieux à... S’ennuyer chez ses grands-parents, jouer à la bataille, puissance quatre, dans le bruit de la télévision »… Il y a comme un regret, sinon un remords, dans sa décision de donner la parole au grand-père trop oublié. Comme un devoir, car Clio est aussi la muse de l’Histoire, fille de Zeus et de la Mémoire, Mnémosyne. Le nom n’est pas choisi au hasard.
Le livre commence dans les Pouilles d’avant-guerre, dans la domination, celle du fascisme, bien sûr, mais surtout celle des puissants, des possédants, qu’il s’agisse de riches familles ou de parvenus. Lucia, la grand-tante de Donato, figure dominante du roman, est domestique chez Angelo, « un drôle de type », idéaliste, « gentil, immensément, elle l’adore, mais stupide, stupide ». Héritier d’un colossal domaine avec son contingent de travailleurs. Mais son successeur est un parvenu retors, un magouilleur qu’elle doit continuer à servir, « à contrecœur naturellement, il fallait bien manger ».
Aussi, quand la Belgique, en 1946, recrute des mineurs et que Donato, fait ses bagages, elle y voit une sorte de promotion sociale. Sans se douter que l’on cherche surtout « des ignorants pour s’offrir en sacrifices à l’économie des États ». Un protocole entre les deux pays : « des bras contre du charbon ». Au charbonnage Sainte-Catherine, à Farciennes, il se donne sans un mot à son nouveau métier. N’est-ce pas le sens même de son prénom ? « Donato, littéralement, s’est donné, offert – pour qui, pour quoi, on le sait. Pourquoi ? » Les Italiens creusent les veines de la terre après avoir creusé sa surface. Ils remplacent la fournaise des Pouilles par celle des mines. « Ah ! Comme ils ne regrettaient pas les vallons, l’horizon, le doux pays natal, la faim, Ah ! C’est qu’ils retrouvaient dans les galeries un peu de celui-ci, les quarante degrés du soleil, la chaleur humaine »…
Témoignage touchant, le livre est aussi, et surtout, une interrogation et un travail sur la langue. Interrogation, car il est toujours paradoxal de donner la parole à un taiseux, et en français, pour un Italien immigré qui le maîtrisait mal malgré son attachement au dictionnaire. « Mon grand parjure dans cette entreprise est celui, que j’admets, de ne pas respecter l’avarice en mots de mon grand-père taiseux et d’écrire naturellement comme je suis, volubile et onduleuse. » Éléonore de Duve manie avec brio une langue inventive, sinueuse, à la limite, parfois de la préciosité, qu’elle décrit elle-même « en longues phrases, enrubannées, en mouvement. » Le langage est sa seule richesse. « Il contient dans sa paume nos explications, une réalité, nos dialogues, même déroutés, tant incertains. Il est un plongeon et un plongeoir, un mouvement, un socle, malgré tout, ma lueur. »
Cela nous vaut de vrais bonheurs d’expression, notamment dans l’évocation du vieil homme avec ses « poignets circonflexes », « cette personne portée par sa chaise », « au front beurré ». Lorsque l’émotion se traduit en images fortes, le lecteur se laisse entraîner. Parfois, de curieux mélanges d’expressions font sourire (« du pareil au chou » conjugue « du pareil au même » et « chou vert et vert chou »). Plus souvent, malheureusement, je suis resté perplexe devant des expressions trop chantournées (« la gibbosité de sa joue », « les aigreurs du paysan ont ruisselé sur la récolte salutaire »), des jeux de mots gratuits (« les mannes de la manne »), des mots trop recherchés (« Donato observe l’espace s’emboire »), des dislocations gratuites de la phrase (« dans l’espoir d’y mettre un minuscule peu d’ordre », « Donato a : journée, journée, travaillé et ainsi de suite »)… C’est dommage, car le travail sur la langue est souvent attachant et constitue le plus bel hommage que l’on peut faire à un grand-père condamné au silence.
Retour au sommaire
André-Joseph Dubois, Vie et mort de saint Tercorère le Maudit, Weyrich, 2023.

Dans une ville au bord de la Méditerranée, dans le nord de l’Afrique, au temps où la Numidie était une colonie romaine prospère et paisible, au tournant du Ve siècle dominé par Augustin, évêque d’Hippone, Tercorère est le fils d’un riche propriétaire élevé par une jeune esclave noire. C’est l’époque où le christianisme devient religion d’État mais où les pratiques païennes occupent encore largement les esprits. Le garçon timide, et délaissé par son père, se laisse séduire par les prêches virulents qui confortent sa honte des « impuretés » de l’adolescence. Refusant le mariage que son père lui impose — par peur de se laisser séduire par la promise, sa cousine, bien plus que par dégoût — il fuit la ville et se fait ermite.
Son père l’oublie vite, la cousine aussi, et l’évêque lui-même se méfie de « ces solitaires crasseux, arrogants et donneurs de leçons, zélateurs d’un Dieu de colère et de désastre ». Quant aux habitants, ils finissent par s’habituer à la « présence invisible », que les chevriers nourrissent à tout hasard, comme une assurance de piété contre la colère divine.
La vie érémitique ne résout pas ses problèmes. La chair continue à le tirailler et Dieu ne se manifeste pas. Il reste, comme la montagne lointaine qu’il ne parvient pas à atteindre, « présent, obsédant, désirable mais invisible, même pour qui s’efforce de marcher vers lui ». Tercorère multiplie alors les macérations, jusqu’aux blessures et mutilations qu’il s’inflige pour purger son corps du mal. Tout cela, durant les quarante premières pages, évoque une classique vie de saint avec un petit souvenir de Macaire le Copte de François Weyergans. Pour ma part, l’intérêt est venu lorsque Tercorère — hallucination ou fiction ? — entreprend un long dialogue théologique avec un vieux lion philosophe accompagné d’une hyène sarcastique. Car Tercorère, encore pris dans ses certitudes de néophyte, n’a pas toujours la partie belle avec cet animal au solide bon sens, qui semble aussi familier des philosophes antiques que des hérétiques chrétiens. L’ironie des propos échangés se teinte d’humour par l’opposition entre le langage châtié, parfois précieux de l’animal et le langage volontiers ordurier de l’homme. « Pourquoi parles-tu souvent comme un charretier ? » finit par lui demander le lion.
Ce dialogue constitue en fait un prélude symbolique à des discussions plus officielles qui se tiendront au concile de Carthage, où Tercorère fait scandale aux côtés d’un évêque débonnaire, qui partage ses fous rires et tente d’amadouer ses colères par les tentations terrestres, mais qui ne peut empêcher la violence de l’ermite. Car entre-temps, les calamités naturelles et les nouvelles des invasions barbares ont rappelé aux citadins la présence de l’ermite. Monté sur le trône épiscopal, il y nourrit de vastes et dangereux projets — construire une basilique, accueillir des disciples, écrire une règle monastique, s’emporter contre les restes de paganisme… Il finit par s’allier à un centurion complaisant pour massacrer la majeure partie de la population. Le plus étrange est que ses discours musclés séduisent les habitants lassés de la bonhomie de leur ancien évêque.
Derrière la satire du christianisme primitif tiraillé entre compromission scandaleuse et intransigeance meurtrière, les clins d’œil à l’actualité sont nombreux. Par des citations furtives, d’abord, où le lecteur attentif reconnaîtra Mallarmé, Racine ou la marquise de Pompadour. Histoire de nous inviter à lire au-delà du récit. Au concile de Carthage, on se croit soudain dans le conseil d’administration d’une association scrupuleusement démocratique, où l’on vote sur le principe d’un vote… L’ambiance apocalyptique, la critique des riches, la séduction d’un régime autoritaire nous rappellent curieusement notre époque. Lorsque Tercorère finit par sauver la ville des terribles Vandales, on songe à la tentation actuelle de la radicalisation et l’espoir d’un sauveur providentiel. Ces rapprochements, qui ne sont jamais lourdement suggérés, éveillent un sourire ou une réflexion plus profonde, mais Tercorère finit par nommer sa malédiction : l’« excitation », la « vieille jouissance » qu’il éprouve depuis toujours à haïr les hommes. Commencé dans la légèreté d’une satire bien enlevée, le roman s’achève dans l’exploration lucide d’une psychologie torturée.
Retour au sommaire
Nadine Eghels, Avec Paul, Arléa, 2023.
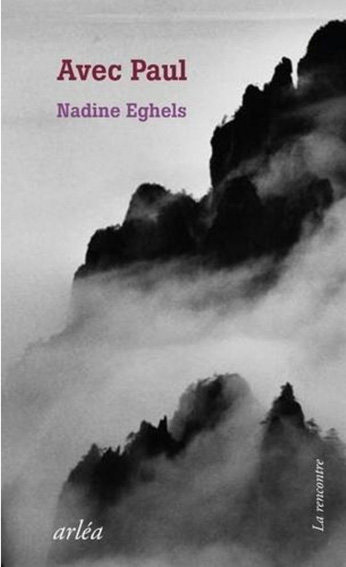
« Transformer la douleur en création, l’émotion en mots, la mémoire en inventivité. » Ce récit tient avant tout, et explicitement, du travail de deuil. Nadine Eghels a perdu son mari en 2018. Mais un mari mondialement connu, qui la laisse dans une double perte, celle de l’homme dans son intimité et dans sa célébrité. Paul Andreu a été l’architecte de l’opéra de Pékin, du musée maritime d’Osaka ou de Roissy-Charles-de-Gaulle. « J’ai réalisé que je ne pouvais faire l’économie de ce texte sur Paul, ou plutôt sur ma vie avec lui, même si cela réveille des émotions. Sinon j’aurais l’impression de fuir quelque chose d’essentiel. Ce texte est le terme d’un chemin, et le départ d’un autre. Prendre un raccourci ne ferait que rallonger le parcours. » Une résidence d’un mois dans une cabane au bord du lac Léman lui permet de réaliser ce projet. « Je ne sais pas encore ce que je vais écrire, après la mort de Paul », mais il s’agit bien de « donner forme – une forme littéraire – à l’indicible ».
Cela commence par des souvenirs. Lorsqu’elle rencontre Paul Andreu, celui-ci est marié, père de famille. Quelle relation va se construire ? Soit Nadine sera présentée à la famille et deviendra une amie, soit ils devront garder le secret. Ou alors, il faut basculer dans l’inconnu… La différence de richesse peut créer un malaise, qu’il doit estomper par la délicatesse, comme si tout était naturel (« mon chauffeur va vous ramener »), y compris les maladresses lors d’une réception chez une amie près du Champ-de-Mars. Mais la fascination est réciproque et le sentiment durable, fondée sur des discussions profondes et un même amour de la langue. Paul « fait corps à la fois avec l’architecture et avec les mots qui me la racontent ». De courts chapitres, à la fois thématiques et chronologiques, racontent les grands combats comme le quotidien, l’effondrement d’une voûte dans un aéroport comme le café au lait au lit ; les colères professionnelles comme les disputes conjugales. Et bien sûr les diverses facettes du personnage, qui fut à la fois architecte, écrivain, peintre…
Mais à travers ces anecdotes, on voit se mettre en place un réseau de références, un symbolisme discret. Dans un premier temps, on croit se trouver dans une succession d’instantanés que l’on déguste comme de petites friandises, telle l’image de l’homme aimé qui, pour traverser un espace à gué, « bondit d’un bloc à l’autre ». Peu à peu, on comprend que Paul est toujours en mouvement, en déplacement professionnel, en progression dans son travail. Les rencontres se font souvent en promenades, en visites… Nadine sent qu’elle « navigue entre deux ports d’attache ». Mais « on n’arrête pas un homme qui cherche ». Les blocs de béton formant « gué » deviennent a posteriori le symbole de ces rencontres espacées, de cet homme en perpétuel mouvement. Tel est aussi le sens profond du travail d’architecte, centré sur des lieux de passage comme les musées ou les aéroports. Celui de Canton est conçu avec une route qui enjambe pistes et bâtiments, de sorte que les voitures passent dans le ciel comme les avions. L’architecte, dans nos stéréotypes, est lié à la maison, la « demeure ». Ici, nous sommes dans une architecture du mouvement, de la lumière, de la trouée dans le ciel.
Cette logique est aussi celle de l’écrivain. Paul écrit un roman, Kaléidoscope, par nouvelles qui s’enchaînent les unes aux autres. Et peut-être même la logique profonde de sa maladie de Parkinson : « Le parkinsonien court après son centre de gravité. » Sa mort même s’intégrera dans cette thématique, la dispersion des cendres étant décrite comme un envol. Ainsi, par l’écriture, Nadine Eghels achève dans le même élan son travail de deuil : « Le deuil n’est pas un travail, ni un état. C’est un passage, comme tu les aimes. Entre deux états justement. J’arrive au bout. La lumière m’appelle. » Et elle peut enfin dire : « Je suis réconciliée ».
Retour au sommaire
Lydie Salvayre, Irréfutable essai de successologie, Seuil 2024.

Dès le titre, on se doute que Lydie Salvayre nous propose un pamphlet sur le mode de l'ironie. L'affirmation péremptoire (irréfutable), le néologisme à connotation scientifique (successologie) donnent le ton. Comment obtenir le succès que, dans le monde moderne, chacun croit mériter ? La leçon ne peut nous être donnée que par quelqu'un qui l'a connu (disons-le d'emblée, à juste titre) et sur le mode ironique qui opère une distanciation de bon aloi. Prenons donc ce livre pour ce qu'il se donne : un pamphlet bien enlevé, superbement écrit, drôle et sacrcastique, cultivé sans pédantisme, qui nous fera passer un bon moment mais qui n'a pas pour voction de rester dans nos mémoires ni dans l'œuvre impressionnante de l'autrice. Il se présente comme une somme de maximes au cynisme sanglant ("Il n'y a d'heureux que les gens à succès", "Ce qui ne se voit pas reste sans existence"...), de conseils et de règles parodiant les manuels de bien-être ou de séduction ("conduite à tenir", "règles générales"...), assortis de commentaires complices ("rentrez vos griffes, mes chatons", "chers lecteurs", "mes cœurs purs...) et de portraits au vitriol.
Oui, on s'amuse follement au portrait de la bookstagrameuse (mais pourquoi au féminin ?) ou de l'homme influent (mais pourquoi au masculin ?), sans parler du pamphlétaire (toujours au masculin, magré le contre-exemple que fournit ce livre !) traité de "hooligan littéraire au corazón de mantequilla"), bref de toute la foule des rabat-joie, "les revêches, les hargneux, les amers, les aigris, les navrés, les meurtris et tous ces mécontents aux rêves avortés qui n'ont pas réussi à convertir en forces leurs frustrations et leurs rancunes". Espérons qu'il n'y en aura pas trop parmi les "chers lecteurs" qui prendraient au pied de la lettre cet essai de successologie.
C'est peut-être la limite de l'exercice. Il a sans doute fait beaucoup de bien à l'autrice et en fera beaucoup à tous ceux qui le prendront au second degré. Peut-être moins aux aspirants écrivains, aux écrivains confirmés qui se reconnaîtraient dans les portraits désopilants que l'autrice en propose, aux critiques littéraires (aïe !), aux éditeurs (aïe aïe aïe !) ou aux bloggers qui risquent bel et bien de s'y reconnaître... Qu'ils se consolent : le dernier portrait (peut-on croire) est celui de l'autrice, que l'on soupçonne (à tort ?) d'être elle-même "d'une ambiguïté vertigineuse" : "Il se peut que vous désiriez le succès tout en abominant ses servitudes". Un auto-pamphlet ne dénote-t-il pas d'une "fatigue de tout [son] être devant les roueries, les simagrées, les ronds de jambes, les sourires forcés, les caresses mentenuses et toute l'insigne tartufrie de ces petits milieux qui s'estiment éminents et croient que l'univers entier est tout occupé de leur cuisine" ? Dans ce cas, le conseil est formel : "Reprenez le maquis, et jetez loin ce livre".
Ou mieux : délectez-vous de son ironie efficace et dites-vous que, non, vraiment, la réalité ne peut pas être aussi noire...
Retour au sommaire
Alex Lorette, Un fleuve au galop, Genèse éditions, 2023

Trois personnages, dont les destins ont divergé, sont au centre de ce récit. Leurs histoires finiront par tisser une trame commune, sur laquelle chacun dessine son motif. Lucie Lhermytte, placée en maison de retraite, ne rêve que de retourner au Congo, où elle a été élevée. Félicité vient d’être licenciée, une variante tout aussi traumatisante de la dépossession. Elle a quant à elle choisi d’épouser un Nordique pour diluer la couleur de sa peau : ses rêves la portent plutôt vers le nord. Le troisième protagoniste, qui restera longtemps mystérieux, change de nom au cours de ses périples et s’appellera ici Nkisu, là-bas André, ailleurs Jon…
Autour d’eux gravitent les acteurs d’une fresque grandiose, qui s’étire sur cinq générations du Congo à l’Islande en passant par la Belgique. Félicité à appris à lire avec son grand-père dans les carnets rédigés par son arrière-grand-père. Toutes les horreurs de la première colonisation y sont retracées avec un cynisme effrayant, le travail forcé, les massacres, les châtiments, les représailles, les mains coupées… Et pourtant, dans la volonté intransigeante du colon se retrouve celle de Lucie, le même esprit de fuite, la même révolte, le même goût pour l’aventure. « Fonctionnaire, moi ! À Bruxelles ! Jamais de la vie ! » : l’une et l’autre peuvent prononcer la même phrase.
Mais avec la distance de trois générations, Lucie se retrouve plus proche des colonisés que des colonisateurs… Elle a été élevée par Massiga, sa nourrice noire. « Lucie a bu son lait. Avec Gaga, Lucie est devenue noire au-dedans ». Elle est désormais une « moindo mundele », une Noire blanche, une noire qu’on ignore. Le Congo est durablement inscrit en elle. À dix-sept ans, en 1958, elle est brusquement envoyée en Belgique, enfermée dans un pensionnat religieux qui l’exploite effrontément « par charité chrétienne », en lui faisant croire que l’argent de sa pension n’est pas versé pour la faire travailler sans salaire. Ainsi les rapports de domination se rétablissent-ils entre les religieuses belges et la « moindo mundele » qui leur est confiée.
Ces rapports humains, d’autant plus finement analysés qu’ils se dégagent du récit par des rapprochements effectués par le lecteur, constituent la partie la plus intéressante de ce roman aux détours parfois complexes. Entre Lucie, Blanche élevée par une nourrice noire, et Félicité, de mère blanche et de père noir mais attirée par le grand Nord à la recherche de ce dernier, il y a toute la complexité des métissages culturels. « Il y a du noir au fond de moi. Je suis plus noire que je ne l’ai jamais été », constate Félicité, répondant à l’impression de Lucie d’être « noire par dedans ». L’opposition se résoudra dans une somptueuse image, en fin de roman, lorsque Félicité retrouve son père en Islande : « Nous sommes assis sur des névés. Ils sont blancs, ils sont noirs. Dans la glace, les couleurs se mélangent. »
De même, le leitmotiv du silence, qui traverse le roman, répond à des situations parfois opposées. Le silence digne des Noirs devant les colonisateurs se transmet à Lucie, dont le silence sur certains sujets devient une « chape étouffante » capable de faire plier l’échine. Un silence meublé de paroles creuses qui soulignent par contraste ce qui doit être tu. « Elle a creusé un grand tunnel de silence, rempli de rien. » Un silence, en fin de compte, fondateur : « Le silence de ma mère a accouché de ce que je suis ». Rien à voir cependant avec le silence de la religieuse, qui tient du mensonge par omission.
Quant au fleuve qui a donné son titre au roman, il rapproche et éloigne, tour à tour salvateur ou menaçant. Symbole de la frontière infranchissable entre les hommes — « Elle savait qu’un grand fleuve sépare ceux qui choisissent un lieu pour vivre, de ceux qui y sont nés » — mais rassurant, aussi, dans un pays qui peut se montrer hostile — « Si tu te perds en forêt, tu n’as qu’à écouter le bruit du fleuve. Le fleuve te dira où tu es. »
Retour au sommaire
Stéphane Lambert, Vincent Van Gogh, l’éternel sous l’éphémère, Arléa, 2023.
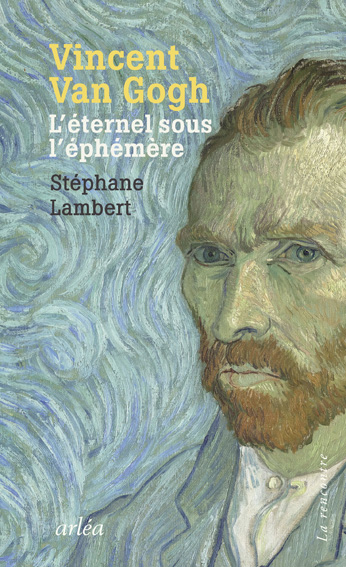
Les textes réunis ici ont d’abord constitué un feuilleton pour Beaux-Arts.com et ont été imprimés « dans la joie du prix Rossel » obtenu par Stéphane Lambert en novembre 2022. Ils n’ont pas vocation à constituer une monographie de plus sur le peintre. Comme dans d’autres essais de Stéphane Lambert, il s’agit plutôt d’une réflexion personnelle, qui assume pleinement sa subjectivité (un sursaut de patriotisme se réveille par exemple en signalant que la seule toile vendue du vivant de Van Gogh fut achetée par une Belge, Anna Boch). Mais aussi ses doutes, notamment sur sa démarche : « Je me surprends quelquefois à ne plus comprendre le processus qui m’a conduit sur vos pas comme si j’avais été poussé vers vous par une force inconnue, un mystérieux jeu de piste. »
L’écrivain s’adresse donc au peintre, avec la familiarité de l’ami mais aussi le respect de la deuxième personne du pluriel. Il s’ancre résolument dans l’actualité présente, évoquant la crise sanitaire ou le débat brûlant sur la séparation entre l’homme et l’œuvre. Le parcours est libre, mais s’articule autour des lieux où vécut le peintre et respecte la chronologie. Les nombreux passages en italiques reprennent textuellement des lettres de Van Gogh. Cette forme hybride, entre l’essai, la biographie, la lettre, le journal intime, fait toute l’originalité de cet essai, et sa richesse. Oui, nous sommes dans un jeu de piste, où nous suivrions celle du pisteur sur la trace du pisté ! La réflexion qui se cherche s’approfondit peu à peu sans s’appesantir pour se concentrer sur l’essentiel : le travail de création, commun à la peinture et à l’écriture. Et c’est bien ce qu’on attend d’un dialogue entre deux artistes.
Cette démarche qui peut sembler erratique est à l’image de la réflexion à laquelle elle aboutit : « L’art travaille la matière qu’il observe en tisserand s’activant à raccommoder le lien perdu entre immédiateté et immémorial. » Retisser le lien entre le conjoncturel et l’essentiel, telle est bien la démarche de Stéphane Lambert, qui se reconnaît en celle de Van Gogh. Le principe fondateur de son art, analyse-t-il, jaillit à travers ses traits fuyants, retrouvant l’éternel sous l’éphémère : « Le peintre est celui qui recueille l’esprit de ce qui va et vient devant ses yeux, dans l’envoûtant manège de la matière. » C’est une sorte de transmutation alchimique de la matière précaire en illumination, dont le tableau, ou le livre, n’est que le dépôt transitoire. Sous sa palette, ou sa plume, « le monde qui disparaît reprend forme ».
Ce rapport à la réalité, au monde qui nous entoure, qui n’est, malgré son apparente solidité que « l’amalgame de [n]os pensées » nourrit l’approche dynamique qui suit Van Gogh à travers le temps et l’espace, mais aussi à travers l’évolution de son art. Stéphane Lambert s’attache au tremblement de l’œuvre, au léger déplacement de la réalité : « votre peinture saisit le hors-champ en plein cœur de la vue ». Toute œuvre d’art, si « réaliste » qu’elle puisse paraître, nous introduit dans un monde transposé, un « couloir parallèle » où le quotidien se trouve « réorchestré » en un monde « halluciné » qui ressemble « en tous points » au nôtre.
La démarche est ouvertement mystique – le mot apparaît à plusieurs reprises : « Le peintre capte le mysticisme intense qui se dégage de l’ordinaire » - « Ainsi s’ouvre la dimension mystique de la peintre qui révèle à nos yeux le courant secret à l’origine de notre présence, et le réverbère. » Et dans la droite ligne de la mystique de l’être qui se concentre sur le point de néant consubstantiel à l’homme pour y trouver l’appel d’un infini – qu’il soit ou non identifié à une divinité. Il s’agit, par l’art, de « comprendre la réalité », donc de « discerner la ligne abstraite qui règle l’équilibre entre apparition et disparition. » Mais le néant qui s’installe dans l’œuvre n’est pas un anéantissement. C’est au contraire une nouvelle plénitude. « Le poids du vide plane dans l’air. Où sont passés les gens ? » Dans notre propre recherche, précisément, qui s’enracine dans ces couloirs parallèles que l’artiste a ouverts pour nous. « Le décor de la chaumière est planté. Il faut désormais la peupler de ce qui n’arrivera pas. » Ce qui n’arrivera pas ? C’est précisément tout ce qui peut arriver.
Voir aussi : Paul Klee jusqu’au fond de l’avenir. L'apocalypse heureuse.
Retour au sommaire
Michel Host, Le Trouvère du vent, Le Temps des Cerises, 2023.
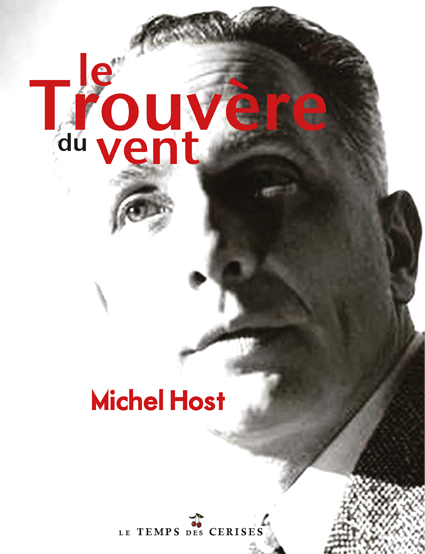
« J’appelle poésie un conflit de la bouche
et du vent la confusion du dire et du taire
une consternation du temps la déroute absolue »
« Cette assertion de Louis Aragon a constitué, dans ma conscience souvent distraite, un véritable séisme », confesse Michel Host. C’est alors qu’il a décidé d’étudier l’œuvre poétique de l’écrivain pour « cerner » ce que représente pour lui l’essence de la poésie, ce qui fait sa nécessité. Il en est résulté sept articles parus dans la revue Faites entrer l’infini et réunis ici en un volume.
Autant dire qu’il ne s’agit pas d’une étude de plus sur Aragon. Michel Host ne se prétend pas critique littéraire et avoue son peu d’enthousiasme pour le genre de l’essai. Le livre oscille entre le dialogue, la confession, l’analyse, et est surtout attentif aux résonances entre sa propre sensibilité et celle d’Aragon. « C’est donc, en l’occurrence, mon sentiment presque brut de lecteur, que je tenterai d’exprimer, limitant le plus possible la réflexion plaquée, taraudante, quand elle ne me paraîtra pas indispensable. » On fera un détour par le petit jardin bourguignon où ces lignes furent écrites. On égratignera au passage le monde actuel et son « ignominieuse non-pensée politique », les adeptes du Petit Lacan sans peine, les « vingt jargons de l’université » qui ont remplacé le langage compréhensible, ou le « temps de nihilisme financier et de honte entretenue par les philistins d’un socialisme français dévoyé »… Après tout, la résistance de Michel Host au monde qui l’entoure n’est-elle pas un écho paradoxal mais tout aussi sincère à la « poésie du combat » d’Aragon ?
Ne nous attendons pas non plus à un panégyrique aveugle. Michel Host peut dénoncer aussi bien les « horreurs » de l’homme que les « splendides niaiseries » du poète ou sa « poésie bouchère découpée au feuillard » : tout cela est de l’ordre des « grâces terribles ». Il reconnaît aussi une intégrité foncière, une honnêteté désarçonnante à reconnaître ses erreurs, à ne rien dissimuler de ses faiblesses. Sauf, sans doute, lors du rapport Khrouchtchev où il se montra « trop silencieux ». On l’aura compris, la plume acérée et l’art de la formule de Michel Host constituent un des charmes les plus puissants de ces textes.
L’approche se veut d’abord chronologique, mais le dialogue qui s’établit entre les deux hommes, entre les deux œuvres, ne craint ni les diversions ni les sauts temporels et se clôt sur une approche plus transversale de la quête poétique. Même s’il désavoue la « réflexion taraudante », Michel Host se livre ici à quelques analyses confondantes de clarté. On savoure la subtile étude de la « déviation », « bifurcation douce, brutale, inattendue, comme si les routes du poétique ne pouvaient mener aux ports attendus ». Ou celle de la résistance poétique face à la « creuse mais assourdissante rhétorique nazie ». La langue devient ici une arme redoutable. « Tout l’art poétique d’Aragon est entré en guerre. L’esprit de sa résistance est au cœur même des mots et dans leur organisation poétique nucléaire. » S’il chante alors les yeux d’Elsa, c’est dans un mouvement précurseur du Peace and love, « l’Amour contre la Guerre ». S’il retrouve les poètes médiévaux, c’est une manière de patriotisme plus subtil que la lutte armée. Le vers classique est alors une « arme culturelle et identitaire » et la rime devient une surprenante forme de patriotisme.
Fondamentale est aussi l’analyse du Fou d’Elsa où la Reconquista et la prise de Grenade se superposent à la chute de Paris en 1940. C’est avec une infinie délicatesse que le commentateur met en évidence les quatre voix qui se fondent en un seul « vieil Aragon » dans une « mécanique horlogère » digne d’un artisan suisse. Tout aussi stimulante est la quête de la poésie qui clôt cet ouvrage, cette « traduction en prose française du poème qu’il n’est pas possible d’écrire en si haute région ». Je me souviens de la méfiance de Michel dans nos discussions sur le mysticisme athée : son matérialisme, qui rejoint en l’occurrence celui d’Aragon, ose ici les mots tabous, eucharistique, transcendance, mysticisme. Cette haute conception de la poésie, qui tend la main, en coda, à François Villon, est sans doute le plus bel hommage que l’on peut rendre à la parole fondamentale.
Voir aussi : Zone blanche, L'amazone boréale. Mémoires du Serpent. Lysistrata, Ploutos, Le petit chat de neige, Une vraie jeune fille. L'êtrécrivain.
Retour au sommaire
Caroline Wlomainck, Incisives, Lamiroy, 2023.

Cinq longues nouvelles nous entraînent dans les situations les plus sordides de la société contemporaine. Une vieille femme est victime de voisins qui jalousent sa maison ; un industriel de la malbouffe est séquestré par un journaliste excédé ; un couple se déchire sur ses vacances ; un enfant laisse par un orgueil déplacé un drame s’accomplir ; un mari ne voit pas la dépression de sa femme… « Une écriture cash, clash, réaliste, directe, perturbante et… incisive », nous promet l’éditeur. Peut-être, s’il faut en juger par le vocabulaire volontiers ordurier et la syntaxe relâchée. Mais il y a plus. Certes, dans un premier temps, on peut partager la « rage » de la quatrième de couverture contre « des voisins envieux », « un patron d’entreprise abject », « un mari égocentrique », « des gamins insouciants », mais on est vite détrompé. Caroline Wlomainck a pris le pari du double point de vue. Dans chaque nouvelle, les protagonistes prennent tour à tour la parole, à la première personne. On entre dans leurs sentiments, leurs raisonnements, même biaisés, leur obstination. On les comprend, même si on ne les excuse pas. On comprend, en tout cas, que le drame naît d’abord d’un malentendu, d’une crainte du ridicule ou d’un manque d’ouverture à l’autre, et qu’il se durcit par un entêtement excessif. Dans quatre des cinq nouvelles, l’amitié ou l’amour sont encore là, il suffirait d’un rien pour éviter la catastrophe. Mais chacun campe fièrement sur ses positions.
Ce double point de vue et l’évolution des sentiments, qui se traduit dans les meilleurs moments par une adaptation du langage, constituent la meilleure idée de ce recueil. Elle n’est cependant pas sans risque et demande une parfaite maîtrise qui manque encore à l’autrice. Risque d’abord de ralentir le récit, lorsque chaque événement est raconté deux fois par deux personnes différentes. Risque aussi de ne pouvoir varier suffisamment le ton des personnages : ce sont en fin de compte dix écritures distinctes qu’il faut trouver, dont chacune se modifie au fur et à mesure de l’évolution des sentiments et des émotions ! Risque enfin de rester dans la description des actions et des sensations sans laisser au lecteur un point d’ancrage pour s’approprier le récit. Le projet est ambitieux et quelques beaux passages, l’attention aux détails, la qualité des chutes, nous poussent à faire confiance à l’autrice pour parvenir à le maîtriser. Si ce n’est pas encore le cas, on ne demande qu’à la suivre.
Retour au sommaire
Yves Namur, La nuit amère, Arfuyen, 2023.

Une image forte ouvre ce recueil : « Creuse tout autour du vert, // Creuse / Sept colonnes de silence, sept fois / Un trou ». Cette injonction, qui s’adresse au lecteur, à l’homme, au poète, prend une dimension sacrée par le caractère rituel, presque liturgique que lui confèrent l’anaphore, le symbolisme du nombre sept et de la colonne, le paradoxe d’une colonne de silence. Car c’est par ce geste que la prairie pourra parler et que le poème trouvera sa source : « creuse / Jusqu’au centre de nulle part » pour y trouver les poèmes.
Je suis particulièrement sensible à la thématique mallarméenne du « creux néant musicien » qui traverse les recueils d’Yves Namur et de nombreux poètes attentifs à la source vive du verbe. Elle s’inscrit également ici dans la dialectique socratique du manque et du désir : l’éros naît de ce qui lui fait défaut, comme le vent s’engouffre dans la dépression : « il n’est d’amour / Que celui tourné vers le vide », reconnaît le poète. Mais la réflexion va plus loin et rejoint toute la mystique (religieuse ou athée) du néant attentive à la disponibilité totale de l’être pour accueillir en lui l’intégralité du monde : « Entendre // Suppose / Que le vide soit d’abord en nous ». Et pour cela, d’autres sens doivent être mis en œuvre, ceux qui sont directement en contact avec la matière : « Seules / Les mains savent aussi / Ce qu’il en coûte de vivre // Avec l’absence // Et le désir »).
Vivre… Il s’agit bien d’une attitude, non d’une posture. En témoignent quelques leitmotive qui traversent le recueil, composé de textes datés de 2010 à 2021 : le creux, les mains, le désastre, le savoir, le silence, les traces… Chacun les organisera selon sa lecture. Chaque poème s’appuie sur des lectures, parfois contextualisées (« avec un livre de Paul Célan sous le bras »), sur des souvenirs intimes, des anniversaires, deuils, sur des événements historiques (la nuit de cristal, le leitmotiv du désastre), mais il franchit la frontière de l’anecdotique pour s’inscrire dans un « livre muet » qui dépasse le langage de l’homme. Le creusement, la renonciation au langage phatique, aux bien nommées « paroles creuses » (et désolées de l’être…) qui ne sont que l’ubac du silence, tout tend vers l’invisible frontière qui ne peut être atteinte mais qui doit être dépassée, « à la lisière du visible », « de l’autre côté du temps », « ce qui ne peut vraiment être franchi »…
Comment franchir l’infranchissable ? Le paradoxe est similaire à celui du néant créateur. Au-delà de notre ignorance fondamentale (« On ne sait rien ! ») s’ouvre un autre savoir, celui du monde, de la matière, qui ne passe pas par les mots : « On dit d’un pré / Qu’il pense plus que les hommes », « Le dé sait tout ça depuis belle lurette ». La poésie qui y trouve sa source est sans doute inaudible, mais rappelons-nous que « seules les mains savent »… Une autre approche de l’indicible est ici à l’œuvre. Nous n’en connaîtrons jamais que les traces laissées par les mots des poètes, dans lesquelles s’inscrivent à leur tour leurs lecteurs, dans une longue chaîne qui traverse les siècles. Ainsi se justifient les épigraphes, les citations, les dédicaces qui accompagnent ces textes et s’y intègrent dans un projet plus vaste.
Ce sont les traces « Qui marchent vers le ciel et l’irréparable ». Dans la même optique que la dialectique socratique du manque et du désir, elles « répondent peut-être à une blessure / Ou un appel obscur ». La blessure (comment de pas songer aux « désastres » et à la Nuit de cristal ?) crée un vide, cet appel d’air qui fait naître la poésie. Non pas celle des mots, mais celle de leurs traces, l’empreinte creusée dans la mémoire collective et qui à son tour engendre la poésie. Voilà le « livre muet » qui s’écrit au-delà de la frontière. Conscient de la perte de l’innocence originelle (« Du temps / Où le temps était sans reproche »), le poète échappe à toute nostalgie stérile : il sait que la poésie peut nous apporter « Un peu de cette lumière intense / Qui vient du dehors ».
Voir aussi : La tristesse du figuier. N'être que ça. Dis-moi quelque chose.
Retour au sommaire
Corinne Hoex, Nos princes charmants, Les impressions nouvelles, 2023

« Bien entendu, je ne perds pas mon temps à chercher le prince charmant », se vante Gina… Et pour cause ! Lesdits princes répertoriés dans ce stimulant recueil de nouvelles n’ont ni charme ni couronne et rivalisent d’ignominie par leur suffisance ou leur timidité, leur mépris de la femme sinon leur sadisme. Avachis devant leur télévision, trompant leurs femmes, indifférents, paresseux, geignards, ils n’ont d’autre qualité que d’aiguillonner l’imagination de leur compagne pour leur rendre la monnaie de leur pièce.
S’il s’étend à tous les milieux sociaux, le recueil est traversé par la personnalité de Françoise Girard, romancière à succès, qui a permis à son mari d’arrêter le travail pour se consacrer à sa passion première : tromper sa femme. Pour autant, il crève de jalousie devant les héros des romans de celle-ci (« tout le monde a ses entrées dans ta tête ») et rêve d’occuper une place de choix dans ses livres – pourquoi pas commissaire ? Françoise Girard revient régulièrement au fil des pages, tissant une autre histoire à travers le recueil.
Ce n’est pas le seul lien entre les histoires. Le livre est tissé comme une dentelle, avec des fils qui s’entrecroisent ou se prolongent, des détails récurrents, parfois gratuits, souvent significatifs. Certaines nouvelles se suivent en mettant le focus sur un personnage secondaire, d’autres reviennent vers un personnage plus ancien, des leitmotive clignent de l’œil au lecteur, parfois pour le simple plaisir, parfois pour créer une atmosphère ou établir un lien direct entre deux nouvelles… Tout cela forme en fin de compte un univers cohérent, où les hommes avachis devant la télévision regardent le Tour de France tandis que les femmes transportent d’étranges valises, le tout sous l’œil à facette de mouches envahissantes. Les mouches forment « comme un ballet de cupidons minuscules » aussi ironique que les princes charmants, mais dans la serre où l’on veut enfermer une femme, elles deviennent soudain un piège pour le bourreau. Les leitmotive discrets peuvent alors se regrouper pour suggérer une clé au lecteur – pourquoi, par exemple, les mouches suivent-elles une valise ?
De fleuve en plage, le livre suit son chemin malicieux, rebondissant sur des détails amusants, comme l’envie irrésistible de sectionner d’un coup de dent un nez trop aventureux : si Raymond retire la tête à temps, Alexandre se laisse prendre… On s’y amuse d’idées saugrenues, de développements fantasques, qui peuvent frôler le sadisme lorsqu’il s’agit de prendre à la lettre des clichés usés – le plaisir, par exemple, de « faire la peau » de jeunes filles de rencontre en les exposant aux coups de soleil, ou d’imaginer une femme aimée découpée vive comme une huître… Et tout à coup, une vision délirante échappe à un personnage : Natacha a trop souvent entendu qu’elle avait « un bœuf sur la langue » parce qu’elle se taisait trop souvent - « la pauvre Natacha restait coincée sur le canapé entre ces hommes sans pitié avec ce bœuf plein la bouche qui étirait de plus en plus vers la télé sa grosse tête aux yeux exorbités pour ne rien manquer de l’arrivée des coureurs ». Lequel bœuf finit d’ailleurs par renaître dans son ventre… On peut se débarrasser d’un importun en le déconnectant d’un seul clic sur les réseaux sociaux : « Avec le son électronique d’un insecte qu’on écrase, Tigre jaloux fut avalé par le néant. » Mais on peut aussi tuer à la mayonnaise, ou en exhortant un homme à s’avaler lui-même. Cette inventivité constante, qui utilise volontiers comme tremplin les pièges de la langue (procédé que l’on retrouve dans d’autres livres de l’autrice), constitue pour le lecteur attentif un régal permanent. Sans oublier, chers princes charmants, le plaisir délicat, renouvelé de recueil en recueil chez Corinne Hoex, de vous retrouver épinglés au tableau de chasse impitoyable de la romancière !
Voir aussi : Le ravissement des femmes, Décidément je t'assassine, Et surtout j’étais blonde. Les reines du bal.
Retour au sommaire
Fabienne Verstraeten, V ou la mélancolie, Arléa, 2023.
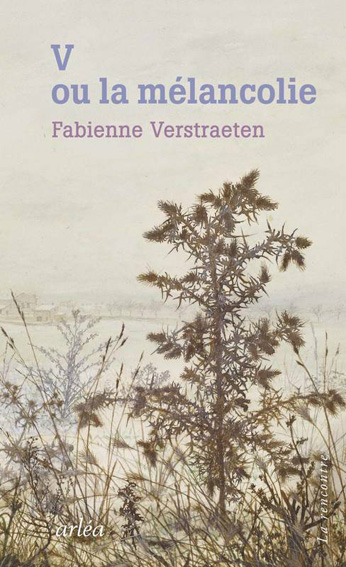
« C’est une ville du temps passé. Un instant de ville serti dans le cadre d’une photographie ancienne à peine plus grande qu’un timbre-poste. » Le télescopage de l’espace est du temps est d’emblée posé comme une des clés de ce récit. Après tout, ne parle-t-on pas d’instantané en photographie ? Le point de départ est en effet un cliché pris vers 1944-1945 représentant l’enterrement d’Aloïs Verstraeten, grand-père de l’autrice, héros de la résistance, suivi par la famille, dont le père de Fabienne Verstraeten, alors jeune homme. Sept décennies plus tard, ce dernier, ne supportant pas les diminutions de l’âge, se défenestre du Centre public d’Action sociale. Un geste auquel s’étaient décidés beaucoup de résistants, jadis, pour échapper à la torture et au risque de dénoncer des camarades de lutte. Le rapprochement temporel permet de faire éclater le cadre de la photographie, comme si l’on pouvait « appréhender le hors-champ de cette image, ce qui lui échappait, ce qu’elle ne disait pas. » D’échapper aussi au « roman familial », dont on connaît la part de fiction.
Car au-delà de la photographie il y a les témoignages, d’autres photographies, des souvenirs, et une lettre dans laquelle le grand-père incarcéré demande l’intervention d’un député rexiste. Tache sur sa mémoire ? Ruse pour faire passer la lettre ? Effroi bien compréhensible à l’approche de la mort ? Le fils du résistant ressentait cet appel à l’ennemi comme une honte. Mais il avait dépassé l’âge où son père a été fusillé et n’avait jamais connu des circonstances équivalentes. La petite-fille du résistant, l’autrice, à qui l’on accorde une certaine ressemblance avec son grand-père, en particulier dans le regard, s’interroge sur ces deux morts que séparent des décennies. La honte du héros implorant l’intercession, le courage du survivant refusant la déchéance ? L’un qui se couche, l’autre qui « se met debout une dernière fois » ? « Mon père était-il un héros ou un homme empli d’effroi à l’instar de son propre père ? Entre les deux, la légende familiale n’a pas tranché. »
La réponse est peut-être dans un autre regard, celui d’une petite fille anonyme, sur la photographie, qui voit la scène avec des yeux d’enfants et qui en ignore sans doute les circonstances et la signification. « Son visage exprime la curiosité candide et l’intelligence vive des enfants qui savent ce que les adultes ne disent pas et devinent que ce qui a lieu sous leurs yeux est empli de gravité. » Retrouver ce regard permet d’appréhender autrement le passé, dans une « contraction du temps » qui efface tout sentiment de honte ou de fierté. Des deux Verstraeten, Aloïs et André, elle ne retiendra que l’initiale, V, qui fut alors le signe de la Victoire.
Cette seconde partie du récit est pour moi la plus séduisante. La première, issue explicitement d’un atelier d’écriture suivi en 2016, est surtout un tremplin à l’imagination. Une description minutieuse de l’image, des souvenirs de jeunesse égrenés « à la Prévert » — choux à la crème en forme de cygne, saucisson de Paris, confitures de la grand-mère — se cantonnent à la sensation brute, à l’objectivité illusoire du fait. Les deux démarches ont leur légitimité et leur lectorat. Il n’est pas sûr cependant que ce soit le même.
Retour au sommaire
Michel Lambert, Cinq jours de bonté, L’Herbier – Le beau jardin, 2023.

« Il fallait faire attention où on mettait les pieds. Des bombes invisibles nous attendaient à chaque coin de rue, à chaque coin de la pensée. Je n’avais plus droit à l’erreur. » L’image rend bien l’angoisse permanente qui traverse ce roman. Le narrateur, Thomas Noble, a pour cinq jours la responsabilité de son épouse, Raya, en séjour dans une clinique psychiatrique où elle a été admise après une crise violente dont on ne connaîtra ni la cause ni les circonstances – juste qu’il ne s’agissait pas de la première, mais de la plus grave. Il va l’emmener à Ostende, où se tient précisément le Bal du Rat mort, pour tâcher de « rafistoler » leur vie brisée, d’effacer en une trop brève parenthèse des années d’erreurs et de malentendus.
Mais le rappel constant des bons souvenirs, les rires partagés, les plaisanteries y suffiront-ils, quand planent sur cette escapade la certitude de regagner la clinique et la crainte permanente d’oublier les médicaments ? Les couples amis qu’ils rencontrent contribuent-ils à retisser les fils ou, au contraire, aggravent-ils l’état de Raya ? Franck, « fêtard magnifique » alcoolique que l’on considère presque comme un frère, et Olga, qui se sent à la fois sa mère, sa fille, sa sœur, sa maîtresse, font presque partie de la famille, plus peut-être que le fils, Patrick, qui a fui l’atmosphère délétère de l’appartement pour étudier aux États-Unis. Jacques et Shirley rappellent l’époque des dépenses inconsidérées et des gamineries, un monde disparu que le narrateur sans emploi ne peut plus se permettre. Quant à Brice et Charlotte, les seuls amis que Raya aurait voulu revoir, ils sont écartés pour des raisons que Thomas n’ose avouer à sa femme.
Malgré les efforts de chacun et les moments de bonheur, les retrouvailles sont assiégées par une angoisse sourde et permanente, que le narrateur ne parvient pas à cerner dans des expressions évasives – une « frayeur subite et sans fondement », un sentiment d’impuissance (« Je ne maîtrisais plus ma vie, voilà tout »), de honte (« J’avais honte de l’homme que j’étais devenu »), de culpabilité (« C’était infernal de se sentir sans cesse coupable, de ceci, de cela, et de ceci encore, et de cela, de tout en fin de compte »). Rien de concret, apparemment, sinon l’impression de « se retrouver nu dans la main du malheur ».
Pourtant, les raisons ne manquent pas, ni les motifs de culpabilité. Thomas a bien des aveux à faire à Raya, qu’il distille tout au long du séjour pour ne pas l’accabler immédiatement par des révélations brutales. Leur amour est suffisamment solide. Les fautes récentes, les secrets que l’on doit cacher pour ne pas fragiliser son équilibre mental, sont tour à tour dévoilés, et pardonnés au fur et à mesure. Cela ne change rien au sentiment général. La faute est plus lointaine et obnubile le narrateur : « Je contemplais Raya en me demandant quel acte j’avais bien pu commettre de répréhensible ». Quels furent « la première humiliation », « le premier geste inapproprié » ? Ils ne seront évoqués que tardivement, et subrepticement, à travers la réaction qu’avait alors eue Raya…
Peut-être même n’est-ce pas un événement originel qu’il faut rechercher, mais un trait de caractère, un rêve inassouvi, « cette région de moi-même que je recherchais depuis si longtemps ». Peut-être est-ce le destin, tout simplement, qu’il faut accuser, dans une vie qui semble programmée « par le démolisseur en chef ou par nous, les petites mains, responsables sans le savoir de notre propre effondrement ». Ou peut-être la situation, qui contraint le narrateur à un rôle de « veilleur », censé veiller sur Raya pendant cinq jours. Cela le place en observateur, hors du champ d’action, et il ne manque pas d’apparaître comme un égoïste aux yeux de ses proches, qui ne sont pas au courant. Sa peur même d’intervenir dans le processus de guérison de sa femme le rend maladroit ; sa sollicitude peut être contre-productive quand Raya semble surtout avoir besoin d’être utile aux autres, à son fils éloigné, à l’ami en instance de séparation : « Il y avait si longtemps que je n’avais pas consolé quelqu’un » remarque-t-elle après avoir parlé à son amie. Voilà peut-être ce qui lui manque pour reprendre pied dans la vie. En fin de compte, c’est elle qui, tout au long du roman, semble presque normale, quand on s’inquiète de plus en plus pour la santé mentale de Thomas.
La lecture ne peut se fier aux propos du narrateur. De petits détails, tout au long du récit, attirent l’attention sur l’état intérieur des personnages, comme dans les tableaux de Hopper – l’un d’entre eux illustre la couverture – le cadre, les objets, renseignent sur les personnages énigmatiques. La maison rose que Thomas ne parvient jamais à atteindre au cours de ses promenades évoque la région inaccessible en lui-même. Le siège de la voiture avancé pour un autre passager suffit à concrétiser une infidélité. Le chapeau, un coûteux Stetson, sans cesse perdu symbolise une « addiction à la perte » dont Raya pourrait être la prochaine victime. Le Doppelgänger qui revient comme un leitmotiv – « l’homme qui me ressemblait » – reflète sa position de veilleur décalé de la situation qu’il vit. Le tableau – un Poliakoff – qu’il veut vendre et dont il ne parvient pas à se séparer résume ses sentiments contradictoires. Quant aux chiens qui forment comme un fil rouge tout au long du roman, ils semblent en épouser les contours : le chien imaginaire rappelle la période insouciante ; les chiens rêvés, la période d’angoisse ; le chien « galopant comme un dératé » sur une aire d’autoroute avant de rentrer dans la voiture de son maître évoque cruellement le retour vers la clinique de Raya…
Tout l’art de Michel Lambert consiste à nuancer les décors pour nous introduire dans les états d’âme des personnages. Le clapotis de l’eau dans la baignoire est tout à coup « comparable au chuchotement de l’âme, au murmure des arbres quand une brise infime traverse leur feuillage ». Le dénouement, qui reste ouvert à la sagacité, ou au bon vouloir du lecteur, n’ira pas plus loin que des interrogations qui ne sont même pas formulées – un collier de perles sera-t-il déposé dans la boîte aux lettres ? Où se rend un taxi ? Qui a frappé à la porte ? Le lecteur inattentif, ou optimiste, ne se posera pas même ces questions. Celui qui aura été sensible au leitmotiv le plus troublant – « La mort rôdait, la haine rôdait, le désir aussi rôdait » – aura le choix entre les hypothèses les plus contradictoire, avec cette lumineuse réponse en guise d’indice : « Je ne sais pas. »
Les romans et les nouvelles de Michel Lambert excellent à explorer ces blessures toujours suintantes dont on ne sait jamais si elles cicatrisent ou se rouvrent, les « très petites fêlures » de son premier recueil. Il porte ici cet art à son plus haut degré. Le destin hasardeux du couple est sans cesse déporté sur des éléments apparemment secondaires. Les « cinq jours de bonté » qui donnent son titre au roman font écho à une tradition du Bal du Rat mort, où l’on doit se montrer bon avec tous ceux que l’on croise. Telle serait sans doute la thérapie la plus efficace pour une femme malade de l’attention qu’on lui porte et qui ne rêve qu’à se sentir à nouveau utile aux autres. Ah ! s’ils pouvaient entreprendre ensemble « quelque chose de beau et de vrai, né de notre volonté à tous deux et qui nous dépasserait l’un et l’autre »… Leur tentative échoue sur un malentendu, la bonté gratuite n’étant décidément plus de notre monde. Mais elle se reproduit, avec des inconnus croisés dans la rue ou les couples amis. Et qui sait ? peut-être aura-t-elle réussi ? À moins que l’échec ne soit la vraie réponse ? « Après tout, il fallait bien que quelqu’un paie ici-bas pour le mal qui, comme le désir ou la mort, rôdait partout, sans trêve ni répit. » Chacun devra avoir sa lecture, et la modestie de se dire que ce ne sera jamais que la sienne.
Voir aussi : Le jour où le ciel a disparu, Dieu s'amuse, Le métier de la neige, Quand nous reverrons-nous ?, Le lendemain. Une touche de désastre. Le ciel me regardait. Quelle importance ?
Retour au sommaire
Arnaud Nihoul, Le témoin silencieux, Genèse, 2023
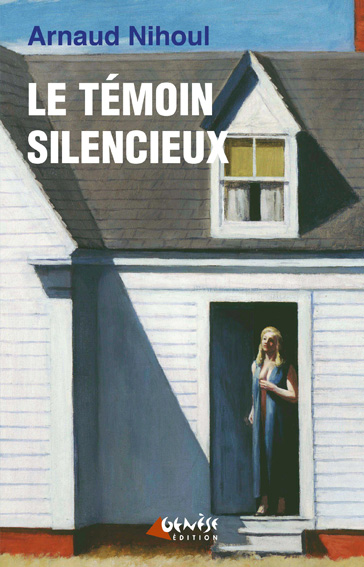
Trois toiles de Hopper ont été retrouvées par hasard dans une caisse destinée au retour d’une exposition annulée. Toutes les garanties ont été fournies. Elles ont été dûment authentifiées par les techniques les plus modernes, replacées dans un contexte historiquement certifié, avec une lettre autographe qui garantit l’envoi au galeriste, un carnet de la main du peintre qui en reproduit les contours... Aucun soupçon donc, mais un incroyable profit pour le galeriste qui a acheté le fonds pour une bouchée de pain… et un tout aussi incroyable manque à gagner pour l’État qui a insuffisamment taxé la succession.
Rien à voir, à première vue, avec des meurtres et des disparitions inquiétantes dans le milieu de l’art. Sauf que la disparue avait été représentée dans trois portraits où, étrangement, apparaissent des détails empruntés aux Hopper miraculeux. Cela n’échappe pas à sa fille, qui décide de mener sa propre enquête.
En dire davantage serait gâcher le plaisir du lecteur, dans une intrigue aux multiples rebondissements, construite avec autant d’ingéniosité que de connaissance du milieu. Quelques idées astucieuses maintiennent l’intérêt du lecteur tout au long d’une intrigue dont, assez vite, on devine le dénouement : celle, notamment, de retrouver grâce à Google Earth la retraite d’une artiste en cherchant dans ses toiles le coin précis qu’elle a représenté. Tout le long de cette enquête, chaque détail devra être scruté, documenté, comparé, raisonné… La contre-expertise et l’exploration des dessous du marché de l’art constituent sans conteste les points les plus attrayants de ce roman, jusqu’à la pirouette finale qui le fait rebondir lorsque l’on croit tout achevé.
Le genre bien sûr a ses règles, limitées, qui amenuisent quelque peu le suspense. Tout amateur de roman policier se doute qu’un cadavre disparu dans un accident n’est pas bien mort, que les toiles dûment authentifiées ne peuvent qu’être génialement fausses, que les deux jeunes enquêteurs qui refusent de s’engager dans une aventure finiront par se marier… L’essentiel n’est pas dans le faufil rouge de l’intrigue, dont le romancier semble se jouer par des clins d’œil subreptices au lecteur. L’usage parfois abusif des dialogues informatifs, qui accélèrent la lecture, et des coïncidences qui évitent les longs détours explicatifs, est malicieusement souligné de remarques ironiques qui mettent le récit en perspective : « Un sacré concours de circonstances ! », « La roue du destin continuait de tourner », « dingue ! », « une histoire sortant de l’ordinaire », « la première tentative fut la bonne », « vous avez eu de la chance sur ce coup-là »…
Il ne faut pas lire ce livre comme un roman policier classique, mais y chercher la complicité salvatrice entre le lecteur et un romancier rompu à son métier. Tout se joue dans les articulations du récit, que ce soit dans la contre-expertise méticuleuse ou dans les approches timides entre Julian et Kerry … Tout se joue aussi dans l’atmosphère, dans la description de New York — « cette ville était de l’énergie pure » —, dans l’évocation des milieux artistiques contemporains, avec leur générosité mais aussi leurs malversations, leurs supercheries. Il faut savoir distinguer les vraies audaces des gabegies de l’art éphémère, qui donnent lieu à de désopilantes évocations : des tôles rouillant dans un ruissellement d’eau, des sculptures en cire de bougie que plusieurs mèches allumées font lentement retourner au néant… C’est sur ce fonds en demi-teinte qu’éclate le génie de Hopper, dont les toiles structurent ce roman : il ne jugeait pas, mais observait et révélait, comme le « témoin silencieux » qui a donné son titre au roman.
Le roman, surtout, invite à réfléchir à des enjeux plus graves de notre époque, comme les rapports entre la majorité blanche et les populations autochtones des États-Unis. Superbe trouvaille, notamment, que ce musée inconnu, aboutissement de l’idéal de reconnaissance de l’art amérindien, où il peut enfin exercer son droit à côtoyer les autres grands artistes américains sans être considéré comme de l’art « ethnique ». Belle réflexion, aussi, sur la raison d’être d’un tableau, dans une galerie privée, un musée public, un coffre de banque ou un cabinet secret… « Finalement, dans la vente d’un faux, beaucoup y gagnent, seul l’acheteur perd. Je trouve le bilan largement positif. » Clin d’œil mis à part, cela porte à réfléchir…
Retour au sommaire
Patricia Castex Menier, Havres, Les Lieux-Dits, 2023.
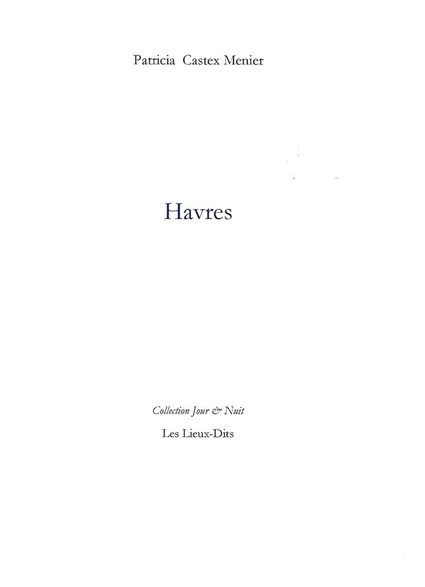
« Le bonheur n’existe qu’en détail. » C’est souvent l’apanage du poète d’épingler ces petites épiphanies du quotidien qui rendent le monde merveilleux, et — pour un instant précieux — supportable. « Où / va se nicher la merveille ? » Partout, mais en particulier là où on ne l’attend pas. Elle ne survient qu’à l’improviste, dans une rencontre subreptice entre un détail bien ordinaire et le regard qui l’épingle, les mots qui le magnifient. Les oiseux, surtout, sont privilégiés, du corbeau aux colombes, du bec du moineau à la tache blanche au cou du ramier. Et le poème surgit lorsque l’écorce du bouleau semble avoir la chair de poule…
« Personne
ne connaît jamais
le
monde entier. »
Il reste toujours le détail à débusquer où « frotter l’allumette du regard ». Cette complémentarité entre le voyage, les grands espaces, et le petit miracle quotidien traverse plusieurs recueils de Patricia Castex Menier — on songe à Cargo, notamment, où le dépaysement du voyage rend précisément plus sensible à ces impressions fugitives.
Bien des poètes s’en tiennent à ces émerveillements. Mais ce recueil prend une tout autre dimension par son titre, par des passages en italiques plus douloureux, par des images plus inquiétantes. Oui, ils existent, ces moments privilégiés, où le regard soudain s’élargit à l’univers par la magie d’un détail, mais ce ne sont que des « havres » dans le parcours chaotique de l’existence. Plus souvent, « on dirait que le monde rétrécit. Il se crispe. » C’est alors qu’il faut carguer la voile — « Havres pourtant, dans l’anse du jour ».
Ne nous étonnons donc pas de voir le bonheur assombri de nuages. Chaque matin, après l’émerveillement de l’aube, on reprend le large, même s’il ne s’agit pas de traverser le monde (« les / voyages tiennent dans la main »). Il faut quitter le havre, reprendre « le / baluchon de l’inquiétude » lié avec « le / nœud de l’angoisse ». Les « événements du cœur » viennent colorer différemment le ciel, parlent plus fort que l’exaltation éphémère (« L’enthousiasme / est discret »), et masque le mirage sous la routine du voyage – combien de fois avons-nous oublié d’applaudir devant le soleil qui se lève, se couche et recommence ?
Apercevoir le havre où se ressourcer demande une vigilance aiguë. Et c’est à deux, souvent, que l’on aiguise son regard : « nous / n’omettons jamais // d’entrer / ensemble et tout entiers // dans le frisson rosé du cerisier. » On songe bien sûr à Accoster le jour, où Patricia Castex Menier a partagé le voyage avec Sylvie Fabre. Mais aussi aux recueils, parallèles ou communs, partagés avec Werner Lambersy, à Delphes, en Andalousie... La traversée à deux, la quête de nouveaux havres est une aventure privilégiée. Mais si fragile, lorsqu’on peut renverser « d’une simple chiquenaude » l’arbre du corps, lorsque « d’une pichenette » on refait sa vie. Ces poèmes ont été composés et partiellement publiés entre 2017 et 2021, avant que le couple ne soit brisé par la vie. L’ombre du deuil se sent déjà dans les passages en italiques, avec ses réalités brutales (« les insectes, les larves, les fluides. Ne pas y songer plus que cela ») et sa quête opiniâtre du havre (« Mais combien de temps / faut-il pour maquiller les morts »). Il faut alors s’appuyer sur la mémoire (« se dire que nous avons été heureux ») pour que le monde à nouveau s’élargisse et que le recueil puisse s’achever sur un espoir nouveau (« attendant confiants qu’accoste la clarté »). Il y aura toujours des tempêtes, mais toujours l’espoir du havre.
Voir aussi : X fois la nuit, Passage avec des voix, Suites et fugues, Le dernier mot, Soleil sonore, Adresses au passant, Bouge tranquille, Al-Andalus. Chroniques incertaines. L'insinct du tournesol. Accoster le jour. Cargo. Contre-jours.
Retour au sommaire
François Emmanuel, Le cercle des oiseleurs, Les impression nouvelles, 2023.
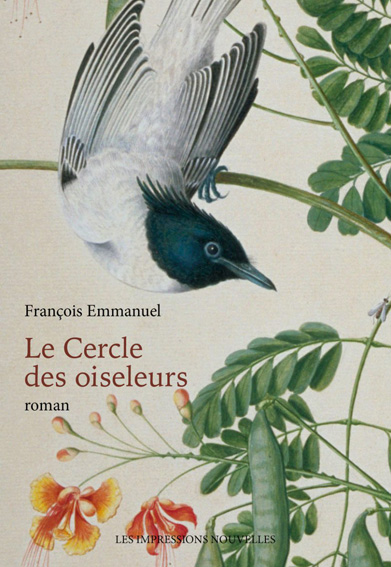
« On voit ce que l’on croit voir, on vit une vie tranquille, et puis un jour le monde n’est plus tout à fait le monde. » C’est cette expérience que vit Léo Vogel, le narrateur, lorsqu’il est impliqué malgré lui dans la disparition d’un collègue. Léo travaille au service « Missions, C/S, Pay Master Office, Contrôle et Budgétisation » au sein d’une grande institution internationale, sous les ordres de Charlie, qui prend sa retraite dans les premières pages et disparaît dans les suivantes, au cours d’une virée bien arrosée avec son ex-collègue.
La disparition est le discret leitmotiv de ce roman. « J’ai l’esprit qui part en fuite », avoue le narrateur ; de fait, les procès-verbaux dont il a la charge connaissent par moments de déplorables lacunes qui lui coûtent sa place — comment ne pas faire le rapprochement, quelques dizaines de pages plus loin, avec le chant du rossignol, dont « certains segments sont désormais manquants » ? L’univers des oiseaux, qui donne son titre au roman, semble souvent le reflet imagé des aventures qui arrivent au narrateur.
Son métier, donc, consiste à rédiger les procès-verbaux institutionnels destinés à être traduits dans toutes les langues avant d’être enfouis dans les archives. Mais « qu’est-ce qu’y est important au fond, qu’est-ce qui mérite d’être écrit, et, en vrai, pourquoi l’écrire ? » La question se pose au rédacteur de comptes rendus inutiles, mais elle concerne aussi tout romancier responsable… Ironie du destin (ou du romancier) : suite à une série d’inadvertances, de « trous de la vie », Léo est muté de poste en poste et d’étage en sous-sol jusqu’à se retrouver au service des archives, où il est chargé « d’éliminer les dossiers non banquables », en fait de broyer tous les textes devenus obsolètes dans une machine infernale nommée Deletor-Nexa…
Cette disparition du texte est à mettre en parallèle avec celle de Charlie, le collègue admis à la retraite, qui constitue la trame du récit. Avec celle des oiseaux, qui en constitue la chaîne. Et, plus largement, avec la société de l’oubli qui est la nôtre et où tout est voué à disparaître. Ici non plus les choses ne sont pas tranchées ; il s’agit d’une « disparition sournoise, comme un principe d’absence » qui s’insinue jusque dans les mots que le service du narrateur est chargé de noter, de commenter, de traduire… En somme, une société du « rien », sur lequel Charlie a entrepris un livre. Quant à Léo Vogel, il est assailli par des rêves où intervient une machine à désécrire…
Nous suivons donc l’histoire d’un homme qui disparaît alors qu’il écrit un livre sur rien : autant dire que ce roman n’a rien d’une enquête policière, même s’il en adopte la forme — voire, par moment, celle du roman d’espionnage où l’on s’offre des oiseaux « pucés » ! Car la disparition de Charlie est liée à sa participation à un étrange « cercle des oiseleurs » qui n’a rien d’un club ornithologique, et dont l’activité reste nébuleuse pour ses membres eux-mêmes. Liée aussi à un non moins étrange trafic d’oiseaux dont le réseau est d’autant plus obscur qu’il est décrit par femme de ménage albanaise dont le français approximatif nous vaut de succulentes confusions, ainsi que par une « joyeuse petite tante » inspirée, dont les prophéties n’ont rien à envier à Nostradamus, sans oublier le livre de Charlie et ses inquiétantes mises en garde — « méfie-toi de ce qu’ils mettent à la place du ciel »…
On comprend peu à peu que la préoccupation centrale du cercle des oiseleurs, la disparition inéluctable des oiseaux, cache une disparition plus fondamentale, dont le romancier ne fait qu’évoquer le malaise, mais dont l’autre symptôme est la disparition de la poésie. Le cercle est la traduction métaphorique de ce malaise. L’archiviste de la société ne professe-t-elle pas que « nous avons tous en nous un grand nombre d’oiseaux » ?
Milles petites anecdotes, la plupart véridiques, viennent nourrir ce malaise. Celle du xénique de Lyall, un oiseau dont tous les spécimens ont été croqués par le même chat, le temps qu’une revue savante s’y intéresse. Ou celle du Méridien d’Amwich, où vivait un oiseau qui n’est plus connu que par les dessins d’un ornithologue atteint d’une cécité montante. Toutes ces histoires invraisemblables, ces questions oiseuses, ces « réponses vaseuses marquées du sceau de l’incertain » par tous ces « allumés de la touffe » réunis dans un cercle aux contours impalpables, dessinent un autre regard sur le monde. « On pourrait dire que le bizarre se définit comme un trou dans la logique des choses, et on pourrait dire aussi que c’est par ce trou que s’introduit le bizarre. » C’est par ce trou en tout cas que disparaissent les personnages, les oiseaux, les mots. Pour aller où ? « On aime ignorer combien les trous de la vie ouvrent des espaces insoupçonnés. » C’est en cela que ce roman, aux accents parfois apocalyptiques, contient paradoxalement une leçon plus optimiste. Comme dans l’apocalypse chrétienne, qui voit dans la disparition du monde matériel la condition du dévoilement d’un monde spirituel, la disparition ouvre ici sur autre chose, « des espaces insoupçonnés ». Sans doute est-ce pour cela que le roman se conclut (provisoirement) sur de petits textes entre poésie et récit, qui omettent significativement le point final mais qui n’omettent pas de longs blancs en bas de page.
La disparition, en définitive, est peut-être une chance : celle de trouer la carapace du monde, celle de nos habitudes qui nous empêchent de voir au-delà de notre culture. Comme pour l’apocalypse, il y a alors un dévoilement. Et pour l’écrivain, la question cruciale est bien sûr celle des mots, qui révèlent et mutilent le monde. « Les mots de la mémoire nous empêchent de voir », souligne furtivement une disparue qui pourrait détenir la clé de l’intrigue. Regarder un oiseau, par exemple, c’est tâcher de le voir comme si c’était la première fois, ce qui est très difficile, car le regard se souvient. C’est pour cela que, pour devenir oiseleur, il y a « beaucoup de choses à désapprendre ». Et pour l’écrivain qui ne veut pas se limiter à être « un mauvais bougre fumailleur » quoique auteur à succès, il y a toute une langue à détricoter pour nous faire atteindre une autre réalité. Si l’homme est parfois en équilibre instable, ainsi, ne nous étonnons pas que l’ivrogne se retrouve parfois « en déséquilibre stable ». On voit tout de suite de quoi il s’agit, et on ne s’étonne plus qu’un tramway nommé Silence geigne de tous ses fers !
Voir aussi : Les murmurantes, Le sommeil de Grâce, 33 chambres d'amour, Jours de tremblement. Anna et ses ombres. Raconter la nuit.
Retour au sommaire
Werner Lambersy, Mes nuits au jour le jour, Météor, 2023.

Deux pôles focalisent souvent les poèmes de Werner Lambersy : le minuscule et l’infini, le dérisoire en apparence et le rêve méfiant de l’absolu, le jour et la nuit… Non seulement rien n’oppose ces univers censés contradictoires, mais le poème, comme un courant, les conjugue dans une même vision, dans une même image. Attentif à la « beauté furtive », il s’attache à la traduire en une formule lumineuse qui nous la rend soudain indispensable : « À mes pieds / Les pigeons énervés / Boursicotent » — « Les fleurs sont des arrêts d’autobus / Facultatifs ». Aucun maniérisme dans ces images, qui n’ont rien de gratuit, qui nous frappent au contraire par leur évidence, presque leur nécessité, et qui nous élèvent brusquement vers des espaces insoupçonnés. Nous goûtons au « pain bis de l’absolu », nous écoutons « Le concert / De criquets des étoiles », nous regardons s’élancer, entre la poussière sous nos pieds et l’azur au-dessus de nos têtes, le « Paisible / Rhizome entre ciel / Et terre ».
Le lien qui se tisse entre l’homme et le cosmos est d’ordre familial. Il s’établit au fil des pages, au détour d’un vers — « l’arbre aurait pu être mon frère » — « la terre ma mère » — « Le soleil comme moi »… Il passe par les cinq sens, « le frisson / De chair de poule des nuits », « Les baisers sur la bouche d’ombre » ou « le goût de mangue du monde ». Des sens dont le réveil est impératif — « Le premier / Des commandements est l’odeur ». Des sens intérieurs plus subtils peut-être que les sens extérieurs : « Quand je dors / Je regarde plus loin / Que mon œil // Quand je dors / Je regarde plus près / De mon âme // De cette lumière qui / Ne s’éteint / pas ». Voilà pourquoi la nuit est le domaine privilégié du poète — faut-il rappeler le magistral Architecture nuit, ou le clin d’œil d’Échangerais nuits blanches contre soleil même timide ? L’obscurité qui semble nous priver du monde en découvre la structure invisible. « La nuit n’est jamais fatiguée / D’être la nuit », ni le poète d’y regarder la doublure des choses.
Bien sûr, tout n’est pas si simple, et surtout pas si rose. Le mal est dans l’homme et il contamine le monde. « L’univers n’est que meurtre » : la révolte, la dénonciation ont toujours été présentes dans les recueils de Werner Lambersy et semblent s’être accentuées dans les dernières années. Aucune échappatoire pour celui qui subit les coups du temps — « La vieillesse n’offre aucune sortie / De secours » — et pas même d’espoir dans les générations à venir — « Le futur / Est venu au monde trop fripé ». La rage continue à l’animer contre tout ce qui menace, détruit, anéantit ce dialogue primitif entre l’homme et le monde. Comme Till Eulenspiegel répétant inlassablement que les cendres de son père battent sur sa poitrine, Werner Lambersy nargue hommes et diables : « Les cendres de Liberté / Battent sur mon cœur ». Car dans un univers où tout est inextricablement emmêlé, le mal et le bien se renvoient la balle. Et la beauté, qui nous réconcilie avec le monde, croît dans la fissure comme le lierre s’accrochant au mur. Cela ne justifie en rien le mal et n’absout pas celui qui l’apporte. Mais cela permet d’y survivre. « La beauté réside dans la faute / Qui a provoqué sa fuite // Le goût incomparable / De la défaite en devient le prix ». Paradoxe assumé. Illusion ? Peut-être. Mais nécessaire pour continuer à vivre.
Jusqu’au moment où ce n’est plus possible. On ne peut lire ce recueil sans penser que le poète nous a quittés voici un an et demi et que ces textes ont été écrits dans la conscience d’une fin proche. La mort hante ces pages, les amis disparus y sont convoqués comme dans l’imminence de les rejoindre, des plus lointains, la mère, la grand-mère, aux plus récents, Marcel Moreau, Jacques de Decker, en passant par les proches, André Beem, Léo, Babette. Qu’ont-ils à dire à l’athée, même provisoire (« Sans dieu je suis seul / Dieu n’est pas ») ? Peut-être qu’ils restent parmi nous tant que nous pensons à eux et que nous entendons « L’écho de notre rire dans l’au-delà ». Peut-être que, si la nuit ouvre à l’envers du monde, la grande nuit nous ouvrira sur d’autres perceptions.
« Un jour
On va me dire c’est fini
Mais je ne pourrai pas
L’entendre
Je serai à l’écoute de
L’infini
Pour savoir
Le bruit que cela fait
Quand on a des ailes
Pour battre
Le beurre des temps »
Peut-être. Mais c’est sur ce peut-être que nous construisons la vie.
Retour au sommaire
Voir aussi : Parfum d'Apocalypse, Journal par-dessus bord, Cupra Marittima, À l'ombre du bonsaï, L'assèchement du Zuiderzee, Le mangeur de nèfles, Déluges et autres péripéties, Dernières nouvelles d'Ulysse, La perte du temps, Escaut ! salut, Ball-trap, La chute de la grande roue. Départs de feux, Bureau des solitudes, La déclaration, Du crépuscule des corbeaux au crépuscule des colombes, Al-Andalus, Achille Island, Au pied du vent. Le Grand poème. Ligne de fond. Le jour du chien qui boîte. Entrées maritimes. L'Agendada (3). Memento du chant des archers Shu. Table d’écoute, Les convoyeurs attendent, Et plus si affinités, Dormances.
Gabriel Ringlet, La blessure et la grâce, Albin Michel, 2023.
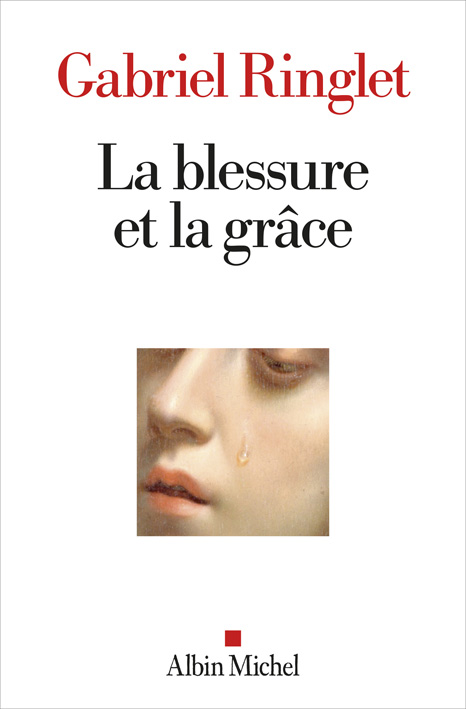
« Joie, les hérétiques, leur foi sera plus légère. » Cette traduction audacieuse d’une des huit béatitudes, reprise et commentée en « Finale » de ce livre, mérite d’être mise en exergue, tant elle résume bien la conviction de l’auteur que l’évangile n’est pas achevé et que chaque époque doit le reprendre par des « traductions stimulantes », la confrontation avec l’actualité, les créations des artistes. La démarche est nourrie d’une foi sincère, mais dépasse le propos religieux et donne envie à l’athée non pas de croire ni de rejoindre une église, mais de saisir la main tendue par-delà les différences, avec, et non malgré les différences.
Le livre s’enracine dans l’ancien Testament, brièvement, le temps d’une « Ouverture » qui évoque les Lamentations jadis attribuées au prophète Jérémie, un texte d’une brûlante actualité dans ces temps agités que nous vivons et que le prophète a connues lors de la destruction de Jérusalem et la déportation à Babylone. Surtout, ces poèmes, parmi les plus beaux de la Bible, jettent un pont audacieux entre passé, présent et futur : « Voici que je vais me remettre en mémoire pourquoi j’espérerai. » Et ils invitent au dépassement de l’écriture auquel aspire Gabriel Ringlet : « Les bontés du Seigneur ! C’est qu’elles ne sont pas finies ! C’est que ses tendresses ne sont pas épuisées ! »
Dans les évangiles, c’est l’Esprit saint descendant sur les apôtres à la Pentecôte qui assure cette ouverture de l’écriture. Depuis toujours, c’est le troisième âge de l’Église, celui qui aurait dû ouvrir un « troisième Testament », l’évangile éternel dont rêvait Joachim de Flore et dont Gabriel Ringlet n’est pas loin. Le « successeur » du Nazaréen pour lui n’est pas Pierre, mais ce « Souffle sacré » qui deviendra « un nouveau Défenseur au barreau de l’Évangile ». « Sa respiration inspire et jette un pont entre le temps de l’oralité et celui de l’écriture. Et c’est lui, ce nouvel Avocat sans frontières, qui va se tenir à nos côtés sous toutes nos latitudes. »
Sur ces bases, soixante courts textes répartis en huit chapitres, nombre christique, commentent une phrase tirée d’un évangile à la lumière d’un événement actuel et la raccrochent à l’évocation d’un écrivain récent. Sans quitter Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous allons ainsi côtoyer Stromae, Sôseki, Peter Handke, Jean Sulivan, Georges Haldas ou Salah Stétié. L’auteur y puise quelques réflexions puissantes, quelques formules fortes, comme l’évangile du gitan de Jean-Marie Kerwich ou « l’ennemi revêtu de ma propre chair » de Bernanos.
Le second axe de sa réflexion est la confrontation des paroles sacrées avec le quotidien d’un prêtre humaniste et engagé dans l’action sociale la plus concrète. Jésus devient sous sa plume une figure presque familière. À Nazareth, les anciens se réjouissent de voir un jeune prendre la relève, avant de s’effrayer de ses propos… Combien de responsables associatifs n’ont-ils pas connu cet espoir vite refroidi faute d’avoir su miser sur l’avenir et non sur la perpétuation du passé ? Ce livre parle d’abord de notre monde, du confinement, de la guerre en Ukraine. Et de l’incompréhension, des tensions, des haines. « Quelle actualité ! Élargir le prochain. C’est insupportable à l’heure des rétrécissements identitaires et des nationalismes. Alors, on le gifle. » Au gré des courts chapitres, nous allons donc revivifier un texte malencontreusement sacralisé, par la lettre d’une patiente hospitalisée ou par une annonce nécrologique. Nous renverserons quelques analyses hâtives. Les clarisses de Malonne, en accueillant la compagne de Dutroux, « ont posé un acte strictement laïque » alors qu’elles se sont vues « lynchées avec violence au nom d’un faux sacré ».
Cette actualisation du texte passe par celle du langage. Les formules sont parfois osées : « Marthe s’énerve et perd un rien les pédales » ; pour commenter « Augmente en nous la foi », Gabriel Ringlet se demande quelle sicav Jésus conseillerait pour augmenter notre capital croyance… On sourit, on se laisse convaincre. Pour « déblayer la pensée », il faut d’abord déblayer le langage, et l’on finit par déblayer la célébration. C’est sans doute le côté le plus stimulant de ce livre. Lorsque Jésus touche le lépreux, malgré l’interdit, « c’est le pouvoir religieux lui-même qui est touché, en plein cœur. »
Ne nous y trompons pas, pourtant. Ce livre, engagé, ne se veut pas militant. Son titre emprunte à la pianiste Hélène Grimaud la conviction que l’artiste, conscient de sa blessure, en fait une grâce. Telle était l’action de Jésus, nous dit Gabriel Ringlet. Il ne s’accommode pas de la blessure : il l’apaise, la panse, « et même si elle continue à couler, il en fait une grâce ». La conviction est forte et contagieuse, lorsqu’elle est sincère, et c’est le cas. La grâce peut naître de la blessure, comme une conséquence, non comme un but. La frontière est étroite entre les deux attitudes. « Pour hériter il faut s’endeuiller et traverser l’épreuve de la perte », lit-on. Oui, sans doute, car il n’y a pas d’héritage sans deuil. Mais l’héritage n’est pas un but en soi. « Hériter, c’est-à-dire renouveler, inventer et pas simplement répéter » : sans doute, puisque le renouvellement suppose une transmission. Mais ce n’est pas un but, c’est une conséquence.
Je ne fais pas de faux procès. Le grand mérite de ce livre est au contraire d’appeler constamment à remettre en question ses certitudes, et il commence par lui-même. Dresser des cabanes pour la fête de Soukkhot, c’est « oser quitter son enracinement, sa stabilité », « se libérer intérieurement, pour se renouveler, pour s’ouvrir davantage à l’Autre ». Traverser l’épreuve n’est pas une fatalité, mais lorsqu’elle est là, il faut bien la surmonter. Le père Bacq atteint d’un cancer de la gorge demandait à ses visiteurs s’il pourrait reparler. Un seul lui a répondu : « Je ne sais pas si tu pourras reparler, mais ce que tu vis maintenant, comme tu le vis, nous aide pour le jour où nous serons nous-mêmes en difficulté. » La voilà, la grâce de la blessure. Non celle qui s’abaisse pour s’élever, mais celle qui prend appui sur son abaissement, comme Ève Ricard dansant « sur le chaos de son Parkinson ». C’est dans ce chemin étroit entre le sacrifice consenti et la force de résilience que l’auteur nous engage. « La Transfiguration n’est pas une invitation à choisir l’exceptionnel mais un encouragement à regarder l’ordinaire autrement. »
Les évangiles constituent une assise solide pour ces réflexions. Mais ils contiennent aussi des « versets sataniques », contre lesquels l’esprit humaniste se heurtera toujours. « Autant le dire tout de suite : je n’aime pas ce verset », ose parfois l’auteur. Que faire des versets de violence et de division, les « décalages horaires » que l’on y rencontre parfois ? Certains parlent de calculs mesquins des apôtres, qui n’ont « vraiment rien compris », mais certains sont de Jésus lui-même, qui aime provoquer ou qui, tout simplement, est conforme à son époque, qui n’est pas la nôtre. « Pas la paix, mais le glaive », peut-il trancher. C’est lui aussi qui encourage le trafiquant indélicat, comme s’il nous disait « Ne traînez plus ! Jouez votre va-tout ! Faites-vous des amis avec l’argent malhonnête ! » Le commentateur lucide doit alors être sincère avec ses convictions. « Inutile de tourner autour du pot, d’adoucir, d’atténue, de relativiser. Il y a dans l’Évangile des paroles insupportables. »
Pourtant, ces textes, ils existent, il faut bien « les porter en soi, comme une écharde dans la chair. » Parole de croyant sincère, que l’on respecte. Mais combien de prélats s’en sont servis pour asseoir leur pouvoir, écraser, réprimer, s’enrichir au détriment de leurs ouailles ? Peut-on l’oublier, accepter à son tour l’iniquité justifiée par l’Écriture comme une nouvelle écharde, qui grossit de siècle en siècle ? Peut-on, comme les jésuites chiliens, accueillir tour à tour l’aumônier de l’armée et un ancien prisonnier du dictateur ? L’enjeu « est d’aimer en chacun le versant tourné vers Jésus », commentent-ils, et l’on comprend que cela puisse séduire. Mais peut-on s’ouvrir à l’autre, jusqu’à ce qui nous révulse le plus en lui, simplement parce qu’il nous renvoie le même reflet de Jésus ? Non, cela ne me paraît pas supportable si ce « Jésus » commun est le reflet d’une foi qui excuserait les pires atrocités. À ce « jésuitisme » trop facile je préfère l’appel du finale, « Osez une foi qui n’est pas encore dite » — en y ajoutant : même si elle n’est pas le reflet d’une croyance. Joie, l’hérétique. Et joie, l’athée.
Retour au sommaire
Voir aussi : Effacement de Dieu, La grâce des jours uniques. Va où ton cœur te mène. Des rites pour la Vie.
Gilles Verdet, L’arrangement, Éditions in8.
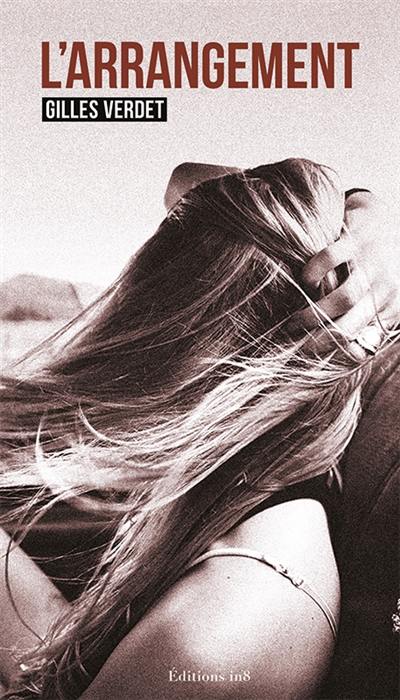
« C’était pas l’idée de départ, mais paraît que les intrigues des vrais romans s’inventent chaque matin et s’écrivent sur le tas. » Le principe semble à l’œuvre dans le nouveau roman de Gilles Verdet. Il y a bien une situation de départ, désespérément banale, malheureusement : après une faute professionnelle grave, Amandine, une caissière d’hypermarché, se voit proposer par son DRH un « arrangement », sous la ceinture, bien entendu. Avec la narratrice, vendeuse au rayon poissonnerie, elle décide de se venger et enlève le salopard. Mais qu’en faire, à part le balader à travers la France dans un coffre de voiture ? Chaque étape invente ses aventures.
Roman picaresque en pleine crise des Gilets jaunes ? Pas seulement. « Les petites joies de la vie, c’est la conjonction des bizarreries. La collision d’incongruités. » Et les collisions ne manquent pas. À chaque fois, elles font mouche. D’abord, parce que tout semble guidé par le hasard — « au hasard du hasard » risque-t-on même devant la roulette du casino, symboliquement le premier lieu de liberté que découvrent les deux vendeuses. Mais ce hasard fait bien les choses. « L’arrangement » proposé au départ par le DRH et qui va donner son titre au roman se répète à chaque étape, et la réponse est invariable : pas de concession. Deux mondes se côtoient et s’affrontent tout au long du récit. Le vieux monde, celui des arrangements qui, toujours, profitent au plus fort, et celui de l’intransigeance qui balaie du bras (armé, bien entendu) les offres de compromis. Les gilets jaunes, victimes du système qui les écrase, symbolisent bien ce refus de la concession dans laquelle Amandine et la narratrice semblent au départ se résumer. Le féminisme dur que pratiquent les deux jeunes femmes ne laisse aucune chance aux hommes — « une femme n’est jamais aussi l’égale de l’homme qu’avec un pistolet en main ». La revendication de liberté est totale et sans réserve. Elle s’exprime en envolées convaincantes : « l’absence de peur et d’oubli, la plus jouissive émotion du monde, l’oubli du lendemain, de toutes les heures et tous les autres jours à venir » traduisent chez les deux fugitives l’urgence de jouir et de rattraper les arriérés de la vie.
Mais au fur et à mesure de leurs pérégrinations, on comprend qu’une troisième voie est possible entre arrangement et intransigeance : la subversion. De même qu’on investit les clichés pour leur faire cracher leurs vérités, on peut vaincre le monde des arrangements en retournant ses armes contre lui. Des féministes peuvent s’indigner d’être considérées comme des femmes « fragiles, ingénues aux idées sages », mais cela leur permet de passer les barrages de police avec un prisonnier dans le coffre et un revolver dans le sac à main. Et la merveilleuse pirouette finale montre l’habileté de nos comparses à profiter du système dont elles ont percé les rouages.
C’est en cela que le roman est plus subtil qu’une première lecture le laisserait penser. Si la structure qui le sous-tend semble se construire au fur et à mesure, elle n’en est pas moins solide. Les rencontres sont significatives pour celles qui les vivent, comme les hasards objectifs de Breton frappent les esprits préparés : dans les ports, la vendeuse de poissons se retrouve « à l’origine de la chaîne », en ciré jaune, quand elle est pour sa part « le terminus en tablier bleu ». Les gilets jaunes qui provoquent le licenciement d’Amandine deviennent à la fin sa nouvelle famille. Les liens qui se tissent entre hasard et nécessité narrative font de la vie un scénario, ce dont les deux fugitives prennent conscience en rencontrant (hasard ? nécessité ?) un scénariste et ses collaborateurs. La distorsion (ou les petits arrangements ?) entre la fiction à la mode et la réalité vécue les frappe aussitôt. Elles ne voient que « des plumitifs en bottines, des chieurs de rêve et des pisseurs d’illusion » qui attendent d’elles des anecdotes vécues sur la banlieue, mais conformes à leurs stéréotypes « Ils voudraient qu’on parle de viols, de tournantes, de prostitution forcée. Ah les cons. »
Et c’est par la fiction biaisée qu’elles vont pénétrer la mécanique sociale et comprendre comment elles peuvent en profiter. Un doute s’insinue en elles sur ce qu’elles vivent, sur la place qu’on leur alloue dans le décor : « La fiction, c’est nous ou les autres ? Qui va inventer la suite ? » Quant aux comparses, ils se réduisent à des personnages sans épaisseur, comme le policier qui arrête la narratrice : « son rôle est écrit, scénarisé depuis toujours, clichetonné dès l’invention du cinéma de genre. » Alors, pourquoi ne pas écrire soi-même la suite de son histoire ?
La construction subtile des romans de Gilles Verdet est un des principaux plaisirs qu’il nous réserve. Ce n’est pas le seul. Il a le chic d’évoquer une atmosphère en quelques phrases, l’émulation de Noël, l’activité des ports, une manifestation épique de gilets jaunes à Marseille, ou un incroyable concert de Bach au milieu de la foule. Une pointe de culture (des références aux saturnales ou au charivari médiéval) vient pimenter le parler populaire qu’il adopte avec gourmandise. Chaque page fourmille de formules éloquentes et surprenantes, dignes de Michel Audiard : « Le café avait le goût ordinaire du carton », « elle boitait un peu de la tête », « les clins d’œil du passé, c’est des sacs de rigolade en réserve »… et ma préférée : les « pantouflards du béret ». Hérité d’Audiard, aussi, l’art de dériver des formes verbales des substantifs les plus inattendus — ah, le fameux « je correctionne plus » des Tontons flingueurs… Ici, on entracte, on s’enfleure les bronches, on s’écharpe le cou et s’embonnette de laine, on ultimatume, et l’on entend presque la voix de Bernard Blier : « je décris, je détaille, j’anecdotise et je circonstancie tout depuis le début »…
Retour au sommaire
Voir aussi : La sieste des hippocampes, Voici le temps des assassins, Fausses routes, Les Ardomphes. Nom de noms. Les passagers. African Queens.
Daniel Mesguich, Philippe Bouret, Le Spectre du théâtre, Bouquins Essais 2023.
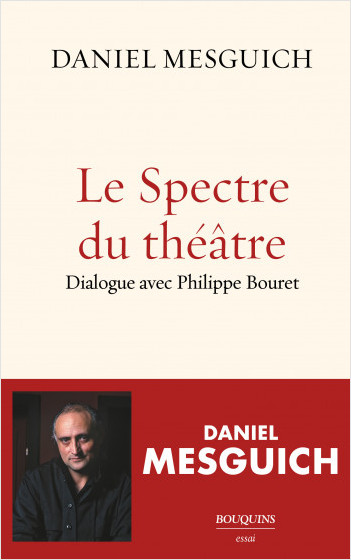
« Être artiste, c’est […] aller forer […] le plus profondément possible ce qui n’existe pas — gigantesque nébuleuse qu’on appelle “la réalité” — pour en rapporter telle “chose” “à la surface” et la faire exister lisiblement pour soi et pour les autres. » Ce passage d’un dialogue d’une richesse et d’une densité extrêmes met le doigt sur une des convictions fondamentales autour de laquelle il s’articule : le vide, le néant, l’inexistence ontologique de ce qui nous apparaît comme « la réalité ». Tout en écartant le mot qui définirait le mieux son attitude, mais dévalorisé par ses emplois religieux et profanes — « mystique » — Daniel Mesguich s’en remet plutôt à la déconstruction de Deridda, l’auteur le plus souvent cité avec Hélène Cixous, Heidegger ou Hannah Arendt (auquel j’ai plaisir d’ajouter Werner Lambersy, qui revient très fréquemment dans la bouche de son interlocuteur, Philippe Bouret).
La démarche, commune au poète, au romancier (bien des points sont très proches des pratiques de la Nouvelle Fiction) ou au dramaturge est plus familière au théâtre depuis le Paradoxe du comédien de Diderot, qui rappelle que si le comédien peut endosser tous les rôles, c’est parce qu’il s’est vidé de ses passions. On ne peut accueillir le tout qu’en n’étant rien, évidence qu’avait dans un autre domaine suggérée maître Eckhart (le mot « mystique » me fait pour ma part moins peur qu’à Daniel Mesguich, pourvu bien sûr qu’elle soit athée...) : le vase ne se remplit que s’il est vide et tourné vers la pluie. À tel point que Marc Goldschmit, qui préface le recueil, souligne que « Mesguich déplace sur le personnage quelque chose du paradoxe du comédien formulé par Diderot ».
C’est exact, à ceci près que la déconstruction que le metteur en scène opère va beaucoup plus loin. S’il professe qu’« un personnage, ça n’existe pas », puisqu’il n’est qu’un être d’encre et de papier comme la pipe de Magritte n’est que de toile et de peinture, on comprend vite qu’il en va de même pour l’acteur, l’auteur, le metteur en scène et, au fond pour « tous ces mots encore sacro-saints pour les gens du théâtre », la situation, le contexte, l’incarnation. Un comédien peut-il incarner un personnage, comme le proclament les affiches et les services de presse ? « “Entrer dans la peau du personnage” (quelle horreur, mon Dieu, quelle abominable opération frankensteinienne ! Entendez-vous craquer les cartilages ? » Si De Niro explique qu’il a dû grossir pour incarner un homme obèse, va-t-il se couper le bras pour incarner un manchot ? Le théâtre ne montre que « la possibilité du vrai ». C’est le rôle du metteur en scène, de diriger une brune jusqu’à ce qu’on voie aussi toutes les blondes en elles…
Pour beaucoup, il s’agit là d’une évidence, du moins depuis Diderot. Pour la génération actuelle qui redécouvre l’assignation culturelle (il faut être noir pour jouer un noir…), certaines évidences doivent être rappelées. Comme il faut rappeler que la liberté laissée à l’acteur par un metteur en scène indigent est une tromperie : en l’absence d’une direction d’acteur stricte, le comédien ne fait « qu’obéir servilement, à son insu, au pire des metteurs en scènes, toujours le même, celui qui s’appelle “idéologie dominante”. » En cela, cet entretien va bien plus loin qu’un cours de théâtre et prend une évidente dimension politique. On n’est pas étonné d’y croiser des djihadistes, qui croient à la réalité de ce qu’ils disent. « Dieu, pour eux, c’est du solide ». Au théâtre, à l’inverse, tout est vrai et ce n’est pas vrai en même temps. Jadis, pour cette raison, les comédiens étaient excommuniés par l’Église. Certains passages de ce livre, et c’est ce qui le rend précieux, risquent de l’être par les grands prêtres du wokisme (qui, lui non plus, n’existe pas, rappelons-le).
Le ton de l’entretien, mais surtout le nombre d’exemples lumineux tirés de son expérience, écartent les propos de Mesguich de l’abstraction pédante. Car il faut bien parler du néant, du blanc, de l’inexistant, du silence ! De même que pour le poète, le blanc de la page est une écriture, de même que le musicien « sculpte les blancs », l’acteur fait « dégorger » le blanc entre le point final d’une phrase et la majuscule de la suivante. Cela ne vous parle pas ? Alors, imaginez… À l’école, pour parler d’Andromaque, votre professeur lisait un livre, où étaient consignées les répliques de chaque personnage. Or, durant ces répliques, les autres acteurs sont présents sur scène, silencieux. Et « leur silence parle » : c’est le blanc sur lequel s’inscrit la réplique de leur interlocuteur. Ce silence loquace est tout l’art du comédien. Alors que les mots de Pyrrhus sont les mêmes depuis Racine, les « phrases-fœtus » d’Hermione, qui « bouillonnent dans cette sorte de matrice blanche » qu’est sa « tirade indicible », changent selon les époques, les lieux, les metteurs en scènes, les acteurs, les spectateurs…
Nous sommes tout à coup dans un cours de théâtre. Si le silence est à ce point éloquent, c’est parce que certaines phrases sont directement adressées par l’acteur en charge de la réplique à son interlocuteur muet (« attention, tu vas tomber »), quand d’autres ne sont adressées qu’à lui-même (« Vivre m’est désormais insupportable »). Entre ces deux extrêmes, toutes les nuances sont possibles. C’est donc le texte qui fait aussi parler le silence. « Ce n’est que par les paroles qu’on a quelque chance d’entendre ce qui se tait… Voilà peut-être pourquoi le théâtre est bavard. » Et tout soudain devient clair.
Si la réalité perd de sa substance, l’acteur, le metteur en scène, mais aussi le spectateur sont perpétuellement en train de créer une autre réalité, une fiction (le mot, en son sens le plus fort et le plus noble, ne peut que parler à un romancier de la Nouvelle Fiction) qui, sous un masque apparemment mensonger, indique (pointe de l’index) plus sûrement « de la vérité » que son dévoilement prétendument direct. La vérité du sujet est dans la langue, qui est passage, et ne se trouve pas dans le contenu : « la langue, rouge comme une mer, s’ouvre pour laisser passer. Alors qu’un philosophe […] croit, lui, que c’est dans ce qui est écrit. » Ici encore, l’exemple de l’enfant et de son doudou concrétise la réflexion menacée d’abstraction. Mais l’épaisseur historique d’une pièce permet aussi de figurer ce jeu étrange du mensonge et de la vérité. Dans une pièce de Shakespeare, on peut trouver une femme travestie en homme. Mais n’oublions pas que, les femmes étant interdites sur scène, c’est un homme travesti en femme qui joue le rôle. Un homme travesti en femme qui se travestit en homme… Que ressent le comédien ? Que voit le spectateur ? Ce qu’ils recomposent en eux en fonction des conventions de leur époque. En s’obligeant à retrouver en eux la femme du rôle entre les deux hommes de l’acteur et de l’action. « Au théâtre, rien n’existe dont on puisse dire : c’est ça. Tout peut se retourner à tout instant. »
Ceci n’est qu’un des nombreux sujets abordés par ce dialogue. Tous sont aussi captivants, réfléchis, invitant le lecteur à réagir ou partager la réflexion. On parle aussi de la traduction, du sens, de la poésie, de l’inculture des jeunes acteurs, de la voix, de l’écriture, de l’espace théâtral qui se crée par la présence de l’acteur, des différence culturelles de la perception (entrer par le côté cour ou côté jardin, par le lointain ou l’avant-scène, n’a pas le même sens dans les cultures qui écrivent de droite à gauche !)… On sourira aux paradoxes créés par les mots — au théâtre, le ciel est au fond (de la scène) et non au-dessus (des acteurs). On remettra en question le culte si partagé de la concentration — elle vise un but connu d’avance et donc sans intérêt, alors que la distraction n’a aucun but perceptible et traduit le singulier, l’irremplaçable, la présence de l’acteur. On s’interrogera sur notre rôle de spectateur, un « chercheur, dans sa solitude et la nuit de la salle, capable toujours des plus grandes audaces intérieures, des plus fabuleux voyages ». Si l’histoire personnelle fait partie de ces dialogues, elle est toujours significative. Déambuler avec Rimbaud dans les rues de Marseille bouleverse le rapport à la langue. Un professeur de français nous fait comprendre à travers Lamartine que ce qui n’est pas dit parle plus fort que ce qui est dit : « Quand je sortais tout seul et qu’elle (la levrette) demeurait » souligne implicitement le fait que, le plus souvent, la petite chienne sort avec l’auteur… Chaque page fourmille de ces détails qui nous invitent à prolonger en nous la lecture.
S’il fallait mettre un léger bémol à la clé de ce superbe dialogue, ce serait dans l’effort, parfois laborieux, de traduire dans l’écriture l’oralité de la conversation. Certains procédés sont empruntés à la langue orale : les rimes, les apostrophes (« Mon cher Philippe »), les interjections (« Ah ? — Oh ! »), les incises (« [rires] »), les tics de langage (« mais mais mais »)… D’autres sont spécifiques à la langue écrite : usage des italiques, profusion des guillemets, décomposition des mots (« dis-trait »), jeux de lettres (« otoanalyser »)… Cela traduit sans doute les indicibles de l’entretien, mimiques, accents d’intensité, émotions, mais l’abus est artificiel, d’autant qu’on a l’impression que Mesguich « parle écrit » quand Bouret « parle oral ». Impression d’autant plus troublante que les apostrophes (« mon cher Philippe ») sont presque toujours le fait du premier, dont le discours a contario est légitimement personnel et que Philippe Bouret, qui ne se permet jamais un « mon cher Daniel », s’adresse directement à son interlocuteur ! On s’amuse de ces trompe-l’œil, qui renvoient aux théories sur le « discours indirect » du théâtre. On s’en agace à d’autre moments, lorsqu’il s’agit d’un jeu quelque peu cabotin : « nous sommes tout autant dans la “pensée” (Quand je dis “pensée”, mettez, Philippe, de bons gros guillemets autour du mot) ». C’est surtout l’abus de ces procédés qui finit par perturber la lecture. À moins qu’il s’agisse d’une volonté de déconcentrer le lecteur et de lui donner l’occasion de prolonger dans le singulier la lecture ? Il faut s’attendre à tout au théâtre, y compris à ce qu’un philosophe joue à l’acteur qui joue au philosophe…
Retour au sommaire
Voir aussi : Cet enfant sans mot qui te commence, Encres lacérées, Lignes de fond.
Annie Dana, Le deuil du chagrin, Rougier, images Vincent Rougier, 2023.
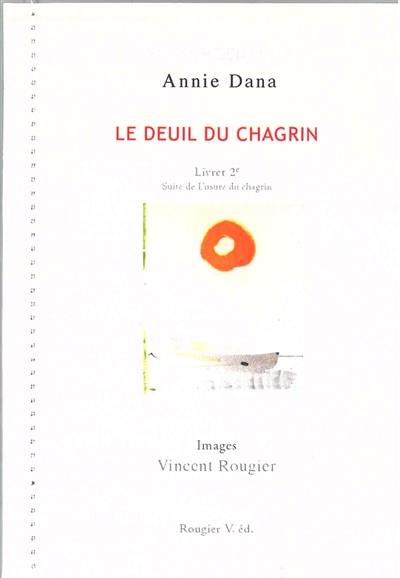
Le poète est sensible aux traces infimes de l’invisible, aux rumeurs inaudibles — « Les silences disent plus que les mots / Quand les brèches frémissent / Chuchotent / Balbutient ». Comme les grandes douleurs, les fractures de la vie sont muettes, mais celui qui y prête attention les perçoit. C’est aussi cela, le deuil, ce « deuil du chagrin » qui donne son titre à ce recueil. Ce sont les traces imperceptibles qui nous frappent d’abord dans ces pages : les fantômes qui peuplent nos mémoires, le désert de l’absence, les pleurs que l’on n’a pas versés, la tache inexistante, les phrases renoncées… Quelque chose cherche à s’exprimer, trop longtemps refoulé, qui empêche le deuil.
Mais très vite, une autre thématique traverse les poèmes, plus accusatrice, comme un remords s’ajoutant au regret. Un fantôme « dénonce notre mensonge », une prétendue victime nous accuse, « C’est bien vous qui avez perpétré ce méfait », des « juges » se dressent, demandant justice « pour des blessures infligées aux autres », exigeant des aveux — « avouer » revient comme un leitmotiv. Et les mots se font plus dur — duel, ensanglanté, traître, déchirure…
Il faut se laisser guider par les mots, qui ruissellent comme la pluie sur les ardoises, accepter les reproches comme les espoirs, il faut « crier l’exil » pour apprendre à « balbutier l’amour ». Alors une thématique plus apaisée pourra se glisser dans les poèmes, « si tu veux tenter la chance de vivre », qu’il faut peut-être rapprocher de « la chance de ta blessure / Enfin désenchantée ». Comme la plante naît de la fissure du mur, l’enfant de celle de la femme, « les ressources du désert » peuvent nous laisser interdits… « Ne capitule pas sans te battre / Attends la paix qui doit venir » : les derniers poèmes nous parlent peu à peu de pardon — « on se prend à aimer ceux qui nous ont trahi » — de résignation — « Pour accepter la vie comme un fleuve ». Et cet apaisement est un retour au néant, néant de la douleur, bien sûr :
Aujourd’hui il ne reste rien
Ni des mensonges
Ni du regret
Ni de la trahison
Juste de la poussière d’étoiles
mais comment oublier que c’est de ce « rien », silence, absence, inexistence, que le recueil est parti ? Cette « poussière d’étoiles » qui le conclut n’est-elle pas un écho à cette clairvoyance qui, dans le premier poème, permet d’« entrevoir dans l’invisible l’élégance du monde » ?
Voir aussi : La signature du temps. Pépins de Cupidon. Le piège des aveux. Tremblement des jours.
Retour au sommaire
Jacques Richard, La course, On-lit, 2022.
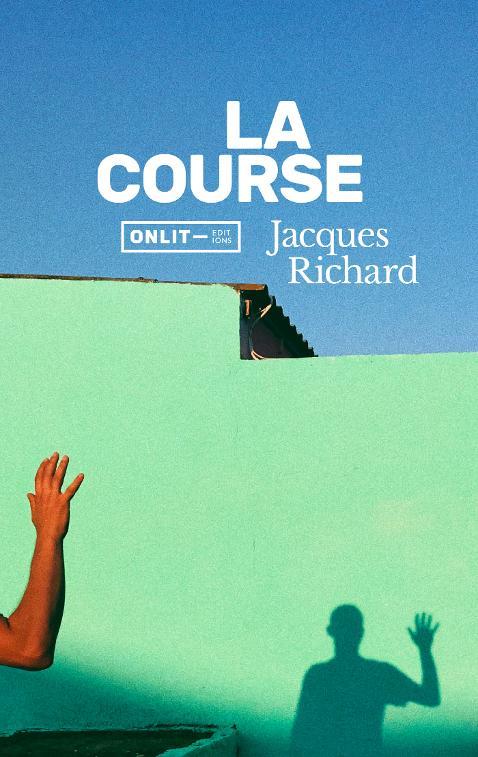
« Chacun de nous est un puits où, tout au fond, quelque chose attend, appelle dans le noir. Personne n’ose s’y pencher. » Jacques Richard, de roman en roman, explore les zones obscures de l’âme humaine et les divergences entre l’être profond et l’être social. Ce roman est celui de ce malentendu, pire que la solitude. Aux deux bouts de la course, deux sœurs, Hélène et Madeleine, Léna et Magda — qui réussissent à rimer dans la version complète ou abrégée de leur prénom, mais qui ne se voient pas. Entre les deux, un adolescent, qui court de l’une à l’autre. Chez sa tante, Hélène, il vient chercher une étreinte rapide ; à sa mère, il rapporte un peu d’argent. Deux buts qui n’ont rien en commun, bien sûr, et pourtant, l’idée pointe dans l’esprit de Léna — « Il courait comme s’il devait mériter de venir ici. Me mériter. Me gagner. Gagner ce que je donnais à sa mère. » De part et d’autre, il apprend à être un homme. En faisant l’amour à une femme ; en rapportant l’argent du ménage.
Magda est la mère, mais bien au-delà de sa maternité. Elle est l’archétype de la mère : elle l’a aussi été de sa sœur, plus jeune qu’elle, et finit par incarner la mère qui aurait voulu rester femme, comme Hélène est la femme qui ne parvient pas à être mère. L’une a un enfant mais pas d’homme, l’autre un mari mais pas d’enfant. Elles se regardent comme dans un miroir aux reflets inversés. Ce sont les deux visages de la femme, deux pôles entre lesquels l’adolescent court, comme s’il pouvait les réunir. Bien sûr, leur réunion, lorsque la vérité se dévoile, sera orageuse…
La course donne son titre au roman. C’est le rôle du garçon, sans doute, entre sa mère et sa tante, toutes deux immobiles dans leur solitude. Mais au-delà, c’est une façon de vivre, sinon une mentalité, celle de l’adolescent découvrant la vie : « Tu cours, tu cours. Après tout ce qui passe. Tu suis le dernier qui a parlé comme un chien sans lieu, sans lien. » C’est aussi la trépidation du monde moderne, qui effraie tant la mère. « Tout bouge. Tout a bougé. Rien ne tient en place. Les bagnoles. Sa belle maison d’antan. Disparue, la villa. » La course est devenue une malédiction, synonyme de misère pour celle qui désormais « court après les sous ». Mais n’est-ce pas le sort commun à tous les hommes ? « Tout le monde court, Magda. C’est normal de courir. Après les sous, après ce que tu veux, mais on court. » Et cela vaut peut-être mieux que l’immobilité, car celles qui ne courent plus attendent sans espoir. « Le monde est une gare où attendent les passagers d’un train qui ne vient pas. » La course est le fil conducteur du roman, dans tous les sens du terme (car le garçon qui court chercher une enveloppe chez sa tante fait ses courses…) et dans toutes les expressions consacrées (courir après les sous, courir les filles…). Calvaire pour les uns, extase pour les autres — « Quand je cours, j’oublie que je suis là. Je me quitte. » La course devient son propre but. Et cela vaut mieux. Car le jeune homme, comme sa tante, se pose des questions sur leur relation hors norme. Il se rend compte que sa course est narcissique, qu’il ne voit dans la femme — « ce trou qu’il appelle une femme » — que le plaisir qu’il peut y trouver. Il sait qu’il ne va chez sa tante que « pour ça », que l’argent qu’il rapporte n’est qu’un prétexte. « Car le voilà, le bout de sa course. À chaque pas, dans chaque caresse, dans chaque baiser. Lui. Lui le chemin. Lui la destination. »
Cette prise de conscience est dans la tradition du roman d’initiation. Le garçon des premières pages traîne encore les angoisses de l’enfance, l’impression que tout le monde, sur son chemin, le perce à jour et le juge (« ils contemplent ma honte »), la superstition du geste maladroit (« un geste abolirait tout »), le retrait intérieur comme refuge contre le conflit… Tout l’art de Jacques Richard est de traduire cette évolution dans une langue précise, rigoureuse, qui a recours à toute la palette de la subtilité grammaticale. Le protagoniste principal, le jeune garçon, peut parler aux trois personnes du singulier, et parfois dans la même phrase : « me lécher en dessous, au-dessus (et il sent le rugueux des papilles de la femme contre les siennes) ». Cela introduit un léger décalage entre les perceptions, une mise en perspective du souvenir par le narrateur. Le même entre-deux réunit le monde qu’il raconte et l’écriture, par un usage subtil des signes de ponctuation. Les guillemets : « Y a pas “ça”. Y a pas “ce que tu sais” ! C’est quoi, “ce que tu sais” ? Y a pas de “vérité-là”, y a pas de “z-yeux fermés”. Ils marchent pieds nus sur des guillemets. » Les parenthèses, qui permettent d’isoler le protagoniste du monde qui l’entoure, en particulier lors d’une remontrance maternelle : « Lui, dans ces cas-là, il se met entre parenthèses ». Et de fait, un peu plus loin, une incise concrétise cette image : « (Lui entre parenthèses) ». Mais l’image rebondit dans un autre passage, où les parenthèses sont comparées à un deux-pièces.
On peut sourire ou s’agacer de ces recherches, qui imposent une distanciation au lecteur, elles m’ont pour ma part impressionné, car elles entrent dans une même conception de l’écriture, exigeante et diversifiée. Ainsi, le vocabulaire le plus cru (lors d’une expérience homosexuelle : « Celui-là, après, il veut l’enculer, allez quoi, mais il s’y prend n’importe comment ») n’empêche pas un foisonnement d’images originales, parfois à la limite de la préciosité, comme dans l’évocation des hosties, « ces rondelles de farine complète enrubannées de latin », mais dans un art de la formule efficace. Chacun en dressera son florilège, le mien comprendra, entre bien d’autres : « La grand-rue montre des tristesses de chaussette ravaudée », « le vrac jamais trié de la vie », « le sourire d’une qui fait semblant de comprendre le flamand chez le boucher », « on entre sans invitation dans la vie privée du visage »… Sur le fil ténu d’une intrigue très mince (et particulièrement délicate dans la littérature bien peignée de notre époque), Jacques Richard déploie toutes les richesses de la langue.
Voir aussi : Scènes d’amour et autres cruautés, Le carré des Allemands, L'homme peut-être et autres illusions. Écrit sous l'eau.
Retour au sommaire

