Michel Quint, Et ma vie pour tes yeux, Serge Safran, 2024.

« – Je me méfie de la littérature.
– Pourquoi ?
– Elle donne de l'espoir. »
Le ton est donné, semble-t-il. Michel Quint n'écrit pas pour donner de l'espoir. Tout semble bouclé, dans ses romans. Envisager l'avenir semble difficile quand on traîne un passé plus lourd que la partie immergée de l'iceberg, « du passé de plomb, de souffrance, le tien, le mien, du à crever que je peux pas te dire ». Et pourtant, on projette, on construit, car le contraire de l'espoir n'est pas le désespoir, mais une sorte d'opiniâtreté à vivre sans illusion. Dans ce roman-ci, Violette ouvre une maison d'hôte ; Henri, son premier client, veut ouvrir un bar ; les époux Belzunce, venus d'Avignon, veulent investir dans une résidence d'étudiants à Villeneuve-d'Ascq… Mais peut-on construire un avenir solide sur le terrain mouvant du passé ?
Les familiers des romans de Michel Quint retrouveront dans ce roman ses obsessions, ses atmosphères, sa touche particulière qui mêle le langage familier aux clins d'oeil culturels. Le poids du passé est omniprésent dans ses romans, en particulier les souvenirs de guerre, de toutes les guerres – ici, l'occupation allemande – intimement mêlés à l'actualité souvent la plus violente – ici, les home-jackings ou la crise sanitaire – car le présent souvent entre en résonance avec le passé. L'intrigue policière constitue volontiers, chez lui, un moteur de narration. Il sème les faux indices avec malice pour désorienter ses lecteurs, mais il joue davantage sur l'atmosphère et les caractères que sur le suspense narratif, somme toute secondaire.
On retrouvera avec bonheur les lieux familiers à Michel Quint, les villages du Nord, des lieux « sans âme » mais jamais sans chaleur. Les petites gens – « on est des négligés, des gens que personne n'a cueillis, jamais » – qui s'accrochent obstinément à leur maigre part de bonheur, quitte à mentir, ensevelir leur guigne sous des sourires de façade. Michel Quint a le don rare de multiplier les personnages en les caractérisant suffisamment pour que le lecteur ne s'y perde pas. Car tous ces personnages ont des fissures qui laissent entrevoir des drames qu'on croit étouffer, des froissements dans le passé qui lézardent les sourires de façade jusqu'à l'effondrement. Henri, le protagoniste, a « des casseroles, un passé pas joli », mais surtout, sa phobie des oiseaux (y compris sur le papier peint !) laisse entrevoir les cicatrices d'un drame qui ne sera connu qu'à la fin du roman. Ida, derrière sa nymphomanie décomplexée, laisse percer « des larmes clandestines ». Les époux Belzunce, truculents Tartarins qui ont quitté Avignon pour des raisons nébuleuses, sont rejoints par leur fils pour une explication orageuse… À tous, on pourrait poser la même question : « T'es qui en vrai » ?
Comme dans le Père Goriot, le hasard des rencontres dans une maison d'hôtes – version moderne de la pension Vauquier – provoque le choc thermique qui ouvre les fissures. On a envie de se confier à des gens de passage, de trouver l'amour brisé par les deuils, les abandons, les désillusions, de « réenchanter la vie » en faisant à nouveau confiance à un inconnu. de vider sa mémoire, aussi, peut-être, car « les cerveaux c'est des greniers, pleins de trucs qu'on sait plus à quoi ils servent ».
Le roman est l'art de démêler parallèlement tous ces fils sans jamais perdre le lecteur, et Michel Quint le maîtrise à fond. Mais au-delà de l'aventure particulière, la vision du romancier doit être plus large. Comme pour se dédouaner de visées trop hautes qui ne sont plus à la mode, il les déplace sur un personnage secondaire qui manie l'autodérision, Abel, patriarche d'une famille de paysans, qui lit avidement toute la bibliothèque de la maison Violette riche en classiques universels mais dont les hôtes ne consultent que les guides et les romans érotiques. Du coup, ce « fermier avec une culture d'académicien » parle comme avec le plus grand naturel et beaucoup d'à-propos de métempsycose ou de l'émoi amoureux chez Sappho. Pourtant, cette culture encyclopédique cache aussi ses failles : « Les mots c'est un barrage contre la mort, comme les poèmes d'Apollinaire, pareil, ou une préparation à crever, va savoir… » Ils lui servent en l'occurrence à dépasser les souvenirs de la guerre.
Au-delà de cette thérapie personnelle, celui qui se veut « aède-rhapsode » (« rap-machin », traduit Henri) parvient à élargir le sujet, comme un porte-parole malicieusement décalé du romancier. Après la Covid, explique-t-il, le monde est retourné « à l'ère des mythes primitifs, où priment les instincts profonds, l'animalité chez les humains, un mode différent ». C'est ce qui explique la violence que traduisent, en l'occurrence, les home-jackings. Le confinement, c'est Achille en colère, qui boude sous sa tente. Les cambriolages avec séquestration, « c'est le confinement dévoyé, en mode barbare ». Pour dépasser toute cette violence qui resurgit du fond des âges, « il faut des aèdes comme lui, des rhapsodes pour écrire ce monde et l'apprivoiser, sinon… » Voilà une véritable mission pour un écrivain : raconter, c'est essayer de suspendre le temps. « Comme la grande muraille de Chine… Mais avec des mots, pas des pierres… » Alors, non, la littérature ne « donne pas de l'espoir », mais elle peut guérir, les plaies personnelles comme les plus profondes blessures de la société actuelle. Un roman sans espoir n'est pas forcément désespéré.
Tout cela avec le petit sourire du conteur qui ne se prend pas au sérieux. Car ce que l'on aime aussi, chez Michel Quint, c'est une écriture apparemment sans prétention, à la syntaxe flottante (« un parfum de sensualité qu'on dirait pas »), où se risquent des interjections (« elle lui tend le plateau de fromages avec un regard hou là là ») ou des expressions familières (« Xavier avait pas lourd d'âge »), mêlant dans des phrases étourdissantes narration et dialogues (« Violette lui a préparé la fameuse confiture de coing mais aussi à la fraise faite maison à la ferme des Agaches, café ou thé, café merci, bien dormi, oui merci… »)
Tout cela peut sembler relâché, mais derrière le naturel se sent le travail de précision, le clin d'oeil calculé au lecteur, la chasse aux clichés qui donne un impact détonant à ceux que se permettent les personnages. Avec de vrais bonheurs d'expression dans les images – « Violette parle droit devant », « un ciel de layette bleu et rose » ou des peintures murales qui évoquent « des faux Rubens, des trucs flamands avec de la fausse chair mythologique ». Et l'on en vient à conclure, comme Violette, quand le roman s'achève : « Parle-moi encore ».
Retour au sommaire
Louise L. Lambrichs, La vie, ça finira un dimanche, La rumeur libre, 2024.
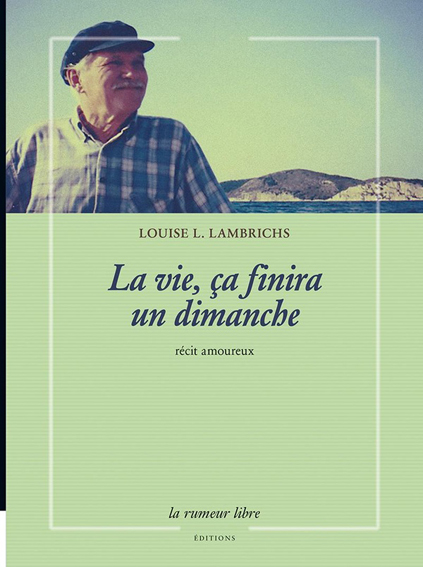
Dans le bureau de Mirko Grmek, le grand historien de la pensée médicale, figurait une reproduction de la statue du Kairos, le dieu du moment favorable, portant une longue mèche de cheveux sur le front, car il faut l’attraper au moment où il passe, mais chauve sur l’arrière de la tête, car il est trop tard quand il est passé. Mais le moment de saisir l’occasion par les cheveux peut prendre une tournure tragique. En l’occurrence, l’annonce d’une maladie incurable et mortelle à court terme, la maladie de Charcot, qui entraîne une paralysie rapide de l’ensemble des muscles.
Louise L. Lambrichs était sa femme depuis dix ans quand le diagnostic en a été établi, en 1999. Durant un an, elle l’a soutenu jusqu’au moment qu’il a choisi pour terminer ses souffrances, un dimanche de l’an 2000. Durant un an, pour se soutenir elle-même, elle a pris des notes qui ont dormi un quart de siècle avant qu’elle se décide à en faire un livre, un « récit amoureux ». Quel rapport avec le Kairos ? L’annonce, qui aurait désespéré de moins solides ou de moins avertis, est pour Grmek l’occasion d’une prise de conscience, d’un retour sur soi et sur sa vie qui rendent ce livre formidablement stimulant. Oui, il y est question de maladie et de mort, et dans leur réalité la plus crue. De découragement et de dépression aussi, quelquefois. Mais la certitude de n’en avoir plus pour longtemps intensifie le moindre moment. La sensibilité à la beauté du monde devient, devant l’urgence, un émerveillement, une « découverte éblouie ». Pendant un an, il décide d’emmagasiner les bons souvenirs, de les revivre, aussi, dans un long pèlerinage sur les lieux du bonheur.
À tel point que le souvenir, parfois, prend le pas sur le vécu. Un passage est particulièrement frappant. Revenu à Lacco Ameno pour profiter d’un feu d’artifice qui prend du retard, Mirko, pour tromper l’attente, raconte un souvenir de feu d’artifice à Venise. La magie fonctionne : celui de Lacco Ameno ne sera pas même évoqué dans le livre, comme si le souvenir du souvenir devenait plus vivant que la réalité. Ce sera aussi le moyen pour Louise L. Lambrichs de surmonter le deuil, après la mort de son mari : elle commence par « habiter les objets chargés d’âme du disparu », mettre ses pyjamas, terminer le flacon de shampoing, ou les paquets de ses biscuits préférés. « Habiter » : le terme est fort et revient à plusieurs reprises au cours du livre. Dans la maladie de Charcot, qui détruit le corps mais n’atteint pas les facultés intellectuelles, être attentif à ce que l’on vit est comme « habiter un corps qui nous parle un langage énigmatique ». Et après sa mort, Mirko continuera pour la narratrice à « habiter secrètement mon corps qui continue de le rêver vivant ».
Cette dimension charnelle est très forte. Bien sûr, il ne peut être question que du corps, de sa déchéance et de ses rémissions, mais aussi de la complicité physique qui unit les deux époux : « il est vrai qu’entre nous, ce lien charnel, organique, a toujours existé. » Le corps rebelle devient un objet étranger, que Mirko, médecin, observe en se dédoublant dans une « désunion douloureuse du moi », théorisant ce qu’il éprouve. Au thème de la fusion répond alors celui de la scission, complémentaire, qui se manifeste également dans l’entourage du couple, renforçant certains liens, en brisant d’autres – surtout lorsque des confrères peu scrupuleux, comprenant qu’il n’en a plus pour longtemps, cherchent à profiter une dernière fois de son expertise sur leurs travaux en cours ! La maladie crée un « séisme dans le tissu des relations affectives et sociales », qu’il faut aussi prendre comme une décantation de l’humain.
S’il ne sacrifie jamais à la fiction, le livre nous introduit au plus intime dans l’histoire d’un couple, de ses rapports intellectuels, de ses relations avec les amis, les médecins, le monde... On y réfléchit bien entendu sur les grands enjeux de la santé : la législation sur l’euthanasie, l’acharnement thérapeutique, le consentement éclairé, la confiance thérapeutique – un médecin a-t-il le droit de mentir à un patient qui veut savoir, faut-il légiférer sur l’euthanasie ou renforcer le lien de confiance entre médecin et patient ? L’organisation de sa propre mort, les problèmes concrets qu’elle rencontre sont sans doute au centre du récit. Mais Mirko Grmek est aussi un intellectuel croate, qui a intéressé Louise L. Lambrichs aux contorsions de l’Histoire en Serbie, en Bosnie, au Kosovo, et à « l’inépuisable camaïeu d’à-peu-près et de contorsions rhétoriques qui surfilent les autoroutes de l’information ». Quant à elle, son travail sur la langue s’enrichit de leurs discussions – elle découvre que sa « langue française, si riche et précise, dissimule des espaces de pauvreté où s’engouffrent aussi des pauvretés de pensée que d’autres langues peuvent venir nourrir. » L’année 1999-2000 est également riche en épisodes qui s’invitent dans l’histoire personnelle – la tempête qui saccage la Normandie, où ils ont une maison, la mort du président croate et du criminel de guerre Arkan, le rêve d’une démocratie en Croatie… Mais aussi, au niveau personnel, la mort tragique, inattendue, du fils de Mirko, ou l’annonce d’un cancer qui s’ajouterait à la maladie de Charcot, comme « une cerise empoisonnée sur un gâteau immangeable ». Tout cela enrichit le livre, qui s’inscrit dans une histoire en marche et dans le flux continu de la vie.
Le portrait qui se dégage de Mirko Grmek et du couple qu’il a formé avec Louise L. Lambrichs est marqué par cette complicité permanente, par une incroyable dignité, par une lucidité sans concession, par la finesse de la langue et l’intelligence des analyses. Mais aussi par un humour parfois inattendu, et cela fait partie de la dignité de l’homme face à son destin, car « face au tragique, seul l’humour sauve ». On sourit avec lui des blagues entre confrères, d’un diagnostic de délire paranoïaque posé pour un patient soutenant que Tito est le plus grand président de l’Histoire, des « ambiguïtés constructives » nécessaires aux accords internationaux, ou de la façon dont la mère de Louise retourne les situations – si le lait d’ânesse a les mêmes vertus que le lait de femme, cela veut dire qu’une femme pourrait allaiter un ânon ? Dans une large palette qui va de l’émotion à la réflexion, des enjeux politiques aux questions linguistiques, du rire franc à l’abattement, c’est une leçon de courage et de vie que nous découvrons au fils des pages.
Retour au sommaire
Voir aussi : Quelques lettres d’elle, Les amants de V., Malpensa. Bris et collages. Sur le fil envolées.
Velibor Čolić, Guerre et pluie, Gallimard, 2024.
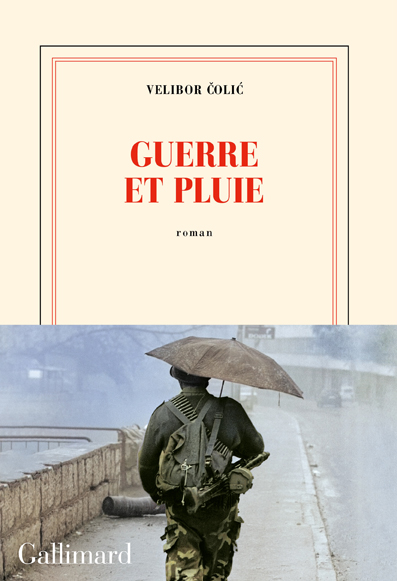
« J’étais censé être écrivain et j’ai fini soldat.
Une phrase courte et amère.
Grosse erreur et confusion. »
Erreur dépassée, la guerre a fait de Velibor Čolić un écrivain, et un grand écrivain de langue française. Confusion ? Peut-être, tant l’écriture et la guerre sont indissociablement liées dans son esprit. Enrôlé à vingt-huit ans dans l’armée croato-bosniaque, il remplit des carnets. Réfugié en France puis en Belgique après avoir déserté, en 1992, il écrit sur la guerre. Un troisième larron est désormais entré en scène : la maladie. Ce roman a été conçu durant le confinement, alors que la maladie personnelle s’ajoute à la Covid ambiante. Des douleurs dans la bouche, aiguës, en mangeant ou en buvant, des ulcères cutanés qui le maintiennent enfermé plus sûrement que le confinement. Et le souvenir de la maladie qui l’a poursuivi durant la guerre, une maladie de peau due autant à l’hygiène rudimentaire qu’à des causes psychologiques – ce « n’est rien d’autre que la guerre qui sort de vous ». Les souvenirs de guerre affluent avec netteté, les sons, les odeurs, « du sang et des armes », au moment où le confinement le maintient chez lui. Trop de temps libre : il doit le meubler, « rompre la monotonie de la maladie avec la créativité. »
Ce n’est certes pas le meilleur motif pour commencer un roman, la pandémie nous a valu quelques formidables navets, mais pour un véritable écrivain, l’hypersensibilité de l’inactivité forcée peut être un stimulant efficace. Cela nous vaut en tout cas quelques pages d’une puissance évocatrice exceptionnelle : l’enterrement de Merima, l’étourdissement consécutif à une hypnose, le bonheur procuré par la pluie, le manifeste de la Révolution éthylique, la tristesse du chien privé de son os… Pour ceux qui comme moi, je l’avoue, ne se montrent guère passionnés par les histoires de guerre racontées dans leur plus atroce réalité, ce sont de précieuses échappées purement littéraires. Guerre et pluie : la pluie court comme un leitmotiv à travers le roman. La boue des tranchées, le « déluge de fer rouge » des bombardements, les « hectolitres de sueur » sont lavés par la « samba mouillée et érotique » de la pluie sur les fenêtres, ou par les enregistrements de la pluie en Thaïlande trouvés sur YouTube…
Le roman se construit en deux grandes parties (la troisième, plus courte, étant consacrée à la désertion et à l’arrivée en France) sur ce contrepoint. Les souvenirs de guerre sont d’abord des souvenirs d’écrivain perdu dans la bataille, notant quelques idées, analysant ce qu’il traverse – les « tactiques d’ivrogne » pour gérer la « beuverie macabre » de la violence : la durée de vie d’un soldat ivre est courte, mais le soldat insuffisamment ivre vit un enfer – la « gastronomie de la guerre » – le retard dû à la cigarette qu’on allume et qui permet d’éviter un obus, il devient « un des rares individus dont le tabagisme a sauvé la vie »… Mais très vite, l’horreur l’emporte, les mutilations sadiques, les cadavres transformés en pièges, la curiosité malsaine pour l’« anatomie de la mort », ce qui reste après le bombardement... Et les humiliations de la nature, l’absence de honte dans la vie commune, les masturbations frénétiques.
L’écriture alors ne peut plus être le regard extérieur, distancié, de l’écrivain dans la bataille, mais une confrontation directe avec son sujet. Le déclic arrive lorsqu’une équipe de télévision égarée sur le front maquille un reportage. Les mensonges, les supercheries des journalistes l’engagent à écrire soi-même. « Si nous ne disons rien, il y aura toujours quelqu’un qui parlera pour nous. » Et la réalité des tranchées s’impose à lui : « Peu d’écrivains ont écrit sur la puanteur de la guerre, sur cette partie confuse et déformée de l’humanité. » La forme littéraire aussi : « Même si elle ne respecte pas strictement les faits, la littérature est toujours vraie. La télévision rarement, presque jamais. L’image est toujours plus périssable que les mots. » Idée qui peut sembler saugrenue, mais que l’on comprend sans peine : le reportage télévisé doit composer avec la quête d’audience, la sensabilité de l’arrière. La littérature peut tout se permettre. « Quelqu’un a chié au milieu de la route et a essuyé son cul plein d’hémorroïdes. » Voilà la réalité de la guerre, ce dont les médias ni les livres ne parlent : il leur faut de l’héroïsme ou de la lâcheté, des généraux et des batailles. Ici, « on vit, on meurt, on mange, on chie, on pisse, on pète, on pleure ensemble ».
Trente ans après, la maladie doit trouver le même ton. Ironie distanciée, lorsqu’on est abandonné par la médecine officielle et qu’on se retrouve aux mains des réflexologues, acupuncteurs, hypnotiseurs et autres charlatans. Mais c’est aussi une expérience vécue et racontée au quotidien. « La maladie, c’est comme jeter un caillou dans l’eau. Des cercles concentriques de solitude se créent. De véritables sphères de peur, de superstition et d’incompréhension. » L’écriture est le point commun. Elle permet de rester au cœur de la réalité, sans la prise de distance du reporter de guerre ou du médecin de ville. « Là où la science sait tout, la poésie pose des questions. » C’est cela qu’il nous faut retenir, car c’est ce qui donne sa puissance à la littérature. La distance ? Elle vient peut-être du choix de la langue, non pas la langue maternelle, mais la langue de l’exil, le français. « Une langue dans laquelle je suis installé comme dans un appartement de location. Et le loyer que je paie, ce sont mes livres. » Bel hommage à la patrie d’accueil.
Retour au sommaire
Claire Huynen, Ceci est mon corps, Arléa, 2024.

Ceci est mon corps : la formule de l’eucharistie, à double sens dans le roman, est remarquablement choisie pour résumer ses enjeux. Hélène, en retraite dans une abbaye, souhaite y prononcer ses vœux. Seul problème : quelques années auparavant, elle s’appelait Hervé. La transsubstantiation de l’hostie en corps du Christ, elle l’a vécue dans sa chair. La formule du prêtre qui l’accomplit est à la fois affirmation d’une foi et revendication de son propre corps. Son âme de femme avait longtemps été hébergée dans un corps d’homme : depuis qu’elle a « mis en accord son âme et son enveloppe », elle a retrouvé une forme de sérénité qui lui permet de vivre autrement son engagement religieux. « Pour la première fois de sa vie, elle n’était plus en désaccord. Et Dieu, alors, pouvait venir à sa rencontre. »
Ce n’est pas seulement un symbole, mais un nouveau regard sur le monde, y compris sur la vie monastique. Elle doit « apprendre par le corps ce qu’elle était venue chercher. S’assurer physiquement du choix qu’elle entreprenait. » Les lectures mêmes doivent s’inscrire dans cette démarche : « La compréhension des écritures devait être intérieure et non cérébrale. » Cette approche a été pour moi la plus intéressante du roman. Trouver un nouveau corps en conservant la même âme – si l’on prend l’option du dualisme – induit un nouveau rapport à la langue, que la romancière explore par son personnage. L’expérience, certes, est courante : la langue façonne la réalité et conditionne notre vision du monde. « Mettre des mots, les prononcer, même imparfaitement, avait donné une réalité à ses pensées hésitantes. » Mais que se passe-t-il lorsque les mots se refusent « à énoncer cette présence en elle » ? « Quelle était la réalité de cette force si des mots ne pouvaient l’exprimer ? » Intéressante, dans cette optique, l’idée de décentrer l’intérêt du personnage : Hervé, avant son opération, était ingénieur biologiste dans un laboratoire pharmaceutique, centré sur le corps ; Hélène, dans l’abbaye, se passionne pour l’enluminure, donnant image aux textes. La jonction entre ces deux domaines s’effectue symboliquement par l’image qui ouvre le roman : une piqûre au doigt jette quelques gouttes de rouge sur la cellule en noir et blanc.
Dans l’économie du roman, l’essentiel réside cependant dans la réaction de la communauté qui l’accueille, au sein de laquelle des liens très forts se sont créés sur un malentendu. Comment les religieuses vont-elles réagir à l’annonce ? Intellectuellement, le problème ne se pose pas. « La vie qui a précédé l’entrée dans notre ordre n’a pas à être connue », estime la supérieure. Il y a eu dans la communauté des voyous, des filles de joie… La question de la sexualité est d’emblée éliminée : dans la peau d’Hervé comme dans celle d’Hélène, le personnage se définit comme asexuel. Il ne sera question que d’identité et de genre.
Mais la communauté ne peut réagir de façon aussi rationnelle. Les caractères sont différents, les portraits que la romancière en brosse, dans les premiers chapitres, nous ont permis de les apprécier. La découverte de la situation ne peut que modifier les rapports qu’elles entretiennent avec Hélène, même pour les plus proches d’elle, pour les plus ouvertes d’esprit. C’est comme un voile, « un silence supplémentaire qui venait s’ajouter au silence. Un silence d’une autre densité », qui se manifeste dans les regards, dans les gestes, et qui la tient à distance avec celles qu’elle côtoyait. Pour décrire la diversité des réactions et les nuances des raisonnements, la romancière imagine les discussions dans le Chapitre de l’abbaye, où chacune peut exposer son sentiment. Incompréhension, rejet, acceptation, refuge dans l’obéissance pour les indécises, certaines invoquant même des références historiques à un saint Eugène devenu sainte Eugénie… Le procédé peut sembler artificiel, mais permet d’exposer le problème dans toute sa complexité. La décision, que le lecteur subodore mais qu’il découvrira dans un ultime rebondissement, n’est pas sans ingéniosité. Au-delà du cas d’Hervé / Hélène, le roman ouvre une réflexion sensible sur l’identité profonde, fondement des rapports que l’on entretient avec autrui, et sur les limites entre dogme et tolérance.
Voir aussi : Les femmes de Louxor.
Retour au sommaire
Alain Lallemand, Ce que le fleuve doit à la plaine, Weyrich, 2024

Printemps 2014 : la Crimée est encore insouciante, elle se prépare à la fête. Mais cette sérénité a ses failles. La société est divisée entre partis opposés, entre intérêts divergents, entre ethnies aux traditions distinctes. Pour les uns, Kiev, la lointaine capitale, est le symbole d’une Ukraine indépendante ; d’autres entretiennent le souvenir de l’époque soviétique. Le mot « patriotes » n’a pas pour les deux groupes la même signification : il désigne pour les premiers les soutiens de Kiev et, pour les seconds, les « nostalgiques de la Grande Russie d’avant 1991, ceux qui restaient attachés à Moscou, aux délires de Poutine ». Les différences sociales sont aussi marquées. Les employés sous-payés ne partagent pas toujours les intérêts des propriétaires, qui attendent le retour des riches touristes russes avec l’été qui approche. Et, surtout, aux côtés des cosaques caucasiens vit une communauté tatare fière de ses traditions et qui dispose d’une assemblée active. Ils s’opposent et se complètent comme l’eau et la terre. Mais comment savoir « ce que le fleuve doit à la plaine » ?
Alain Lallemand, qui fut correspondant de guerre en Crimée pour Le Soir, a choisi d’incarner ces oppositions en deux amis d’enfance. Oleg, petit-fils de cosaque, au service d’un hôtelier russe, est l’enfant du fleuve, qui s’entraîne « à corps perdu » pour les courses en eau froide. Kash, le fils du secrétaire de l’assemblée tatare, appartient au monde du cheval, des longues équipées équestres dans les plaines de Crimée. Son père a élevé Oleg : l’amitié est solide entre les deux hommes, d’autant que l’un et l’autre sont promis à deux sœurs. Leur rivalité amicale se concentre dans les courses de chevaux.
Mais en cette fin de printemps 2014, les tensions entre communautés vont se réveiller. Un corps mutilé est retrouvé dans le fleuve. C’est un Tatar, victime d’un supplice cosaque traditionnel, cravaché à coups de nagaïka, un fouet de cuir tressé. Conflit ethnique, ou provocation de bandes russes qui veulent rallumer les rivalités en vue d’un prochain conflit ? On ne veut pas croire à la guerre. Pourtant, des hordes de motards parlant le russe traversent le pays, fanatisés, provocateurs, quasi déshumanisés – « l’œil ne se fixait plus que sur une identité de foule, une meute ». La fuite du président ukrainien, les répressions violentes augmentent les tensions. Et une deuxième victime tatare, d’importance, cette fois, risque de mettre vraiment le feu aux poudres. Or, le médecin légiste découvre que l’arme du crime n’est pas un fouet cosaque… mais un couteau russe.
L’intrigue se complexifie, le rôle d’une mafia russe, la découverte d’un complot destiné à préparer l’invasion de la Crimée, l’infiltration d’une base navale secrète, multiplient les fils de la narration, qui ne se rassemblent qu’à la fin du roman. Complexité nécessaire, sans doute, pour nuancer le propos que les propagandes patriotiques résument trop souvent en oppositions binaires, et qui nous donne un éclairage précieux sur le conflit russo-ukrainien actuel. Mais la nécessité de mener parallèlement ces intrigues tout en maintenant un suspens de thriller rend parfois difficile la perception d’ensemble. Alain Lallemand a conçu son roman sur le principe du feuilleton, où une formule intrigante conclut un chapitre pour pousser le lecteur à poursuivre sa lecture (« Ah ? Intéressant » - « Belous resta sans voix » - « Je pense que je vais te surprendre »…) Mais la suite de l’aventure tronquée se fait parfois attendre plusieurs dizaines de pages, le temps de poursuivre une intrigue parallèle… qui finira à son tour sur ce que les anglo-saxons nomment un cliffhanger – un élément aussi intrigant qu’un personnage suspendu au bord de la falaise pour inciter à tourner la page… Cela peut parfois agacer les dents et oblige à garder à l’esprit des éléments d’intrigue inaboutis.
Le roman nous retient plus par ses évocations pittoresques de scènes locales, où les courses de chevaux, les marchés colorés, les funérailles traditionnelles, les spécialités gastronomiques forment un tableau vivant des cultures cosaques et tatares. La façon dont l’amitié et l’amour doivent surmonter les oppositions de culture fonctionne aussi très bien, Kash ayant besoin des talents de nageur d’Oleg pour pénétrer sous la base navale russe, celui-ci finissant par déserter pour maintenir son amitié d’enfance. « Nés d’une seule montagne, intimes et pourtant si différents », les deux hommes forment un couple fort et attachant. Quelques superbes scènes se détachent par moment pour suspendre le récit trépidant, comme celle de l’euthanasie du cheval préféré d’Oleg, un des moments les plus touchants du récit.
Retour au sommaire
Paul Emond, Une fabrique de personnages, couverture de Maja Polackova, Académie de Langue et de Littérature françaises de Belgique, 2024.
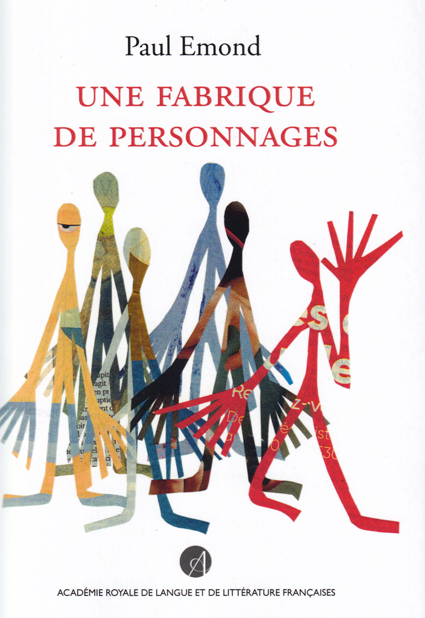
« Une vie racontée est une vie sauvée, dit un vieux proverbe yiddish. » Voilà toute une vie de théâtre sauvée en un livre ! Et pas seulement le théâtre de Paul Emond, même si, c’est bien le principe, il est surtout question de ses pièces. Le théâtre peut sembler l’art de l’éphémère, qui se plie mal au support écrit. Plus que ses pièces, écrites et publiées, il est question ici de spectacles : les mises en scènes, des pièces de Paul Emond ou d’autres auteurs, sont autant de « moments magiques », des « fragments d’absolu que [lui] a offerts le théâtre », des spectacles qui l’ont marqué au fer rouge… Des moments, oui, évanescents comme des illuminations soudaines, et que la magie des mots parvient à transmettre au lecteur.
Plusieurs des dix textes réunis en ce volume ont paru en revues, en conférences, en préfaces, mais tous ont été remaniés pour proposer un ensemble cohérent, qui éclaire différemment les différentes composantes du spectacle théâtral : le rôle du metteur en scène, l’adaptation de classiques, l’écriture, le monologue… On y trouvera des réflexions techniques, des « trucs » de métier, une présentation des outils de l’atelier, tout ce qui peut intéresser le professionnel, mais aussi tout curieux de la « fabrique » qui nous ouvre ses portes. La différence entre « pièces machines » et « pièces paysages », la pratique du « discours rapporté », de « l’ironie dramatique » (ce moment où le spectateur apprend ce que le personnage ne sait pas encore et où il est tenté de crier, comme au cinéma, « Attention, il est caché derrière la porte ! »). On y réfléchit d’ailleurs à la différence entre théâtre et cinéma (« on regarde un film, alors qu’on écoute une pièce »), au rôle de l’embrayeur qui relance le récit (un personnage apparemment secondaire, mais dont le retour régulier, avec une idée obsessionnelle, éveille une complicité avec le public), aux secrets du monologue (qui doit s’adresser à quelqu’un : le public, un personnage muet, ou absent, ou mort). On découvre comment interpeller le public, ou s’adresser à un absent, pour donner une nouvelle énergie à la pièce. N’est-ce pas, d’ailleurs, ce que l’auteur de cet essai fait lui-même pour relancer son analyse : « Mais Paul Emond, dans quoi t’es-tu à nouveau embarqué ? »
Tout cela est captivant, car derrière la magie il y a souvent un prestidigitateur, et que la révélation quasi mystique du spectacle (« les dieux sont descendus ») n’est possible que si le terrain a été soigneusement préparé. Les secrets de fabrication sont souvent des contraintes, des défis à relever, le principal étant que tout cela reste naturel et ne semble pas dicté par des considérations matérielles. Et pourtant… Songe-t-on qu’on écrit pour une troupe, et qu’il n’est pas indifférent que celle-ci soit désormais composée, pour des raisons financières, d’un nombre limité d’acteurs – parfois deux, parfois un seul ? Sauf lorsqu’il s’agit d’écrire pour une école de théâtre, où chaque étudiant doit avoir une place significative : le romancier peut faire entrer et sortir un personnage comme il l’entend, le dramaturge peut compter sur des « utilités » dans une troupe professionnelle, mais doit donner à chacun une place semblable lorsqu’on a affaire à des étudiants. Tout cela influe sur la conception même de la pièce.
Et puis, il y a les grandes questions, notamment celle de la fidélité et de la trahison, par exemple. Faux débat ! « Le fait même de monter une pièce met en branle un processus de transformation », admet l’auteur, qui préfère laisser au metteur en scène toute liberté de le « trahir ». Cela modifie le travail d’écriture : l’auteur doit « laisser de la place », suggérer plus que détailler les situations, admettre une exploitation des virtualités scéniques des mots : l’écrivain livre une chrysalide que les acteurs transforment en papillon. Ce qui explique la déception qu’il ressent quand une mise en scène n’est qu’une « mise en place » qui n’apprend rien à l’auteur sur sa pièce. Et, à l’inverse, la jubilation d’entendre un jeune comédien rétorquer à une remarque : « Vous ne connaissez pas votre pièce, Monsieur Emond, relisez-la ! » Même quand l’univers du metteur en scène semble incompatible avec celui de l’auteur, on guette le moment où « les dieux sont descendus ».
Alors, elles sont là, ces mises en scène inspirées où les dieux descendent sur le spectacle. Le suicide d’un personnage n’a pas été prévu dans le texte ? Qu’importe, s’il transcende le spectacle ! Comme tous les moments magiques, ceux-ci ne sont pas reproductibles, mais les raconter suffit à changer le regard du spectateur (ici, du lecteur) et l’invite à aller plus loin dans sa vision du théâtre, dans sa propre écriture. Un exemple entre cent évoqués par Paul Emond : plutôt que de raconter une fois de plus l’histoire d’Œdipe et les guerres thébaines, il donne la parole à un acteur unique, un témoin inconnu des événements, dans un long monologue (un « seul en scène ») qui pourrait paraître fastidieux sans le travail du metteur en scène : les squelettes des principaux personnages sont esquissés sur le sol, et l’acteur accomplit une sorte de rite funéraire devant ceux dont il parle.
Les plus passionnantes de ces expériences théâtrales ne se contentent pas du metteur en scène, mais comptent sur l’intervention du public, qui devient un personnage de la pièce. Car lui, en définitive, « ne s’y trompe pas ». Lorsque l’acteur ne s’adresse pas à lui, lorsque le « je » l’emporte sur le « tu » dans un monologue, l’attention s’amoindrit. Et son attention influe sur le jeu de l’acteur, sinon sur l’écriture de la pièce. C’est tout un art de faire du public un personnage de la pièce ! Dans Grand Froid, le public est enfermé dans la salle, glacée, et si un spectateur agacé tente de s’échapper, le voilà… abattu d’un coup de revolver – est-ce un acteur, un véritable spectateur ? Laissons le doute. Dans La danse du fumiste, le spectacle n’en finit pas de ne pas commencer. Au moment où le public s’impatiente, un acteur dissimulé dans la salle se met à rire et monte sur scène, comme si un spectateur las d’attendre avait décidé de remplacer les acteurs absents. Est-ce l’auteur, est-ce le metteur en scène qui décide de ces effets ? Qu’importe, si le spectacle est réussi ? Et il l’est lorsque le message parvient à passer par le rôle même du public. Le Château de Kafka, adapté par Paul Emond mais mis en scène par un amoureux de l’Afrique, parvient à traduire par la seule présence d’un acteur noir l’impossibilité de pénétrer dans le château quand l’Europe se barricade comme une forteresse. Les spectateurs, au centre d’une scène « tournante », sont conviés à un dîner spectacle, où ils mangent et regardent celui qui, dans une scène qui les entoure, ne parvient pas à les rejoindre. Leur rôle est soudain essentiel dans l’histoire, car ce sont eux qui défendent leur bien dans le « château » de l’Europe. Je n’ai pas vu le spectacle. Sa seule évocation me donne des frissons.
Le livre fourmille d’anecdotes de cette eau qu’il faudrait toutes citer. Il faudrait parler de l’adaptation, que Paul Emond a pratiquée à maintes reprises : comment passer d’un genre à un autre, partir d’un roman (de Flaubert) ou d’une correspondance (de Pirandello), voire d’une pièce de théâtre (de Shakespeare), ou d’un personnage historique (« J’allais faire de Napoléon un personnage de Paul Emond ! »)… Il faudrait parler de la force performative des mots, lorsque la simple phrase « le couteau tue » matérialise le couteau dans les mains du personnage. Il faudrait parler de ce moment où la situation génère l’intrigue, où les personnages dictent les mots, où la pièce échappe à l’auteur. Et puis, de ce moment où les strates de la réalité se mêlent, où l’on franchit « la lisière de la représentation, la frontière magique » qui séparent auteur, acteurs, public, réalité extérieure, fiction, rêve…
Mais tout cela, et bien d’autres choses, c’est au lecteur de le découvrir, au fil des pages, des réflexions, des anecdotes. Avec ce plaisir subtil d’une écriture qui adopte le ton de la conversation, où l’écrivain interpelle le lecteur (« Hurlez, ô kafkologues et autres gardiens du temple ! »), ou lui-même (« débrouille-toi avec ça, Paul Emond »), sollicite une digression (« laisse-moi encore un peu zigzaguer avant d’y arriver ») ou un sursis (« Un mot encore sur Mon chat s’appelle Odilon »)… En fin de compte, on se retrouve autant spectateur que lecteur d’un livre aussi captivant qu’instructif.
Et n’oublions pas la couverture due à Maja Polackova, qui illustre depuis toujours les livres de Paul Emond, mais dont les personnages aux silhouettes étirées et aux longues mains grandes ouvertes, découpés dans des imprimés, traduisent efficacement ces personnages de mots, d’allure fantomatique, en attente d’incarnation dans un acteur.
Voir aussi : Quarante-neuf têtes dans le miroir.
Retour au sommaire
Véronique Bergen, Moctezuma, le dernier soleil, maelstrÖm, 2024.

L’An I Roseau, « année de toutes les menaces, marquant la fin d’un siècle », est marqué, dans le vaste empire Aztèque de Moctezuma, par « la venue d’êtres de métal que la mer a recrachés ». La conquête du Mexique a commencé, racontée dans ce roman par les autochtones, avec leur vocabulaire, leurs images, leur imaginaire, rythmée par leurs trois calendriers (solaire, sacré, vénusien). Ce sont deux mondes qui se rencontrent, ou plutôt deux visions du monde, dont le seul point commun est « d’appartenir à la pulsation de la planète. »
La parole est donnée à Moctezuma, bien sûr, le dernier roi chargé de maintenir l’ordre cosmique et de tenir tête à l’envahisseur, mais aussi à son vassal, le roi prophète, aux prêtres, au chroniqueur officiel, à l’inverti craignant les persécutions expiatoires, aux Tlaxcaltèques asservis aux Aztèques et tentés de s’affranchir en collaborant avec les Espagnols... Puis, peu à peu, au conquistador qui ne se reconnaît plus dans la boucherie de ses congénères, au silex qui a blessé l’empereur, aux dieux aztèques, qui peuvent s’adresser aux hommes du XXIe siècle, puisqu’ils ne sont plus assujettis à la stricte chronologie.
L’An I Roseau, année de toutes les menaces : tous les signes, présages, prophéties, visions qui « mordent l’âme » concordent pour annoncer la défaite, la fin « de notre monde ». Sans doute y a-t-il un certain fatalisme à accepter l’inéluctable. Puisque les dieux l’ont décidé, il faut s’incliner devant leur choix. Mais le fatalisme n’est pas un renoncement : c’est l’ingéniosité de la romancière de suggérer des échappatoires, dans le cadre d’une logique qui n’est déjà plus la nôtre. Il faut d’abord « tester » les présages, vérifier la véracité des prophéties, et donc ouvrir les hostilités pour voir si elles se réaliseront : au premier combat perdu, il sera tant de craindre leur exactitude. Peut-être, ou peut-être pas... La peur en effet est mauvaise conseillère, elle s’entretient toute seule et dépend des hommes, non des dieux : ne projette-t-on pas ses peurs dans des « formes hostiles qui ne conservent l’existence qu’à être alimentées par nos errances mentales ? » Il ne faut pas s’y fier. Et puis, ne peut-on fléchir le destin ? Offrir des sacrifices pour que les dieux soient avec nous ? Ou alors, rechercher les « chiens galeux », ceux qui ont mécontenté les dieux – autrement dit, se lancer dans la traditionnelle chasse aux invertis, aux gauchers, aux albinos. Sans oublier la duplicité de bon ton avec ceux qui ne connaissent pas nos coutumes : les conquistadors à qui l’on adresse des cadeaux et des paroles de paix ignorent la langue des mains, des yeux, des mots codés, qui parlent au contraire de résistance et de pièges à leur tendre… Les réactions, les conseils, les révoltes des protagonistes déploient toutes les ressources de la casuistique.
Dans le regard des Aztèques, l’opposition entre les deux cultures est irréductible et conduit le lecteur à se regarder lui-même dans le miroir qui lui est tendu. Les valeurs sont inversées, et l’avantage n’est certes pas aux Occidentaux. « S’ils idolâtrent l’or, l’excrément des divinités, c’est parce que leur cœur se compose de déjections. » C’est toute une conception du monde et de la civilisation qui est en cause, en particulier la perception de l’immatériel, du spirituel, du sacré, de l’invisible. « Ils ne voient pas l’invisible » se répète comme une litanie. L’adoration de l’or en est la preuve : « Leur avidité matérielle atteste leur pauvreté spirituelle. » C’est leur faiblesse à long terme, mais dans l’immédiat, n’est-ce pas leur force ? « À force de voir l’invisible, je ne perçois plus rien des réalités tangibles », admet Moctezuma. La progression des conquistadors est fatale.
Le lien profond qui unit ce qui se voit et ce qui ne se voit pas entretient en effet le doute, essentiel mais délétère dans la prise de décision. « Nous n’avons comme unique certitude que celle qui nous enseigne que “toujours” n’existe pas » : sagesse profonde, sans doute, mais acceptation de la destruction inéluctable : « Entre ce qui fut et ce qui sera, le chien peut poser ses crocs et déchirer le fil de soie qui relie les jours, les années. » C’est le revers de cette ouverture aux mondes invisibles. L’avers, c’est la perception permanente de l’unité profonde de l’univers. « Tout, chez nous, porte la trace des dieux, les chiffres, les plantes, les récoltes, les couleurs, les points cardinaux, les saisons, le temps qui repasse par les mêmes points, qui tourne comme tourne la roue de l’écureuil. » À l’inverse des envahisseurs, « fermés à nos associations entre couleurs, dieux et points cardinaux », « pauvres êtres pour qui la matière est inanimée, la forêt vide d’esprit », qui laissent pourrir leur dieu sur un double bâton desséché.
Le discours alors s’élargit et le lecteur pourra trouver, derrière la fiction, des mises en garde qui nous concernent. « Ils ne savent pas que lorsqu’on les blesse volontairement, les forêts, les montagnes se vengent », nous prévient l’Aztèque. L’homme qui « coupe les doigts de fleuves, l’énergie des arbres, les mains de nos guerriers » menace l’équilibre de l’univers, détruit ce qui lui permet d’y vivre, précipite sa propre disparition. « Quand il n’y aura plus rien à exterminer, à saccager, l’homme blanc mourra à petit feu ». Si l’on traite la nature comme une esclave, on rompt l’alliance avec le cosmos. Les derniers témoins de cette alliance, avant leur extermination, peuvent alors lancer cette prophétie qui nous touche de plein fouet : « Dans quelques siècles, les hommes blancs se tordront de douleur, réduits à griller au milieu des flammes décochées par une terre malade, disparaissant sous des avalanches d’eau noire parcourue de serpents à crocs, fauchés par des arcs-en-ciel aux couleurs si vives qu’elles brûleront les rétines des survivants. »
Le regard s’est désormais retourné. Les missionnaires pouvaient se rassurer en reprochant aux peuples qu’ils évangélisaient la cruauté de leurs coutumes, les sacrifices humains, l’avidité des dieux pour le sang, mais les dieux du Nouveau Monde n’ont jamais provoqué la fonte des glaces, la déforestation, les incendies de forêts, les marées noires, les explosions nucléaires… Parler d’anachronisme serait une vision par trop occidentale du temps. Au fur et à mesure du récit, nous sommes au contraire entrés dans un temps cyclique, puis dans un temps arrêté, global, où passé, présent et futur se superposent avec la clarté de l’évidence. Même après sa mort, Moctezuma continue à se battre : « Un empereur mort ne cesse d’être empereur », puisqu’il est et sera de toute éternité. « La nuit où ma mère m’enfanta, j’étais la femme qui accouche du monde ». Les dieux échappent au temps linéaire, les prophètes l’anticipent, les objets sont immuables. Les occidentaux eux-mêmes, lorsqu’ils prennent conscience des désastres qu’ils provoquent, semblent animés d’un esprit bien moderne : ainsi le conquistador écœuré par les exactions de ses pairs apprend-il à respecter le consentement des femmes : « Depuis que nous avons mis pied ici, toute conquête, militaire, religieuse, économique, amoureuse, me fait horreur », explique-t-il, dans un constat qui évoque l’éveil d’une autre sensibilité à notre époque.
Cette dérive temporelle, cette mise en garde du passé au présent, du plus lointain au plus proche, donne au roman une stupéfiante dimension visionnaire. En fin de compte, la parole est donnée au chroniqueur d’un monde perdu, qui dissimule ses écrits dans des jarres enfouies sous terre sans savoir s’il aura jamais un lecteur, ignorant même si le jeune voisin qui l’observe est à la solde des envahisseurs ou peut devenir un allié dans la transmission de la culture. N’est-ce pas le sort de tout écrivain sincère dans un monde en constante mutation ? « Y aura-t-il quelqu’un qui lira les phrases que ma main dépose jour après jour ? » Le roman s’achève superbement sur l’invocation aux vocables magiques, dans une prophétie intemporelle qui appelle à la nécessaire révolte contre toute forme de conquête, de massacre, de perte du sacré. « Nous ne laisserons pas les Blancs saccager l’univers », conclut l’intemporel Moctezuma : « Je porte à mes lèvres une pierre dont les striures forment une figure sacrée. »
Cette prophétie d’un monde à la dérive, cet appel à une urgente prise de conscience, sont portés par une langue somptueuse et poétique, qui traduit en images les réalités inconnues, qu’il s’agisse des armes européennes (le boulet de canon est une pierre céleste qui tombe sur nos têtes), des expériences hallucinogènes (« Sans la danse du peyotl, la lumière fane, perd sa peau de jeune fille ») ou ces interstices presque palpables entre le visible et l’invisible : « Entre son nom et son ombre se tiennent des grains de silex, petits cailloux de folie qu’il mâchonne devant son dieu mort au pagne froissé. » Un roman superbe et nécessaire à notre époque où l’on prend conscience de la fragilité de notre Terre et de notre civilisation. Où l’on peut avoir l’impression que « les ailes du monde se referment sur nous ». Peut-être alors comprendrons-nous l’avertissement mis dans la bouche de Moctezuma : « quand la cinquième création du soleil prendra fin un jour de Quatre Mouvements, je planerai, oiseau de feu dans le ventre de Quetzalcoatl qui reviendra se venger. »
Retour au sommaire
Voir aussi : Écume. Icône H. Clandestine. Le collectionneur.
Caroline de Mulder, La pouponnière d’Himmler, Gallimard, 2024.
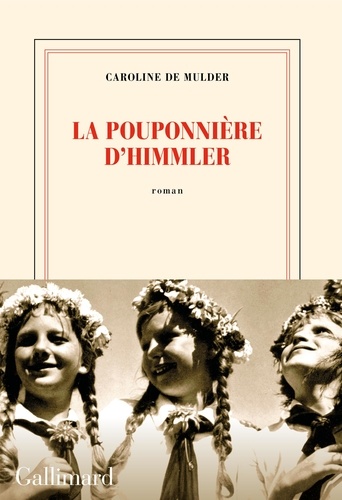
Les pépinières de chair à canon que furent les maternités nazies, où le régime plantait les soldats « de sang pur » dont il aurait besoin dans seize ans, constituent indéniablement un « sujet », terme auquel on réduit aujourd’hui le roman. Un bon sujet pour un bon roman. Caroline de Mulder a su en nuancer le propos en confiant le récit à des protagonistes portant sur l’institution des regards différents, qui se croisent et se répondent, et qui voient successivement dans le Heim – le foyer – un abri, une maison hantée, un dernier refuge, selon l’avancée du roman.
Renée, la principale protagoniste, est une jeune Française, à peine adolescente, séduite par un officier SS, à peine adulte, fuyant sa famille dont elle redoute la réaction lorsqu’elle se retrouve enceinte. Elle est orientée par son amant vers un foyer destiné à accueillir les mères célibataires de bonne race aryenne – elle a la chance d’être rousse, mieux que blonde aux yeux des médecins eugénistes, vom besten Blut, « principalement nordique, légère influence dinarique, quelques traits ostiques, discrets ». Hélas, en 1944, le foyer français est menacé de Libération et elle se retrouve en Bavière, à la maison mère, Heim Hochland, qui devra recueillir, au rythme de l’avancée des alliés, les mères et poupons de toutes les succursales, transformant l’abri en dernier refuge aux conditions de vie effroyables et à l’avenir incertain.
Marek, réfugié polonais évadé de Dachau, qui a perdu femme et bébé à Auschwitz, est le regard de la résistance européenne. Il a refusé de collaborer avec les Allemands pour étendre dans son pays l’influence nazie. Caché dans le parc de la pouponnière, il doit sa survie à quelques morceaux de pain déposés par Renée à son intention. Il jouera un rôle déterminant dans l’issue de l’intrigue.
Helga, l’infirmière modèle et au cœur sensible, est le regard allemand sur ce qui devrait faire la gloire du régime. Endoctrinée, convaincue, mais témoin d’atrocités qu’elle condamne, consciente d’être manipulée, puis horrifiée par la découverte de documents cyniques, elle est sans doute le personnage le plus attachant, dont le regard évolue au cours du roman mais guidée par une compassion constante et une intégrité prise au piège de la propagande.
L’intérêt du sujet, la variété des points de vue, la force des personnages, la méticulosité de la documentation constituent d’indéniables atouts pour un roman d’excellente tenue. Pourquoi n’ai-je pas été séduit au-delà du délassement d’une bonne lecture ? Sans doute à cause du côté trop attendu de ce roman, le dénouement un peu trop convenu, la quatrième de couverture un peu trop aguichante (« reconstituant dans sa réalité historique », comme s’il s’agissait d’un essai, « une plongée saisissante dans l’Allemagne nazie envisagée du point de vue des femmes », comme si le personnage de Marek, pourtant la clé de l’intrigue, n’avait aucune importance dans la perspective nécessairement #MeToo de tout roman moderne qui se respecte). Surtout à cause de l’artificialité de la construction, qui écorne la vraisemblance censée créée par l’abondante bibliographie sélective.
Cela se ressent surtout dans les dialogues et les fragments de journal. Dans un roman traditionnel, lorsque les personnages parlent des langues différentes, il est de tradition de les faire dialoguer dans la langue du récit ; la convention est suffisamment ancrée pour que le lecteur ne le remarque pas. On peut rejeter cette convention, tenter, comme jadis Robert Merle, de se rapprocher au plus près de la langue des personnages, mais il serait hors de question, dans un roman francophone, de faire parler les Allemands en allemand et les Polonais en polonais. Mais pourquoi inventer une langue composite, où les Allemands, même entre eux, même dans leur journal intime, parlent un français rehaussé de quelques termes allemands pour faire couleur locale ? L’artifice saute aussitôt aux yeux, surtout lorsque les termes choisis sont proches dans les deux langues (mention spéciale pour « la Desinfektion miséricordieuse »), surtout lorsque deux Allemandes correspondant en français pour être comprises du lecteur croient utile de traduire en français un mot allemand échappé à leur plume (« pour que notre race soit de nouveau rein, pure » - « Vous êtes ein braves Mädchen, une honnête fille, Schwester Helga »). J’avoue avoir dû maîtriser un fou rire dans les passages les plus sombres du roman. Symbole peut-être de cette hybridation des langues, le titre qui semble considérer Himmler comme un nom français sans h aspirée (d’Himmler et non de Himmler) au détriment de la vraisemblance et de la cohérence (le roman dit bien « le Heim », « de Haydn », « de Himmler »).
Artificiels, aussi, les passages rayés dans le journal intime de Helga, censés traduire les contradictions de sa pensée, ou la peur d’un regard extérieur (« Tout ceci [d’une grande tristesse] inévitable »), mais bien lisibles pour le lecteur. Artificielle, la découverte in extremis de dossiers confidentiels expliquant à Helga, mais surtout au lecteur, l’atrocité cynique de l’entreprise. À force de penser à la transparence du texte, on finit par le montrer du doigt. La construction un peu trop apparente m’a fait penser à un beau palais dont on aurait omis d’ôter les échafaudages. Dommage, j’aurais eu plaisir à y habiter.
Voir aussi : Ego tango.
Retour au sommaire
Hubert Haddad, La symphonie atlantique, Zulma, 2024.
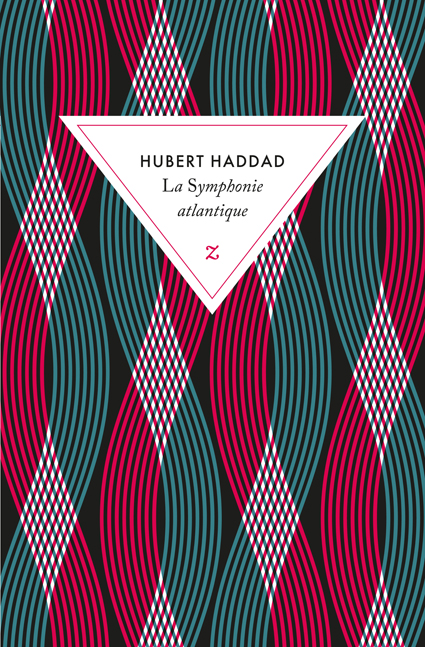
« Il existe sur cette terre maudite des êtres au diapason de l’inaudible, là où le monde fait défaut. » La terre maudite, c’est l’Allemagne nazie, quelques années avant la guerre, lorsque le monde effectivement « fait défaut », au moment où l’on commence à prendre conscience de la menace du régime. Les êtres « au diapason de l’inaudible » sont alors pris au piège en train de se refermer sur Ratisbonne. Handa Meyersohn, étudiante en musicologie au Conservatoire, est juive. Maria-Anke Oberndorf, jadis chanteuse à l’opéra de Cologne, est sujette à des « fragilités » psychologiques. Elle vague dans la ville « comme un beau voilier, un vaisseau fantôme ». Mais sa liaison avec un prêtre fait aussi scandale. Tout cela lui vaut une inscription à l’index des services de santé et d’hygiène raciale, qui lui sera fatale. Son fils de cinq ans, Clemens, doit affronter un autre danger : considéré comme un « jeune spécimen rassemblant tous les attributs de l’aryanité », il peut être « confisqué » par le régime…
S’ils sont au diapason de l’inaudible, c’est que leur monde s’est créé et maintient son équilibre dans la musique, omniprésente et magistrale dans ce roman : le chant de Clara, le piano de Maria-Anke et, surtout, le violon de Clemens, dont il parle comme de son jumeau, mais un jumeau vital – « sans lui je n’existe plus » – un jumeau nécessaire pour « être présent au monde ». Le violon, dont il joue avec une maestria et une sensibilité qui lui attirent aussitôt l’admiration et la protection de ses auditeurs, l’accompagne tout au long de ses périples dans un pays endoctriné, puis dévasté par la guerre.
Sa mère, qui comprend la menace pesant sur elle, a juste le temps, avant de disparaître, de le confier à un oncle en Forêt-Noire. Celui-ci veut épargner au gamin la propagande raciste des écoles et parvient à le tenir à l’abri de l’enrôlement forcé dans les jeunesses hitlériennes. Mais la mort du vieil homme remet Constans sur la route. Protégé grâce à son talent par un énigmatique officier allemand portant le même nom que lui, Clemens est finalement confié à une institution spécialisée, qui échappe encore à la prédominance du sport sur les activités culturelle – un « îlot mental » qui peut encore entretenir un « devoir d’oubli, ou plutôt de distraction » face au monde délétère. On pense au poète d’Horace, l’integer vitae, que les dangers de la vie ne peuvent atteindre parce qu’il est réfugié dans un autre monde. Mais la guerre finira bien par rattraper Clemens.
Le récit joue alors sur les parallélismes, les contrastes violents entre ce monde protégé de l’enfance (Clemens est suivi de ses cinq à ses quinze ans) ou de la musique, et les bouleversements du monde. Parfois avec une ironie décapante – les meilleurs écrivains de la bibliothèque sont repérés grâce aux listes noires des écrits nuisibles et indésirables. Parfois, dans une échappée onirique cruelle pour le lecteur. Au milieu des alertes, Clemens peut encore se croire dans un monstrueux théâtre – après les bombardements, les nuages de fumée se referment comme des rideaux de scène. Le vacarme peut évoquer la Cinquième de Beethoven. Mais la réalité de la guerre, avec l’adolescence, le rattrape. Peut-on longtemps, pour défier les bombes, jouer une sonate de Schumann « en contrepoint d’une proche apocalypse » ?
Dans un monde qui leur échappe, avec une sensibilité exacerbée à « l’inaudible », les personnages sont hantés par les disparus, morts, perdus de vue, rattrapés par un destin néfaste. Le ton est donné d’emblée : « Rien de plus effrayant que la discrétion des fantômes, leur souffle mal retenu, quand le silence l’emporte sur les vivants ». Handa, l’étudiante à qui est confiée l’éducation musicale de Clemens, est ainsi obsédée par la partition manuscrite laissée par son frère sur le pupitre du piano à demi-queue le soir où il s’est donné la mort. Un soir, Clemens surprend Susanne, son professeur de musique avec laquelle il conjure la guerre par de séraphiques duos, interprétant seule une sonate de Bartók, dont elle ne joue que la partie pour piano, respectant le silence du violon, dans « une étrange impression de vain appel et d’infinie solitude » : « la mort, si près, jouait en secret duetto ». Il arrive aussi que des disparus émergent comme des fantômes, comme cette jeune morte retrouvée nue dans les gravois d’un bombardement, semblable à « une de ces créatures pélagiques décrites dans les contes traduits du vieux norrois ». Mais n’est-ce pas le propre de la musique, qui en dit bien plus que le langage sans recours aux mots, de rendre par le son sensible à l’inaudible ? « La musique habite un monde inaccessible, elle est comme l’âme des absents. »
Cette présence quasi sensible de l’absence, jointe à celle des lieux (« Un vide indicible s’identifiait aux lieux, à la chaux vive du ciel, à cette clarté plâtreuse du jour ») n’est pas un refus du monde, mais une autre manière de l’appréhender, par une écoute attentive de sa doublure silencieuse. Des « interférences » ne manquent pas de se produire entre la réalité et l’esprit : « la privation du deuil, lorsqu’elle s’envenime, provoque une sorte d’inflammation des signes, de mise à feu des coïncidences ». De même qu’André Breton, dans l’exaltation de l’amour, transforme les coïncidences en hasards objectifs, le monde prend sens par l’hypersensibilité à tout ce qui qui lui échappe. Aussi le monde extérieur, les paysages, les sensations, sont-ils d’une extraordinaire précision dans ce roman de haut vol, où l’intrigue, les personnages et les lieux se conjuguent en une évocation puissante d’un monde à la dérive.
L’écriture d’Hubert Haddad, riche en métaphores et en images d’une exactitude fulgurante, traduit parfaitement la richesse d’un monde où les sensations se percutent. La marche dans la neige (« La neige à chaque pas faisait un bruit de bois sec qu’on brûle ») n’a pas le même son que dans une forêt de pins (les chemins tapissés d’aiguilles « en si épaisses aggradations que les pas amortis n’émettaient qu’un léger froissement »). Le salut nazi est à l’image du régime (« levant le bras à tout moment, main tendue, comme des ressorts de piège à souris »). Les bombes sont les outils d’un contre-travail urbanistique (« le pilon sismique des bombes écrasait l’un ou l’autre quartier de la ville »). Quant au ciel survolant ce monde de contrastes extrêmes, on ne sait plus comment interpréter ses signes : « les nuages dehors s’enroulaient pareils aux corps nus des amants, ou des cadavres charriés dans une fosse. »
Entre les victimes de cette barbarie nazie paradoxalement pétrie de culture et les innocents brutalement confrontés à ses horreurs, le roman nous renvoie à des questions hélas toujours d’actualité, auxquelles il ne prétend pas apporter de réponses, mais que posent éternellement tous les oubliés de l’Histoire.
Voir aussi : Le camp du bandit mauresque, Petite suite cherbourgeoise, La culture de l'hystérie n'est pas une spécialité horticole, Le nouveau nouveau magasin d’écriture, Oholiba des songes, Palestine, Géométrie d'un rêve, Vent printanier, Opium Poppy, Sonetti di dolore, Le peintre d'éventail, Premières neiges sur Pondichéry, Mâ, Casting sauvage. La sirène d'Isé. L'invention du diable, Un monstre et un chaos.
Retour au sommaire
Victoire de Changy, Immensità, Cambourakis, 2024.

Mauve, dix-sept ans, suit des cours de trompette à l’académie d’Immensità, lorsqu’un violent tremblement de terre détruit la ville. Les rares survivants se retrouvent dans un des cinq dispensaires extérieurs, « dans un état de cassure plus ou moins avancé », sans nouvelles de leur famille, sinon des « listes de vivants » et d’« en-allés », régulièrement rafraîchies. De même pour le sort de la ville, dont on ne prend conscience qu’au rythme des objets que charrie la « rivière-qui-pleure ». Déracinés bien plus que blessés. Alors, ils se racontent l’un à l’autre. Après un an et demi, lorsque le dernier d’entre eux est guéri, car la décision à prendre doit être collective, la question leur est posée : veulent-ils revenir à Immensità ou rester dans ce monde extérieur qu’ils ont appris à apprivoiser mais qu’ils ne connaissent que par ses dispensaires ?
Pour comprendre la décision, il faut s’imprégner de l’atmosphère de la ville, de ses habitants, de ses habitudes. Il y a bien sûr Mauve, la jeune fille frappée d’une blessure originelle, à la sensibilité exacerbée, douée de synesthésie, musicienne dans l’âme. Pour elles, les notes ont une texture, un caractère. « Les dièses sont bêtes, et les bémols carrément méchants. » Il y a ses trois parents : « un père, un autre père et une mère », car devant la stérilité du couple, on a fait appel à Pépa. La mère est une pianiste virtuose, ce qui fascine et paralyse Mauve. Et puis, il y a Pons et Léore, rencontrés au dispensaire.
Mais le vrai personnage est Imensità, la ville imaginaire, à l’urbanisme révolutionnaire. Aucun logement n’y dispose d’un espace extérieur privé – pas de jardin, ni de balcon ni d’arrière-cour, donc, mais « le » Jardin, poumon et cœur de la ville, qui occupe la moitié de sa superficie. C’est le refuge de tous les animaux, y compris ceux disparus du reste de la planète. Le Jardin est plus qu’un espace vert, c’est une manière de vivre, de mourir, de subsister. « Le verbe jardiner, à Immensità, avait un autre sens qu’ailleurs. Par jardiner, on entendait la sensation d’être à sa juste place, au moment exact, absolument présent. Ainsi, même si c’était rare, on pouvait avoir jardiné en dehors du Jardin, aux côtés, par exemple, d’un être cher. »
Le rapport aux autres est également différent. Le tutoiement n’existe pas, le vouvoiement traduit « l’addition des vies passées dans un même corps. On s’adresse aux personnes en vous pour ce qu’elles contiennent de multiple en elles. » Et la mort du coup y a un autre sens. Enterrés sans vêtement ni cercueil, les disparus, « avec les mois et les années, deviennent le Jardin ».
Tout ceci est nécessaire pour comprendre la décision massive des survivants de revenir à Immensità, malgré sa destruction. Tous répondent qu’ils reviennent pour retrouver le Jardin, mais la vérité est peut-être tout autre. À force de se raconter les uns aux autres, pendant une aussi longue période, leur inconscient est devenu collectif grâce à autant de souvenirs communs. Car tout est à recommencer, les souvenirs ne suffisent plus, les repères ont disparu. On ne reconnaît plus le Jardin et, horreur suprême, les morts ont été brûlés, ce qui interdit toute prise en charge de la continuité des vies symbolisées par l’usage du « vous ».
Il faut alors « se regrouper autour d’un projet commun, plus important que le Jardin ». Le salut viendra, assez classiquement, de la première naissance, saluée par un vibrant : « Ils arrivent ! » Car le premier bébé de la nouvelle Immensità renoue le fil rompu et réunit en lui toutes les vies présentes et à venir.
Le roman aurait pu s’arrêter là et aurait constitué une belle fable de l’espoir ressuscité. La romancière a choisi d’en préciser les contours en quelques pages qui ne m’ont pas semblé essentielles. Faire un sort aux souvenirs d’enfance ancrés dans une cicatrice intrigante, rompre avec l’interdiction de posséder une parcelle extérieure à son habitation, imaginer les nouveaux bâtiments, l’hôpital à l’identique, plusieurs écoles au lieu d’une seule… Tout cela, si la nécessité s’en fait sentir, aurait à mon sens mérité une partie supplémentaire, mais les précisions apportées brisent un peu l’imagination du lecteur.
Le roman néanmoins est plaisant, avec le souci de préciser au mieux les sensations (« Mauve observe en elle cette sensation de grand nœud qui se subdivise peu à peu en un millier d’autres, et ceux-ci se desserrent lentement, un à un »), une vraie volonté d’aller au-delà de l’anecdotique (« C’est amusant, ce que l’esprit trouve pour fabriquer du sens »), quelques touches d’humour parfois surprenantes (les perroquets de l’hôpital ont appris à répéter les électrocardiogrammes, à la grande frayeur des patients et des médecins), une grande générosité et, surtout, beaucoup de poésie.
Retour au sommaire
Rachel M. Cholz, Pipeline, Seuil, 2024.
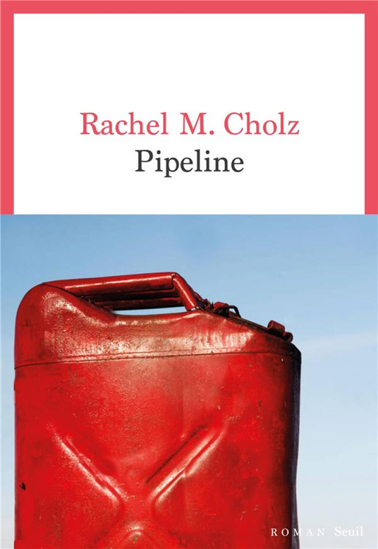
Survivre dans une banlieue dangereuse de Bruxelles, pour une bande de petites frappes qui n’est pas liée aux mafias locales, ça demande de l’imagination, du cran et un peu de chance. En l’occurrence, Alix (au prénom épicène, le mot est à la mode, mais c’est bien un mâle) et la narratrice se sont lancés dans le siphonage du gazole dans les réservoirs, pour le revendre dans les garages du coin. Voilà pour l’imagination. La chance, c’est de dégotter un pipeline sur lequel il suffit de poser un robinet pour passer au haut débit. Puis deux robinets directement branchés sur un camion-citerne ! Jusqu’à ne plus savoir comment écouler le stock accumulé dans des bidons qui envahissent l’appartement. Les combines avec des garages spécialisés, les compagnies d’Uber ou de taxis ne suffisent plus, il faut s’acoquiner avec la mafia locale. Et c’est là qu’il faut du cran. Mais au-delà de la survie, il y a l’adrénaline – « remplir sa gueule de gras, c’est comme la clope, l’alcool et la musique. Ça rend addict. »
J’avoue avoir eu du mal à rentrer dans un roman à la provocation bien conventionnelle. La langue relâchée, les gros mots d’usage, ça ne m’excite plus guère. Certes, on y pisse avec tact, en égouttant son sexe, on y vomit à peine et on ne s’encule que par distraction, mais tout ça a un remugle de déjà lu qui peut agacer le plus passionné de littérature crado. En revanche, lorsque le terme ordurier aboutit à une métaphore bienvenue, il a toute sa place – par exemple, lorsqu’on vomit comme un champignon qui s’étend sur le carrelage, ou lorsque le sang qui sort de l’animal devient « de l’encre mise en lumière ».
Je n’ai guère été accroché non plus par le côté « mode d’emploi » censé crédibiliser le récit mais qui finit par l’alourdir – sauf si l’on a pour ambition de trancher le shit en barrettes avec l’ongle du pouce ou de distiller le fioul selon une méthode artisanale. Pourtant, ces ados perdus sont en définitive sympathiques, en particulier Alex, petit et râblé parce que personne ne lui a expliqué que la musculation arrêtait la croissance, dansant sur les voies rapides et aux feux rouges au risque de chutes dangereuses, habile à embrouiller la police et crâne devant les grosses pointures de la délinquance locale.
Et surtout, dans cet engrenage vertigineux, la plume s’emballe en quelques scènes grandioses qui valent le détour : les soirées de démesure, lorsque « la danse collective devient un muscle et un cerveau autonome » ; le jaillissement du pipeline qui donne un sentiment de puissance, lorsqu’on devient « le ravitaillement dégénéré d’une population entière » ; l’envahissement des jerrycans qui obstruent les appartements et la géniale idée de les faire transporter trois par trois dans des poussettes par des mères de famille complices… L’exagération épique prend alors des dimensions cosmiques qui rappellent l’Assommoir de Zola se déversant sur Paris : « On le sait qu’on est devenu une tumeur. On a propagé la lésion par les réseaux et par les rencontres. Notre or noir coule dans les vaisseaux lymphatiques des quartiers. Ça se propage. Ça se consomme. On le sait que notre gazole file dans tous les taxis qu’on prend et qu’on voit passer. »
Car Rachel M. Cholz n’a pas besoin de surfer sur les modes : elle a un vrai talent d’écrivain. Quelques formules percutantes font mouche, bien plus que les mots orduriers : « sa présence qui me tombe dessus » ; « il y a une violence en lui, une violence sans mère ». L’obsession sexuelle ne se manifeste pas dans les scènes érotiques (plutôt exceptionnelles), mais dans des métaphores filées, avec plus ou moins de goût, mais que l’on se prend à saluer. Les viandes du kebab qui tapinent derrière la vitrine, montées sur des aiguilles et que l’on prend en sandwich, ne m’ont pas particulièrement amusé. Le parallélisme entre la nuit d’amour et l’extraction du pétrole est en revanche bien mené – « c’est la grande aventure des trous sombres » ; « pétrole, c’est l’aventure et la violation de la terre » ; « l’ithyphalle de l’anthropocène bande au coucher du soleil » (faut oser…). Peut-être ce qui manque le plus à l’autrice est le discernement entre l’effet de mode, le tic d’écriture, et la force d’une langue originale. Car il y a une sacrée plume en germe dans ce premier roman.
Retour au sommaire
Roxane Lefebvre, Alna à l’horizon de nos ventres, roman poétique, maelstrÖm reEvolution

« Arrosons les mondes de demain
Tressons création et procréation
Que la pensée naisse de nos corps
Enracinée dans nos viscères
Résolument
Au service du Vivant »
La création se tresse intimement à la procréation dans ce roman où les livres et la maternité se répondent dans la vie et la pensée d’Alna. La prose et la poésie s’entrelacent, bien plus que n’alternent les passages en vers et en prose. La terre et la mer s’entremêlent, dans son imaginaire irrigué de mythologie antique. Alna vit dans une petite ville non loin de la mer, à la frontière de ces deux empires originels, dont lui parlait son père dans un mélange de Bible, de mythologie antique et de théories scientifiques. La Création, elle la vit au jour le jour, elle, tournée vers la mer, et son compagnon, jardinier, cultivant la terre. Face à la mer, elle rêve du « sentiment océanique » nommé jadis par Romain Rolland mais ressenti de toute éternité par l’homme face à ce qui le dépasse. « Elle deviendrait elle-même un fragment de cette étendue, de cette masse compacte, de cette rencontre entre la terre et l’eau. » Appel de la plénitude, qui ne peut passer que par la vacuité totale, par l’injonction de se laisser envahir par « l’infinité de la lumière sur l’eau où ses yeux se perdraient ». Car « à mesure qu’elle se remplirait par tous ses pores, tous ses sens, tous ses orifices, elle se viderait d’elle-même. » C’est cela, bien sûr qui séduira d’abord dans ce roman ceux qui croient comme moi à une mystique athée.
Les choses ne sont pas si simples. La présence de son compagnon à ses côtés retient Alna sur le sable : le monde du jardinier n’est pas celui de la mer. C’est un monde d’homme. Cette impossibilité de vivre totalement l’immersion dans l’infini en présence de son compagnon répond symboliquement à la stérilité du couple. La fécondité est affaire de femme : Alna a mal vécu la brutalité du discours médical, un discours d’homme, scientifique, mais « aride » - et le terme semble lui-même faire écho à la stérilité de son corps. « Tous ces discours lui paraissaient d’une aridité sans nom. Elle tentait de s’en remettre aux médecins dans la confiance et la détente. D’y glisser un peu de poésie et d’humour. » La poésie peut-elle guérir l’aridité du discours masculin ? Oui, si la langue devient grâce à elle un lieu de création. Ainsi la forme du « roman poétique » correspond-elle étroitement au rêve de gestation.
Ainsi peut commencer l’histoire. Il faudra un long travail d’acceptation pour dépasser l’échec, en imaginant une cérémonie d’adieu à l’enfant qu’elle n’aura pas. Alna peut alors entrer dans la mer, dans une fusion déterminante avec la Création, une expérience bouleversante de l’infini. Mais une fois de plus, la présence de l’homme rompt le charme. Lorsque son compagnon la rejoint, « son corps avait d’un coup retrouvé ses limites ». Plus que jamais, l’opposition entre mer et terre investit l’imaginaire d’Alna. On la retrouve dans plusieurs images qui traversent le roman. N’habite-t-elle pas dans la vieille ville, « au centre de la coquille d’escargot », animal terrestre par excellence, dont la spirale se referme sur elle-même ? Et les animaux marins, comme les dauphins, ne l’ouvrent-ils pas, à l’inverse, vers l’infini ? Auprès d’une femelle, elle a l’impression de vivre une communication sans mots, « comme si elles s’échangeaient des hologrammes sensoriels, sans besoin de l’intermédiaire du langage ».
Se retrouver au-delà des mots : seule façon d’échapper au langage qui, « comme le sexe, coupe. » Du moins celui de la prose, des médecins, du discours logique, encombrés de mots aux contours nets pour assurer une communication sans ambiguïté. « Un trajet que les mots doivent parcourir entre celui qui pense et ce qui est pensé, comme le trajet des ultrasons des dauphins ou de l’échographie. » Aller au-delà, communiquer sans le secours du langage, c’est trancher les mots, l’écran qui s’interpose entre l’homme et la sensation brute. De tous temps, ceux qui ont connu cette expérience bouleversante se sont plaint de l’impossibilité de la traduire en mots.
Mais dans le roman de Roxane Lefebvre, l’image du langage « qui coupe » a un sens plus large. Dans la vision mythologique de son père, la Création est ce moment où Ouranos, le Ciel, pénètre Gaïa, la Terre, mais où Chronos, le Temps, tranche le sexe de son père au cœur même de la fusion cosmique. « Le temps avait séparé la fusion originelle. Le temps qui courait entre ciel et terre. » Et le pouvoir depuis est resté du côté des hommes. Ceux-ci n’ont cessé d’ériger des tours, de Babel aux buildings, « de grands sexes de fer et de verre pour célébrer la victoire du temps sur le ciel. » La rancune englobe par moments l’ensemble de la gent masculine, comme lorsqu’Alna évoque un ancien professeur : « Encore un qui construisait des tours de verre irréprochables pour se dégager de sa mère boueuse et sortir de la cuisse de Jupiter. »
« L’aridité » du discours, image de la stérilité qui l’oppresse, ne serait-elle qu’une conséquence de cette castration cosmique originelle, une sorte de vengeance divine ? « La Gaïa des récits paternels était-elle si en colère qu’elle bouchait les utérus des mères ? Violentée par des siècles d’extractivisme esclavagiste, refuserait-elle bientôt à l’humanité toute descendance ? » La colère se tourne alors vers toutes les violences subies par la Terre, par les femmes, par l’humanité, pollution, pesticides, herbicides, féminicides, fast food… L’image de l’homme, c’est aussi celle du père, qui l’a certes initiée à la mythologie, mais qui a disparu on ne sait où, en Amérique ou en Asie, laissant femme et enfant. C’est la rancune de la mère, qui veut faire le vide de tout ce qu’il a laissé – « Je jette. Trop de traces déjà, trop d’échos ! » Vengeance de Gaïa après la rupture originelle, liée à l’infertilité qui obsède Alna. La phrase « Il va falloir faire le vide ici » revient à la jeune femme chaque fois que le sang coule entre ses jambes, lui rappelant l’échec de la procréation.
Même ambiguïté dans le monde des livres, « son labyrinthe préféré ». Ils lui rappellent son père, qui lui a légué une impressionnante bibliothèque de poésie. Lectures vivifiantes, certes, mais angoissantes, aussi. Car les « petits caractères d’imprimerie recueillis dans les livres de sa bibliothèque » la tiennent éloignée de « la mémoire des cellules » dont elle rêve. Cruel paradoxe de devoir recourir à la parole, au langage, aux livres, pour traduire ce rêve de leur échapper ! Ce conflit intérieur ne manque pas d’intérêt, mais est parfois un peu trop formalisé, intellectualisé. Dans son rejet de l’univers masculin, Alna décide de se constituer un matrimoine, « un panthéon exclusivement féminin » de chercheuses, d’artistes, de militantes, de créatrices.
Ces thématiques à la mode qui, je l’avoue, m’ont nettement moins séduit, ne constituent pas le fond du roman. Après le rituel d’adieu à l’enfant qui ne viendra pas, Alna se tourne vers l’écriture et les dessins, comme une autre création qui se substituerait à la procréation, qui rejoindrait la grande Création. Ce transfert symbolique l’a-t-il libérée ? Tout à coup, alors que toutes les tentatives ont échoué, survient une grossesse inattendue. Le temps de la réconciliation est-il arrivé ? Lentement. Il faut passer par d’autres peurs, nées de discussions avec d’autres mères dans les groupes de parole, avec la litanie des expériences partagées – il y a toujours « celle qui » quelque chose… Et toujours, l’inévitable confrontation entre le monde masculin et le monde féminin, puisqu’Alna en vient à rêver au temps des sages-femmes, avant que les hommes prennent la main sur l’accouchement ! La gestation bouleverse sa perception du monde, entre ses lectures et des retours de mémoire, « comme si l’arrivée d’un enfant secouait les sables de son inconscient ».
Et c’est dans cette confusion d’idées et de sentiments que se trouve un nouvel équilibre, grâce à la lecture de Lynn Margulis, une microbiologiste qui conteste la sélection naturelle. Plutôt que de voir la compétition à l’œuvre dans l’évolution des espèces, elle estime que la vie se répand sur la planète par coopération et non par combat. La biosphère terrestre se comportait selon elle comme un organisme unique, « un seul gigantesque être vivant ». Alna ne serait-elle qu’une bactérie à l’échelle de la planète ? « Pouvoir être touchée, traversée par tout le reste », et « traverser soi-même tout le reste » : l’expérience mystique, le sentiment océanique trouve ici sa justification scientifique. Alna apprend à se définir par une absence de matière et non comme un excès de matière. « L’absence ouvrait, interrogeait, attirait, ambivalente et fascinante. Provoquait un appel d’air en elle, un élan, un mouvement de création. C’était assez précisément ce qu’elle aimait dans la vie. La faille, la béance, la porosité. » La pensée comme l’enfant à venir naît enfin de ses viscères, résolument, au service du Vivant. L’expérience mystique est arrivée à son terme.
Retour au sommaire
David Le Breton, La fin de la conversation ? La parole dans une société spectrale, Métailié, 2024.

Paradoxe, de prendre pour sujet l’art de la parole dans une société qui n’a jamais été aussi bavarde ? Peut-être, mais le paradoxe vient de la société, non de son analyste. Le vrai paradoxe, c’est l’explosion de l’isolement dans une société de communication, du repli sur soi alors que l’on croit tisser des « réseaux » de plus en plus serrés, des certitudes hâtives quand on promeut le débat. Tout cela est bien connu et analysé de longue date – la question se posait déjà, nous rappelle David Le Breton, quand le télégraphe a supplanté la longue correspondance… Aussi ne faut-il pas prendre ce bref essai comme une analyse approfondie – qui n’aurait pu qu’enfoncer des portes ouvertes – mais comme un trousseau de clés ouvrant d’innombrables portes dans le labyrinthe du quotidien. Et de ce point de vue, il est particulièrement éclairant.
La conversation traîne un parfum suranné d’ancien régime, avec ses salons, ses causeuses, ses arts de converser en parfait honnête homme… Son principe repose sur la gratuité. « On parle pour parler, pour le seul plaisir de l’échange, par amitié, par jeu, par politesse, par souci de s’informer… » Ni utilitaire, ni fonctionnelle, elle est choisie, libre, spontanée. Elle se distingue autant de la communication qui poursuit un but (souvent bien égoïste : faire connaître son opinion personnelle) que du bavardage (tout aussi égoïste, puisqu’il ne vise qu’à rompre sa propre solitude). « À la différence de la conversation, plus on communique et moins on se rencontre, plus l’autre vivant près de soi devient superflu », analyse l’auteur. On peut en dire autant du bavardage qui règne en maître sur les réseaux sociaux.
Il ne suffit donc pas d’être deux pour converser. La conversation est avant tout un rapport à l’autre, qui s’appuie sur un principe d’égalité, de symétrie, de réciprocité. « Elle repose sur la ritualité d’un va-et-vient de la parole selon des principes que les acteurs doivent maintenir pour s’entendre : un respect du tour de parole, une écoute réciproque, une distance physique propre à leur degré de familiarité, des tonalités de voix appropriées… » Elle a besoin d’une mise en scène, d’une ritualisation, du face à face qui permet d’interpréter les variations des expressions et d’adapter son discours à son vis-à-vis « dans la transparence morale de leur visage ». L’époque classique avait codifié cet art de l’honnête homme, qui n’est pas nécessairement le plus brillant causeur, mais celui qui connaît les règles du savoir-vivre-ensemble. « Les gens les plus doctes ne sont pas les plus propres pour la conversation », note Furetière en 1685…
De ce fait, la conversation est à la croisée des chemins entre la parole et le silence – c’est, de mon point de vue, la partie la plus subtile de ce petit traité. Plus que la parole, elle repose sur un échange de mots et de pauses pour réfléchir ou écouter l’autre. Un silence actif, puisqu’il oblige à être attentif à l’autre, à repérer le moment où sa voix diminue d’intensité pour prendre la parole, échanger des arguments ou proposer une digression. « Le silence dans la conversation, c’est la place de l’autre dans l’échange. » Le silence – auquel David Le Breton a consacré jadis un autre essai – est la phobie de nos sociétés – il fut une époque où, dans le montage d’une émission radio différée, on faisait la chasse aux blancs et aux « euh » quand aujourd’hui, on enregistre du silence en vue d’éventuels montages, parce que sa qualité diffère d’un entretien à l’autre... La société moderne vit une disparition insidieuse du « silence ambiant » au profit d’une « soupe » sonore où se mêlent des bribes de musique échappée à des écouteurs mal ajustés (quand il y a des écouteurs !), des conversations téléphoniques à voix haute (plus fortes que les conversations entre voisins !), des bruits de circulation…
On perd aussi dans cette hyper-communication la capacité à être seul : plus de temps mort, de retrait sur soi, on risque toujours d’être interrompu par son portable. Avec une réaction paradoxale : la mode des retraites sans téléphone, des séjours de méditation, de la marche… Certains sont en quête de changement dans leur relation au monde. Cela pourrait sembler une saine réaction face à l’envahissement de la technologie de communication, mais il s’agit toujours d’une solution transitoire avant de replonger dans un mode de vie tout aussi stressant. Nous vivons dans une société du zapping et du surfing, qui engloutit la concentration nécessaire à la réflexion. Une société du phubing (l’envoi de SMS tout en continuant à regarder son interlocuteur dans les yeux), de la Fomo (fear of Missing Out), ce stress né de l’angoisse de rater une information urgente… Une société de dissolution de l’individu dans la foule d’identités qu’il doit adopter sur les réseaux sociaux, où le sujet post-moderne devient fractal, dilué dans une multitude de branchements et d’identités possibles. Bref, une société spectrale.
Cette disparition conjointe du silence et de la conversation (qui semblerait son contraire dans une vue superficielle) explique le paradoxe de notre société, où le sentiment de solitude se développe parallèlement à la multiplication des moyens pour la rompre. Une psychologue a noté la montée depuis 2010 d’un sentiment de solitude et de dépression chez les enfants américains, conjointement à une baisse du sentiment de joie. On y répond par l’invention de robots sociaux, dont les voix de synthèse, de plus en plus convaincantes, donnent une fausse illusion d’interaction. La société de communication risque de devenir une société du « sans contact » !
Sans contact… ou contact en boucle avec nous-mêmes ? C’est une autre porte qui s’ouvre dans le labyrinthe moderne. Les moyens de communication, en multipliant les choix et en supprimant les contacts directs, développent une passion du même : on cherche son reflet dans le miroir des réseaux sociaux alors que la conversation repose sur la possibilité d’une contradiction. Le « risque de la vulnérabilité » que nous prenons en dialoguant directement avec l’autre disparaît lorsqu’on se replie sur le même. Nous avons craint, naguère, le Big Brother qui nous surveille, mais en fin de compte nous nous retrouvons avec une Big Mother qui pourvoie « un divertissement sans fin, une sorte d’enveloppement bienveillant, toujours disponible, sous la main, sans risque de rebuffade. »
Conséquence ? Peut-être la violence, qui se déploie d’abord sur les réseaux avant de déborder dans la « vraie vie ». La parole est la première digue à opposer à la violence : elle permet d’ignorer les insultes ou de les balayer d’un geste, de répondre à un argument, de renouer la conversation par un trait d’humour … La parole sans contradiction ni réaction engendre l’intolérance.
En fin de compte, cette courte réflexion menée sur le ton de la conversation nous amène à réfléchir à nombre de phénomènes de la société moderne. On pourrait regretter une sorte de fatalisme, l’auteur étant bien conscient que sa position est « à contre-courant du technoprophétisme qui domine les discours ambiants ». « Nous n’avons plus le choix », conclut-il, puisque la connexion est désormais indispensable pour toutes les tâches administratives et pour nombre d’activités. Alors, la conversation ne serait-elle qu’une « résistance » au monde moderne ? Ça se discute…
Retour au sommaire
Philippe Marcezwski, Quand Cécile, Seuil, 2024.

« Comme les villes qu’il faut sans cesse rebâtir sur leurs propres ruines il faut édifier cent fois la mémoire de peur qu’elle ne s’enfonce dans la terre ». Roman de la mémoire, de ses surprenantes ramifications, de ses pièges… Cécile est morte dans un accident d’avion. Elle avait vingt-sept ans. Le protagoniste de ce roman n’était pas particulièrement proche d’elle, mais il avait vécu une brève aventure avec elle dans sa jeunesse. Une amourette qui ne s’est distinguée ni par sa durée ni par son intensité et qui a fini par une curieuse muflerie – il lui demande de partir au milieu de la nuit « parce que ça ne rimait à rien tout cela ». Qu’en reste-t-il ? Un remords tardif, peut-être, ou un regard privilégié. Et la surprise de cette mort inattendue, qu’il éprouve le besoin d’annoncer à tout le monde. Pas de quoi remuer la mémoire. Dans un premier temps, il se sent d’ailleurs « moins triste que ce qu’il aurait fallu », au point d’être « honteux de son bonheur » lorsqu’il lui prend fantaisie de repeindre sa chambre. Sa mémoire est même plusieurs prise fois en défaut : il ne connaît pas les goûts de Cécile (pour les roses blanches en particulier) et confond les événements (l’accident d’avion de Cécile se superpose aux attentats du 11 septembre 2001).
Mais quelque chose s’est enclenché malgré lui. Si les minutes et les heures qui ont suivi l’annonce « ont l’apparence d’un bouillon laiteux et opaque », il « regarde » peu à peu « l’idée désorganisée de la mort de Cécile se rassembler comme un nuage grisâtre ». Le souvenir s’organise, sa mémoire « modèle une fiction », comme si tout ce qu’il a vécu formait une « glaise » unique. Jusqu’au jour où, dans un lieu lié à la mémoire de Cécile, il croise un sosie de la disparue. La réalité alors dérape, ou se dédouble, comme s’il avait accès à un univers parallèle dans lequel Sophie ne serait pas morte. L’idée fait son chemin, elle est bien connue des romanciers : à chacun de nos choix, nous sommes devant une bifurcation dont nous n’empruntons qu’une route. Mais où va l’autre ? Où vont toutes les autres ? Et si un autre univers s’ouvrait alors à cet endroit, où le second élément du dilemme se développerait à son tour avec autant de bifurcations qu’il y a de possibilités dans la vie, jusqu’à créer des « milliards d’univers dans lesquels Cécile a survécu » ? Il commence alors à suivre l’inconnue en s’imaginant découvrir ce que Cécile aurait pu faire de sa vie si elle n’était pas morte, imaginant « mille chemins à suivre et mille embranchements ».
Une image s’impose alors à lui pour matérialiser cette idée. Il peut arriver, quand on regarde la Terre du hublot d’un avion, de voir des nuages décalquer le paysage, comme si deux mondes se superposaient soudain. L’image m’a d’autant plus frappé que je l’ai vécue en survolant un désert percé d’un point d’eau à la forme éclatée : la condensation avait formé dans le ciel un nuage d’une forme identique dont le soleil projetait l’ombre dans le sable, juste à côté de la mare. L’effet est surprenant et peut donner l’idée de plusieurs niveaux de réalité qui se superposent.
Pour le narrateur, le besoin de connaître cette autre Cécile tourne à l’obsession – jusqu’à vouloir examiner ses sacs poubelles pour pénétrer son intimité. Sa vie sociale en est bouleversée, car il refuse désormais de superposer d’autres souvenirs vécus avec ses amis sur ceux qu’il a eus avec Cécile. Sa sensibilité exacerbée donne sens à ce qu’il voit en fonction de ce qu’il vit, selon le processus que Breton nommait hasard objectif – un lien lui semble ainsi évident entre sa propre filature et le film qu’il vient de voir, Baisers volés de Truffaut.
Petit à petit, c’est sa propre vie qui se projette sur celle de Cécile, comme s’il était phagocyté par la disparue. Les fameux embranchements vers des mondes parallèles sont à l’image de notre futur : devant nous, ce sont des milliers de destins qui nous attendent, que nous portons en nous et entre lesquels la vie ne nous permet qu’un seul choix. Mais en suivant l’unique voie de Cécile, le personnage renonce à ses propres choix, comme si tout son futur, tous ce qu’il pourrait vivre, « tout cela n’existait qu’en Cécile ». Persuadé qu’il doit « écrire cette mémoire de Cécile pour la ramener au réel », il se laisse happer par cette fiction dont Cécile devient un personnage, au point de devenir lui-même personnage de sa propre vie. Comme un ver qui dévore son hôte de l’intérieur, cette « petite narration intime qui sert de squelette et de nerf à la vie » est tout entière investie par sa quête obsessionnelle. Cécile est désormais son corps. Elle l’a dépossédé de ce qu’il y avait de plus précieux en lui, la « part du lion » peut-être de l’existence : son insouciance, le sentiment d’immortalité qui nous permet de regarder le présent comme s’il était éternel.
L’idée est remarquable et s’insinue progressivement dans le lecteur, suggérant sans la lourdeur d’une analyse le travail souterrain qui s’effectue à la mort d’un proche et qui, en devenant obsessionnel, nous prive de l’avenir. Le roman, parti d’un étrange bonheur, matérialise la perte de l’insouciance comme une chute du paradis terrestre. La traduction de cette idée passe par une écriture d’une grande fluidité, dans une phrase ininterrompue de la majuscule initiale au point final. Souvent, le roman en une phrase est un exercice de style artificiel qui finit par lasser. Il est rare qu’il réponde à une nécessité structurelle, comme dans le Tête à tête de Paul Emond, ou comme ici. Car les mille histoires de Cécile sont comme « une longue phrase jamais interrompue », une phrase « d’un seul souffle où jamais Cécile ne cesserait de respirer » : celle que nous sommes en train de lire.
Le défi est difficile à relever pour un écrivain de tenir en haleine le lecteur dans une phrase de 130 pages. Philippe Marczewski y parvient grâce à une syntaxe épurée, au rythme apaisé, et quelques belles formules, des images justes et fortes qui nous maintiennent dans une vision très concrète du récit. Ainsi pour exprimer l’artifice utile des condoléances (« la conversation tenait en laisse une tristesse qui menaçait de mordre »), ou la fragilité du réconfort (une amie se tenait « immobile comme une statue brisée dont les morceaux empilés ne tenaient en équilibre que par miracle »). De très belles trouvailles qui pardonnent quelques préciosités inutiles, comme « l’aiguille de la surprise », ou ces autres aiguilles qui « viennent briser l’illusion de la ressemblance ». Question de sensibilité, sans doute. Cela n’empêche pas ce roman d’être une des belles surprises de cette année.
Retour au sommaire
Jacques Richard, Écrit sous l’eau, L’herbe qui tremble, 2024
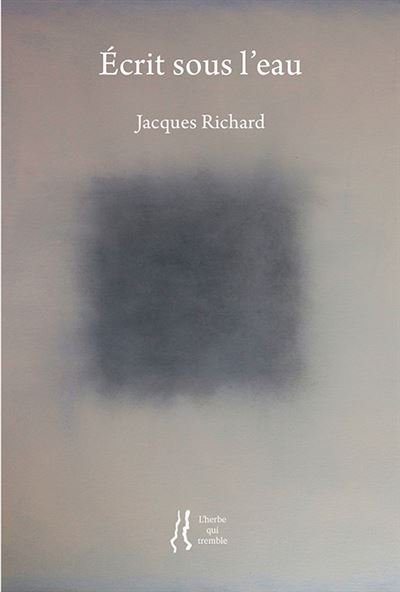
« Je te dis j’aime les mots. J’en suis fou j’en suis saoul je veux m’en barbouiller et devant et derrière et dessus et dessous et toute la figure et m’en gaver la bouche m’en goinfrer m’en gonfler les deux joues et puis les recracher à la face des gens et qu’ils soient bien contents » Les mots, matière première de l’écrivain, matière et forme amalgamées en un ensemble détonant, jouissif, et parfaitement maîtrisé par un orfèvre en la matière. Ici, un jeu subtil sur la paronymie (« tu auras confondu dessin avec destin ») ; là, sur l’ambivalence (« Je prends le tien, de temps, je le prends pour le mien ») ; ailleurs, sur une construction transitive ou intransitive (« Et je n’importe rien dis-tu. Et je n’importe pas te dis-je »)… Mais le jeu n’est jamais gratuit. Il est toujours signifiant et peut se faire grave. Le paradoxe évoque des images glaçantes (« Le père gît au plafond ») ; l’interpénétration de l’abstrait et du concret donne aux concepts une réalité tangible (« Des cruautés sans nom sommeillent dans la terre […] Là gît l’angoisse nue ») ; la juxtaposition sans ponctuation devient éructation rageuse (« on a tout bouffé bâfré rongé et vomi et remangé et redégluti et revomi »).
C’est par les mots qu’il faut entrer dans ce livre inclassable. Car s’il commence par une déclaration d’amour ébouriffée, il prend la forme d’une quête minutieuse qui n’aboutit que dans les dernières pages dans un discret hommage à Rimbaud :
« Tu l’as retrouvé… Quoi ?
Le mot.
Sous la surface. Le bon ! Le juste ! »
Trouver le mot juste « sous la surface » : nous entrons dans un autre leitmotiv de ce livre : percer l’épiderme de la réalité, aller voir au-delà, de « l’autre côté du jour », « outre le mur », « ailleurs »… Les expressions ne manquent pas pour traduire cette urgence à dépasser la surface des choses. Même, et surtout, si l’on ne sait ce qu’on peut y trouver – « Qu’y a-t-il derrière que tu veuilles à toute force passer outre le mur ? » Même, et surtout, si l’on est pris par toutes les fausses urgences de la vie – « Nous n’aurons plus le temps de partir en ailleurs voir si nous y sommes ». Comme les poissons de Platon glissant sous les eaux en voyant indistinctement le monde au-delà de la surface, nous vivons une réalité restreinte comparable à la mort – « On n’a pas idée de l’étroitesse de ces boîtes ! » dit-il en parlant du cercueil. L’ailleurs est insaisissable, sinon par une pirouette, comme l’avion qui passe : « Je l’ai pris à deux doigts, le petit misérable ». La transparence même est un leurre et la beauté un piège – « La lumière est ce mur qu’une femme trop belle oppose à tes regards ». Et peut-être faut-il passer par la destruction pour aller au-delà des apparences comme on perce un écran – « J’ai planté un clou dans le mur bleu du ciel ».
Mais peut-être aussi suffit-il de modifier son regard. Car dans un monde qui a retrouvé son unité, l’espace n’a plus de sens, la surface et la profondeur se recouvrent – « Une porte fermée en même temps qu’ouverte » – et le temps n’en a pas plus, passé et futur fusionnant dans le présent – « Demain nous passions là ». Et dans cet indistinct qui nous permet d’échapper au superficiel sans nous perdre dans l’inconnu, le mot, le précieux mot n’a plus d’existence – « Nous étions en des lieux ne portant pas de nom ». Une absence de nom qui ne trahit pas l’insignifiance, mais l’impossibilité de désigner l’essentiel, comme la mystique apophatique se refuse à nommer son dieu. Ces lieux sans nom ont au contraire une extraordinaire présence. « Là naissaient de grands arbres sur les terrasses tièdes. Des êtres sans nom. Penchés aux parapets ou bien passant la tête entre les balustres. »
Alors, en fin de compte, n’est-ce pas cela le « mot juste » que l’on cherche en vain dans les frontières trop étroites du dictionnaire : celui qui désignerait toutes les choses qui n’ont pas de nom, qui ouvrirait sur l’ailleurs comme la porte fermée au lexicographe et ouverte au poète. Un rêve ? Oui, sans doute, puisque le rêve aussi est une porte en même temps ouverte et fermée – « Je rêve comme une pierre » – car c’est par le rêve des choses qu’on accède aux lieux sans noms.
Voir aussi : Scènes d’amour et autres cruautés, Le carré des Allemands, L'homme peut-être et autres illusions. La course. Jeanne en personne.
Retour au sommaire
Grégoire Polet, Pax, Gallimard, 2024.
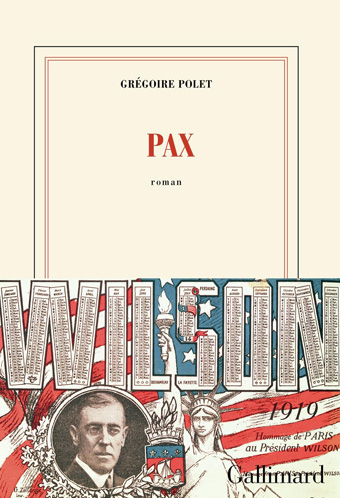
« J’écris un livre sur les clignotements de la guerre et de la paix, qui a 1919 comme porte d’entrée, le rêve d’une paix mondiale ». Un peu avant la moitié roman, l’auteur donne un fil d’Ariane pour en explorer le labyrinthe. Un livre sur, donc, « ou plutôt autour », car le roman bifurque aussitôt dans une série de « boucles de temps », qui nous emmènent du XVIIIe au XXIe siècle, avec des « passages réguliers » dans le Paris de 1919, « dans l’espoir par-ci par-là de faire apparaître des dieux le long du chemin. »
Parmi ces dieux de la Paix qui a donné son titre au roman figure en bonne place (c’est-à-dire à la croisée de bien des boucles) Friedrich Schiller, dont l’hymne à la joie, mis en musique par Beethoven, est devenu l’hymne national de l’Europe. Le romancier sait que notre continent a surtout été un « perpétuel champ de bataille ». Les boucles du temps parties de 1919 l’entraînent sur les traces de Napoléon, de Guillaume II ou de l’abracadabrant Lou Tseng-Tsiang, premier ministre chinois venu à Versailles négocier la paix en 1919, mais qui refuse de signer le traité défavorable à son pays et qui, quoique marié à une Belge, Berthe Bovy, finira ses jours comme moine à Bruges… Des personnages plus ou moins connus, la plupart célèbres, empruntés à toutes les cultures et à toutes les époques, tiennent un rôle secondaire ou déterminant, de Proust à Freud en passant par Tiepolo, Zweig ou Goya…
Mais les nœuds de ces boucles sont ceux des paix conclues et des artistes qui, en dépit des conflits, unissent les hommes. Ce sont eux qu’ils convoquent pour nouer les épissures. Outre Schiller et Beethoven, Van Eyck est le plus stimulant, avec cet Agneau mystique qui rassemble autour du symbole christique – la paix par excellence, indépendamment de toute référence religieuse – tous les hommes de bonne volonté. Le tableau, avec ses péripéties, revient comme un fanal dans le brouillard des digressions pour voir son cortège s’enrichir au fur et à mesure de tous les personnages croisés dans le roman. Sans doute trouvera-t-on dans cette épopée de l’Agneau mystique les pages les plus lumineuses du roman, les plus folles, les plus drôles, les plus poétiques. Un exemple entre cent ? Au moment d’y être convié, Henry Van de Velde s’informe : « Il y a une rivière dans le terrain de golf de Van Eyck ? Si oui, placez Maria et Théo à côté [les époux Van Rysselberghe], avec un filet ou une ligne, parce qu’ils vont pêcher un beau poisson pour votre livre. André Gide. Himself ! Oui – André Gide ? Pourquoi pas. Ça m’intéresse. Je crois que ça intéressera Proust aussi. Allez-y, Henry, racontez-nous. »
Car ces « boucles de temps » ne sont pas des anecdotes empilées au hasard des déambulations : elles dessinent une tapisserie dont chaque motif est en étroite relation avec le suivant. C’est Stefan Zweig qui donne au romancier baladeur l’adresse de Freud, qu’il veut interroger sur Wilson parce qu’il a pris le même bateau que le président américain – mais dix ans plus tôt – et qu’il lui consacrera un livre – dix ans plus tard… Délirant ? Non pas, ou pas toujours, mais un « tressage de vies » qui obéit à sa logique, au rythme des « cartouches de temps » dont on réapprovisionne son stylo. D’abord, l’auteur se sent comme un voyageur extérieur, voir invisible, ombre sur un mur, spectre, fumée, qui évoque le Diable boiteux de Lesage découvrant la vie de ses personnages en soulevant le toit des maisons – lui préfère l’image du passe-muraille. Mais bientôt, il ressent la troublante tentation de « s’incarner », ne fût-ce que pour partager une coupe de champagne avec les congressistes ! Petit à petit, il y succombe, il dialogue avec ses personnages. Ceux-ci, tout d’abord, sentent simplement une présence – Guillaume II fait ainsi un geste agacé pour chasser une mouche – « Enfin, c’était moi », commente l’auteur / narrateur. Puis il s’enhardit. Il prend un café avec Tiepolo ou un whisky avec da Ponte, qui le voient bel et bien. À certains moments, il pose en auteur omniscient et omnipotent – il envoie ainsi un cauchemar à Guillaume II – mais à d’autres moments, il est bien impuissant à faire avancer son histoire – il doit demander à Zweig l’adresse de Freud pour passer le voir. Tantôt il se glisse dans les habitudes de l’époque (l’adresse de Freud est copiée sur un bristol), tantôt il conserve les siennes, et cherche une adresse sur Google map…
Pour s’y retrouver, le lecteur pointera les motifs récurrents, comme l’incroyable collection de crânes et de têtes coupées, qui semblent anecdotiques, mais qui structurent le récit (les portes vitrées de la Bibliothèque Royale sont comme un « couperet latéral ») et débouchent sur une grandiose visite du crâne de Goya décrit comme une caverne couverte de fresques pariétales !
Un détour durant la deuxième guerre mondiale nous met en mémoire les déportés juifs, que rappellent, à leur dernier domicile, un pavé doré commémoratif. On perçoit là une des étincelles à l’origine du roman : l’auteur croise, à Bruxelles, un inconnu qui astique consciencieusement ces pavés du souvenir. N’est-ce pas aussi le rôle de l’écrivain d’être un « astiqueur de mémoire » ? N’est-ce pas la mémoire de la Paix qu’il convient de faire reluire sur les pavés de la guerre ? L’inconnu croisé à Bruxelles est une belle métaphore du roman.
Le thème du voyage donne en fin de compte une paradoxale unité au roman. Voyage bien réel de l’auteur avec ses enfants sur la côte Belge, voyage dans le temps de la narration, traversée de l’Atlantique par Wilson ou Freud, voyage immobile de Tiepolo peignant le monde couché sur ses échafaudages, voyage à travers les livres dans une bibliothèque, voyage dans la mort, car « mon livre est évidemment ça »… Ce roman est (aussi) une réflexion sur l’homme et sur la vie. Sur l’océan où il accompagne ses personnages, il se demande si c’est le temps qui passe ou l’être humain, semblable au navire, qui passe sur le temps « présent dans son entier ». « Cette certitude que nous avons que le temps passe, qu’il y a donc du passé et, je suppose du futur, de l’avenir, n’est qu’une illusion semblable à celle qui nous fait dire que le soleil se lève ou qu’il se couche, alors que c’est nous, la Terre, bien sûr, qui tournons. C’est nous qui passons, pas le temps. » Et si le voyage était en fin de compte immobile ? « La physique quantique cherche à nous habituer à cette réalité […] Nous visons toutes les époques ensemble. Tant de personnes ont déjà vécu notre vie. » Le roman aussi… Ne nous étonnons donc pas si le livre finit par sa propre histoire : c’est que nous en sommes devenus les héros.
Retour au sommaire
Corinne Hoex, Les reines du bal, Grasset, 2024.
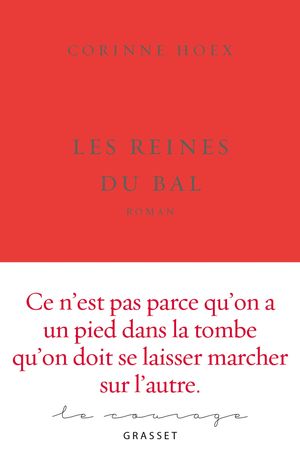
« Ce n’est pas parce qu’on a un pied dans la tombe qu’on doit se laisser marcher sur l’autre », disait François Mauriac. Rarement une épigraphe aura été aussi appropriée… Les protagonistes de ce roman (ou plutôt, d’une succession de courts récits dont les personnages présentent les mêmes noms et traits de caractère) sont de vieilles dames placées en maison de retraite et qui n’ont pas l’intention de s’en laisser conter. Certaines se contentent de faire de la résistance passive, d’autres ont des relents de cruauté parfois désopilants, celles-ci ont perdu la tête, ou apparemment, celles-là l’ont conservée, ou apparemment. Mais pas de Tatie Danielle dans le lot. Pas de méchanceté gratuite. Beaucoup ont encore des désirs très crus, rêvent (ou non) d’hommes nus dans leur lit. Des situations parfois dramatiques, mais toujours cocasses.
Les pensionnaires des Pâquerettes n’aiment pas qu’on se moque d’elles. Pourquoi leur dit-on qu’elles radotent quand elles répètent vingt fois la même phrase, et pas à Johnny Halliday dont les chansons tournent à la ritournelle ? Pourquoi leur pose-t-on un chat sur les cuisses pour soigner leurs genoux ? Elles ont leur logique et s’y cramponnent.
Alors oublions le politiquement correct. Comme dans Arsenic et vieilles dentelles, ici, ça tue (à la sauce trop grasse), ça mutile (au dentier), ça saisit sauvagement les docteurs à l’entrejambe (« Mais ce ne sont pas mes mains »), ça s’échange des rosseries au vitriol… Parfois, aussi, ça dérape dans leur tête, on ne sait plus très bien à quoi s’en tenir, elles sont touchantes, finalement, ces petites vieilles avec leurs lubies et leurs angoisses. Celle-ci ne sait que faire de ses souvenirs et de ses vieilleries, mais ne résiste pas à la tentation de reproduire ce qu’elle a perdu ; celle-là sent en elle un squelette « qui dépasse de partout » (« il a mis son crâne là, juste en dessous de ma peau »). Et le monde moderne, avec ses lubies (comment se débarrasser d’une fourrure en bébé phoque, personne n’en veut !), ses gadgets sophistiqués (comment prendre les empreintes à des doigts usés ?), son inculture (perd-on la mémoire parce qu’on cite du Tartuffe ?), ses entourloupes (on interdit la laque pour préserver la planète et pour multiplier les mises en plis), n’est décidément pas fait pour elles. Alors elles se vengent.
L’humour est particulièrement efficace lorsqu’il fait appel à la sagacité du lecteur pour lire entre les lignes. À entendre madame Prunier égrener des prénoms masculins (Raymond est mort, Victor aussi, Florent placé chez les fous, Gustave paralysé…), on devine une vie sexuelle bien remplie. Si madame Spinette boit de la grenadine, cela sent le sang, et son dentier vaut bien ses dents… Quant au pépiement qui ne vient pas du canari, il faut avoir assisté à l’agonie d’un détecteur de fumée pour comprendre ce qui s’est passé. Et quand on reconnaît qu’on doit faire erreur, c’est qu’il y a anguille sous roche… Ces trente courtes anecdotes finissent par former un portrait corrosif, mais sensible, parfois poétique, parfois féroce, souvent cocasse, de vieilles dames qui n’ont pas renoncé à la vie. On y retrouve avec délectation l’humour pétillant et incisif de Corinne Hoex.
Voir aussi : Décidément je t’assassine. Et surtout j'étais blonde, Nos princes charmants. Le ravissement des femmes.
Retour au sommaire
Nathalie Skowronek, La voix des Saules, Grasset, 2024.
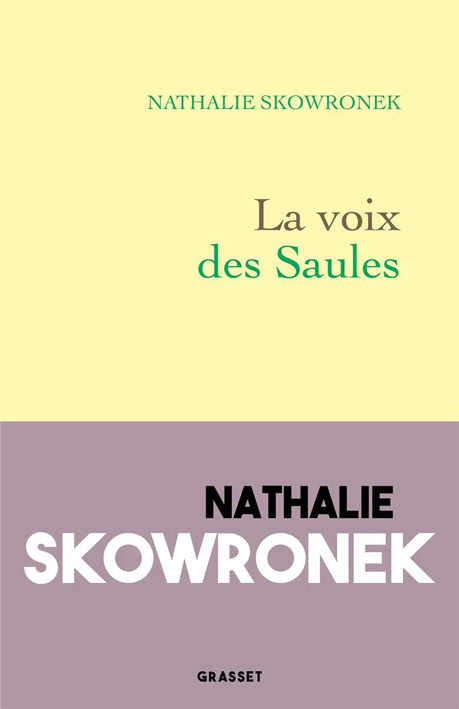
Les Saules, « centre de jour pour adultes en difficulté psychiatrique », sollicite la narratrice — qui ne dissimule pas la forte composante autobiographique de ce récit — pour animer un atelier d’écriture. Celle-ci se prépare soigneusement, lit, consulte des sites, peaufine son approche, prépare des exercices, des lectures… Lorsqu’elle se présente devant une classe de volontaires, dans un hôpital de jour, elle pose la question qui tue : « Alors, comment allez-vous ? » Plus étonnée de la réaction de l’assistance que de sa bévue, lorsqu’elle s’en rend compte. Loin de lui reprocher cette entrée en matière peu diplomatique, on cherche à la mettre à l’aise. Mais la prise de conscience est décisive. « Le déroulé de ce que j’ai préparé se trouve instantanément chamboulé. »
Commence un patient apprentissage de l’autre. Il faut apprendre à se connaître, à travailler ensemble, dans un apprivoisement réciproque. La romancière avance « par ricochet », « à sauts et à gambades », dirait Montaigne, car elle ne manque pas de références littéraires pour analyser ce qui lui arrive — analyser, ou s’en protéger ? La confiance s’installe, chacun se confie, personne ne juge. Et la narratrice peu à peu découvre sa propre fragilité dans un monde qui apprend à vivre avec la sienne. Le premier intérêt de ce récit réside dans le travail intérieur que le groupe lui apprend à effectuer sur elle-même. À vrai dire, les principaux éléments sont en place dès le départ, avant même l’arrivée dans l’atelier. Nathalie est alors à un « point de fragilité », elle vient de terminer un livre, attend avec une pointe d’angoisse la publication. Elle sait qu’elle a déjà traversé une période dépressive. Plus profondément, elle garde une hantise de ne pas être à la hauteur, de déplaire, de décevoir. Le rôle « d’écrivain de la famille » n’a pas été écrit pour elle. « Peur de l’ailleurs, peur de paraître autre que l’image parfaite que je m’efforçais de donner ».
Alors elle se réfugie derrière des « postures », des masques sociaux, des références littéraires, des livres-fétiches… À chaque question un peu indiscrète, elle invoque une citation qui lui évite de répondre. Symboliquement, elle ne se déplace pas sans un objet symbolique, un masque mortuaire en plâtre, dont l’empreinte a été prise à la morgue sur l’Inconnue de la Seine — une jeune noyée dont elle a découvert l’existence grâce à Aragon, le filtre littéraire s’ajoute ici au filtre métaphorique. « Comme elle ce que je donne à voir n’est qu’un masque », réalise celle qui a bien conscience d’« écrire depuis le masque », de s’entourer de livres et de références pour dissimuler ses propres fêlures. Mais « Tricher aux Saules, ça ne marche pas ». Face à ces hommes et ces femmes brisés qui ont appris à se reconstruire en assumant leur fragilité, impossible de se défiler. À quoi bon, d’ailleurs ? « Ici on ne juge pas ». Le groupe fonctionne avec sa sensibilité propre, écoute attentivement les textes des stagiaires malgré leurs maladresses, soucieux d’« aller rechercher les égarés » lorsqu’il repère un point de rupture. « En ne faisant pas semblant, ils me libèrent de la mise en scène réglée de mon ancienne vie où je m’étais imposée de vouloir être parfaite. »
La romancière baisse peu à peu le masque. Face aux stagiaires des Saules, c’est l’image de sa propre fragilité qui lui est renvoyée : « face à eux, je n’ai plus envie de mentir, plus envie de me cacher derrière le simulacre du tout-va-bien-rien-à-signaler. » L’atelier d’écriture l’oblige à s’interroger sur sa propre démarche. « Alors j’ai déconstruit les livres que j’avais écrits, j’ai refait le chemin en sens inverse. » Une autre relation se construit, un nouvel équilibre, qui passe par un travail sur sa propre écriture qui se cherche une sincérité épurée des artifices littéraires. Mais le trajet n’est pas sans soubresauts. Une rencontre imprévue, celle d’une amie de fac perdue de vue depuis longtemps, vient brusquement remettre en cause ce patient travail sur elle-même. Face à l’ancienne amie, Nathalie se rend compte qu’elle revêt à nouveau son masque. L’image qu’elle reçoit de la condisciple retrouvée ne correspond pas à celle qu’elle se fait d’elle-même.
Et la mécanique à nouveau se grippe. Non une crise violente, mais une prise de conscience, une lucidité qui empêche soudain de vivre sans avoir à y penser, comme on respire ou on digère. Elle fait bon visage, mais le groupe est attentif à la moindre fêlure — « Tu plaides la cause de qui, là ? » — l’obligeant à s’avouer qu’elle devient le « guérisseur blessé » de Jung — « Travaillerais-je à ma propre thérapie ? » Ce sont les stagiaires qui lui conseillent en fin de compte d’aller voir un médecin — pas la peine de leur expliquer ce qu’est l’angoisse.
Alors, tout ce qu’elle leur a appris commence à agir sur elle et malgré elle. En particulier le travail sur la métaphore, qui a permis de très belles découvertes dans l’écriture des stagiaires — l’oisœuf de Pierrot, la femme-arbre de Lina, le pont qui sert de baromètre à Suzanne… Et c’est la métaphore du masque qui resurgit soudain dans une scène hallucinée, sans doute une des plus belles pages de ce récit : tous les membres de l’atelier semblent revêtus de masques de divinités africaines, ces masques qui révèlent la personnalité cachée, quand les masques occidentaux font au contraire tout pour la masquer. Ce leitmotiv que l’on suit depuis le début du roman prend ici toute sa signification, sa force destructrice et salvatrice à la fois. C’est finalement un masque qui prend la parole, une voix venue d’on ne sait où, « enfin je n’en suis pas sûre, tout se mêle, enfin si, elle s’approprie la phrase d’un livre commencé la veille, elle est gutturale, une voix d’outre-tombe, une voix menaçante, au moins elle, elle ne cache pas son jeu, elle me met en garde. » Impossible de ne pas faire le rapprochement avec la formule initiale, « écrire depuis le masque ». La voix ne vient plus de l'écriture, mais du masque, d’un autre masque. L’écriture lui échappe, adopte un autre rythme, elle accepte de lâcher prise. Au-delà d’une expérience que bien des écrivains se lançant dans la pratique des ateliers d’écriture peuvent partager, c’est cette exigence de lucidité et de dépouillement qui donne sa force à ce récit.
Voir aussi : La carte des regrets.
Retour au sommaire
Xavier Hanotte, Le feu des lucioles, Belfond, 2024.

Remember me when I am dead
and simplify me when I am dead.
« Souvenez-vous de moi quand je serai mort
Et simplifiez-moi quand je serai mort. »
Ces deux vers du capitaine Keith Douglas, mort à vingt-quatre ans dans le débarquement de Normandie, en 1944, obsèdent Frédéric Dutrieux, le narrateur, jeune diplômé en philologie germanique qui vient de rater la bourse qui devait couronner un mémoire consacré à ce poète, pour avoir conclu un travail universitaire sur un épilogue fictif. Par une de ces coïncidences que se permet la vie quand elle veut concurrencer le romancier, son grand-oncle a disparu à la même époque, au même âge et au même endroit que le poète anglais. Il faisait partie de la brigade Piron, composée de soldats Belges qui ont refusé la défaite et qui se sont réfugiés en Grande-Bretagne avant de débarquer avec les troupes alliées. Il ne reste de lui que quelques photos, une médaille « posthume » (mot étrange pour un disparu jamais inhumé) et un cahier contenant des notes entrecoupées de poèmes, et cette curieuse mention dont on ne sait s’il s’agit d’une pensée ou des premiers vers d’un poème interrompu : « Si un jour tu peux lire ce qui figure ici, sache qu’à jamais / Quelque chose au-delà de nos vies et du temps nous a réunis. »
Fasciné par ce grand-oncle héroïque, dont il porte le nom et le prénom, le narrateur part confiant pour le service militaire, espérant y conquérir le même grade de sergent. Un lieutenant qui l’a pris en grippe brise son rêve en lui confiant les tâches les plus dégradantes, dans lesquelles il risque de laisser sa vie. C’est à ce moment que la réalité dérape, que les époques se superposent. « J’avais dû me tromper de porte, pénétrer en un lieu où je n’avais rien à faire », se dit le narrateur, incapable de « rectifier cette erreur » et de « réintégrer l’espace d’entre-deux dont un malheureux hasard m’avait arraché ». Rêve-t-il, dans son coma artificiel, qu’il est en 1944, ou le glissement temporel a-t-il réellement eu lieu, à moins que ce ne soit le fantôme du sergent Dutrieux, disparu au front, qui se soit introduit en lui pour le mener sur ses traces ? Le lecteur choisira son explication, mais il devra repérer les plus petits détails qui le guident dans ce labyrinthe temporel. Des cicatrices (récentes, anciennes ?), des photos retrouvées (mais où ?), des réflexes inexplicables (armer son fusil de la mauvaise main), des souvenirs de voyages (futurs) qui prennent vie et sens, une phrase manquante sur un carnet, une jeune femme tout droit issue d’une photo égarée… Tous ces éléments tournent dans le kaléidoscope comme des lucioles dans le ciel nocturne et finissent par former un paysage sans doute différent pour chaque lecteur.
En fait, les deux périodes se recouvrent sans qu’il faille chercher une explication rationnelle ou fantastique, dans « un temps doublement enfui » : ce qu’il est convenu d’appeler un « réalisme magique », mais qui prend chez Xavier Hanotte un ton tout à fait singulier. Certes, nous sommes dans un environnement réaliste, dont chaque élément a été minutieusement vérifié — je gage qu’un instructeur militaire ne trouverait rien à redire au maniement des armes — et où la réalité la plus triviale vient briser les rêves les plus éthérés. Certes, des éléments irrationnels viennent briser la logique de ce cadre. Mais le décalage tient moins à une distorsion de la réalité qu’à l’imperceptible distance que le narrateur entretient en permanence avec ce qui l’entoure, avec ce qu’il vit. Un mélange de dérision, de réserve, de fatalisme, de distraction. Il ne s’étonne pas que le souvenir de voyages effectués trente ans plus tard lui permette de se retrouver dans la Normandie de 1944. Il accepte avec flegme les humiliations, les blessures, les infections, comme si elles ne le concernaient pas. Il glisse, entre le réel et la conscience qu’il en prend, le mince filtre d’une allusion littéraire ou cinématographique. Il s’interroge sur sa mort comme s’il s’agissait d’une équation à résoudre. « En réalité, n’étais-je pas déjà mort, moi aussi ? […] Peut-être errais-je au sein d’un cortège d’ombres à la fois étrangères et familières, entrevues à la faveur de ce rêve qu’avait tant craint Hamlet, et tout cela par le jeu pervers d’une mémoire obstinée, dans le passé revisité d’un autre que moi ? » Cette retenue, mélange d’humour et de pudeur, fait tout le charme et la distinction des romans de Xavier Hanotte.
Ne nous interrogeons donc pas sur « cette émouvante absurdité, ce court-circuit, ce dérapage temporel, ce saut dans le passé, ou quel que pût être son nom… » et interrogeons-nous plutôt sur ce qu’il veut nous dire, car « Tout cela revêtait au moins un sens possible ». Une happy end est proposée avec la même désinvolture que Molière concluant les situations les plus inextricables par l’intervention d’un deus ex machina. Ce n’est pas l’essentiel. L’important, c’est la façon dont chaque lecteur va résoudre cette distance entre le monde et lui, entre la mémoire et l’imagination, la trivialité la plus sordide et la poésie la plus pure, entre la vie et la mort. Xavier Hanotte la résout quant à lui avec l’élégance de l’humour, un humour pince-sans-rire bien dans le ton d’un gentleman fourvoyé dans un char de combat. Un char surnommé Firefly, « luciole », peut-être à cause de l’embrasement des gaz excédentaires à l’intérieur de la tourelle. Quelle idée, « les calmes lucioles n’avaient pas le même sens de la farce » ! Le lecteur sera peut-être déconcerté de ne trouver les lucioles qui donnent son titre au roman que là où elles ne sont pas : dans un char de combat, au sein d’un poème de Keith Douglas qui pourtant parle bien de phalènes, dans « un essaim vrombissant de minuscules insectes brillants » qui, nous précise-t-on, ne sont justement pas des lucioles. Les lucioles n’apparaissent ici qu’en creux. Comme la phrase manquante dans le carnet du grand-oncle, qui brille par son absence. Et mis à part un bref ballet phosphorescent qui conclut le plus dégradant, le plus abject des épisodes du service militaire. Quelques lucioles « insoucieuses du monde et de ses turpitudes » dont les étoiles (symboles de prédestination ?) envient la liberté. Quelques pas de danse pour échapper à notre destin : n’est-ce pas la meilleure façon de sauver grâce à l’art le monde du désastre, de conjurer la guerre par la poésie ? N’est-ce pas, en fin de compte, le sens perdu que cherche le seul survivant à ce terrifiant massacre ?
N’oublions pas, entre réalisme et fantastique, entre poésie et trivialité, l’indispensable secours de l’humour qui permet de relativiser les situations les plus difficiles — « c’est qu’il y aurait de quoi sauter par la fenêtre du rez-de-chaussée ! ». Ici, un jeune homme avec un walkman vissé sur les oreilles « travaillait consciencieusement à sa future surdité sur le premier et dernier tube en date de Frankie Goes to Hollywood » ; là, les mines contrites du roi et de la reine sur leur portrait officiel « donnent envie de leur prescrire un tube d’aspirine ». L’humour est parfois la politesse de la souffrance. Et si le roman finit sur un « élégant uniforme de sortie », c’est peut-être parce que le narrateur s’en sort toujours avec une extrême élégance.
Retour au sommaire
Voir aussi : L'architecte du désastre. Un parfum de braise.
Xavier Hanotte, Un parfum de braise, Weyrich, 2024.

« L’Art l’emporte toujours sur la force brute. Il éclaire la vie de l’un, aiguise la douleur de l’autre, chacun selon son dû. » Cette profession de foi peut sembler quelque peu candide aujourd’hui où parlent plutôt les drones et les canons. Mais chez un peintre de talent, faussaire de génie, en particulier d’Évariste van Meulebroeck (qui ne vécut pas de 1578 à 1647, comme indiqué, puisqu’il s’agit d’une invention du romancier), les convictions sont bien ancrées, et il se donne les moyens de les réaliser. En l’occurrence, il s’agit ici de « grand art », celui auquel on « s’adonne avec respect ». Pour le lecteur distrait, il ne s’agit que d’une expression courante (« C’est du grand art ! ») qu’il ne faut pas prendre au pied de la lettre. L’usage de l’italique nous rappelle cependant qu’elle désigne d’abord l’alchimie, ce que nous rappelle un « antique chauffe-eau » qui sera, au détour d’une page, qualifié d’athanor. C’est tout ? C’est tout. Avouons qu’il faut un peu d’attention pour repérer les indices et comprendre ce qui se joue dans un roman qui se maintient volontairement dans un réalisme désinvolte, plus occupé en apparence d’escarpins oubliés chez un amant, d’escaliers vétustes ou de dysfonctionnement d’une porte d’entrée…
Il faut surtout se rappeler que Xavier Hanotte ne se contente pas, de livre en livre, de jouer avec les conventions du roman classique, mais pousse aussi jusqu’à ses limites le réalisme magique qui aime mêler à un récit du quotidien, dans un décor des plus banals, des éléments incongrus, irrationnels, qui font appel à la pensée magique. Il aime également détourner les genres traditionnels, en particulier le roman policier, dans lequel il a fait ses preuves, par des ruptures de ton ou de convention. Ainsi, la traditionnelle course poursuite est remplacée par un embouteillage sur le Ring bruxellois ! Sans doute les amateurs de polars noirs trouveront-ils le rythme pantouflard et l’enquêteur désinvolte. Mais si l’art l’emporte toujours sur la force brute, l’écriture prime sur l’action dans un roman malicieux et parfaitement maîtrisé. Il ne faut pas se préoccuper du pourquoi (le grand art et l’athanor nous suffiront), ni même du quoi (le distrait risque fort de ne pas comprendre ce qui s’est passé), mais du comment, de l’entrelacement des récits, de la psychologie des personnages, de l’humour pince-sans-rire, de l’écriture malicieuse…
D’emblée, l’exposition « à l’américaine », en plein cœur de l’action, avec un cadavre dans les premières pages, fait place à une ouverture « en mode mineur » sur une journée « avare de promesses ». L’action se réduit à la lente avancée de la lumière à travers une persienne qui ferme mal. Les péripéties qui la font progresser, à la découverte d’une paire d’escarpins « à talons presque hauts ». L’amateur de polar est au bord de la crise de nerfs ; le lecteur patient est aux anges. L’acmé s’annonce dans un commissariat installé à l’étage d’une librairie post-soixante-huitarde, accessible par un escalier de service ou un ascenseur pour handicapés. L’amateur de polar frôle l’apoplexie ; le lecteur patient, la béatitude. Quand débarque un authentique repris de justice, qui a failli abattre notre narrateur-inspecteur et qui s’est répandu en menaces de mort après son arrestation. La tension est à son comble. Ce caïd de Palerme-sur-Meuse (entendez : Liège) se contente de déposer son arme sur le bureau du policier (« Cadeau ! »), pour qu’elle ne serve pas contre un codétenu qu’il a tyrannisé lors de son incarcération et qui a promis de se venger (« ça va chauffer ! »). Or cette vengeance est particulièrement atroce : il a envoyé sur son bourreau une sorte d’eczéma qui déroute tout le corps médical. Du sang, enfin ! Ou plutôt, un « quadrillé d’éruptions rougeâtres et de cloques translucides ». L’amateur de polar est dans les roses ; le lecteur patient, au nirvâna.
Alors viennent les vraies friandises. Un humour discret, auto-ravageur, habile à épingler le côté terne de l’anti-héros (« un sens de la répartie à faire pâlir d’envie un cacatoès », « ma personne éternellement encline à jalouser les papiers peints ») ou, à l’inverse, la personnalité de ses vis-à-vis (« ses lèvres écarlates semblaient une citation de Salvador Dali, à ce détail près qu’on ne pouvait s’asseoir dessus » : pour apprécier la comparaison, il faut quand même avoir en tête le canapé boca de l’artiste catalan…). Un art raffiné de la formule percutante, un goût presque provocateur du mot juste, une attention méticuleuse aux nuances psychologiques des personnages, se dégustent comme des bonbons : « Elle connaissait mes goûts, mais n’en jouait jamais qu’avec la parcimonie jugée propice à leur entretien. » Des citations de Wilfred Owen ou de Keith Douglas, poètes traduits par Xavier Hanotte (et non, comme indiqué, par le narrateur) et une photo du père de l’auteur à son chevalet (eh non, ce n’est pas le père de l’inspecteur qui était peintre) tendent des fils de trame entre l’intrigue du roman et une discrète autofiction. Des situations que chacun de nous a pu connaître (le débarras de la maison paternelle, la rencontre entre une ex et l’élue du moment…) font appel à la complicité du lecteur. Bref, un vrai régal pour le lecteur qui ne cherche pas le divertissement d’une intrigue policière ou d’un réalisme petit-bourgeois. « Au cours de ma carrière, il m’était certes arrivé de frôler les marges d’une certaine logique », résume le narrateur. Oui, nous avons souvent l’impression de frôler avec délectation les marges du récit. Inutile de le résumer davantage : le lecteur cultivé aura assez vite compris la nature de la vengeance, laissons-lui le plaisir d’en découvrir les détails.
Retour au sommaire
Voir aussi : L'architecte du désastre. Le feu des lucioles.
Véronique Bergen, Clandestine, Lamiroy, 2024.

« Il est risible et vain de lire le gouffre contemporain à partir des trous noirs de la Deuxième Guerre mondiale. » Violette, la narratrice, en a bien conscience, mais comment faire lorsqu’on se sent « happée par le passé qui enflamme [son] présent » ? Deux voix alternent dans ce roman, dans une même douleur, dans une même fureur. Celle de Violette, qui produit son corps nu et encordé dans des spectacles de bondage à la violence maîtrisée ; celle de Nurith, son arrière-grand-mère, dont le journal émerge à la mort de la grand-mère, racontant le ghetto de Varsovie, les humiliations et l’insurrection. Entre les deux destins si différents, des liens se tissent, discrets mais nombreux. Nurith aussi se produisait dans des spectacles, mais elle chantait. Les deux femmes ont vécu un amour passionné, interdit pour des raisons différentes, déchiré, et le tardif retour de l’être aimé. Au journal de Nurith répondent des mails adressés à Violette, introduisant des deux côtés la distanciation de l’écriture lorsque la vie saccagée ne peut plus s’appréhender de face.
Le roman commence par une séance de photographie qui semble anecdotique, mais qui contient en germe les éléments principaux de l’histoire. Inès, comme une « traqueuse de sensations », cherche « la scène capitale » qui surgit chez son modèle, Violette, quand on ne l’attend plus. Elle débusque les visages de l’ombre, les clandestins, les personnages qui foisonnent en chacun de nous et qui constituent les facettes contradictoires de ce qu’on croit notre personnalité. Tout le roman sera en quête de cette scène capitale, dans un lent et douloureux cheminement.
Des objets symboliques marquent d’emblée le terrain qui sera arpenté tout au long du récit. Violette est photographiée avec une voilette et des mitaines de mariée, mais sans la robe. Cette incongruité lui évoque soudain sa mère, qui a piétiné la robe de son mariage dans une crise de désespoir – mais rien de plus ne sera dit. Les poses lui rappellent aussi une autre séance de photos, dix ans plus tôt. Mais la photographe, qu’elle nomme Ishtar, faisait l’objet d’une passion absolue et destructrice. Comme si la fiction appelait la réalité, voilà justement Ishtar qui resurgit dans sa vie et la passion aussitôt embrase les deux femmes. Coïncidence ? Violette vient justement de se plonger dans le journal de sa bisaïeule, qui a retrouvé bien des années après l’insurrection du ghetto son amant interdit, Yéhudi. Le parallélisme entre les deux destins est reconnu et assumé auprès de Nurith : « Excuse-moi de te mêler à Ishtar, d’associer le retour de deux fantômes qui n’ont rien en commun ». Mais Nurith ne l’a-t-elle pas « choisie pour retisser les fils d’une histoire qui fuit de toutes parts » ?
Dès qu’on « soulève le couvercle du passé », bien des monstres enfouis s’échappent, appelés par des parallélismes de situation. À l’aube possible d’une troisième guerre mondiale, le souvenir de la deuxième s’impose. La grand-mère juive et la petite-fille lesbienne adepte partagent une même marginalité. Condamnées à l’ombre dès leur naissance, les deux femmes sont des clandestines. Mais il ne s’agit pas de s’enfermer dans des parallélismes superficiels : d’une manière générale, ces clandestins, qui ont donné son titre au roman, appartiennent à une confrérie, « celle des êtres marqués par un interdit de séjour édicté, en toute conscience ou en toute inconscience, par les lois des familles, mais aussi par nous-mêmes. » Ils ont traversé le monde et restent en décalage avec ce qu’ils vivent, comme Yehudi, qui refuse désormais de se produire sur scène. « Son être est devenu clandestin. Il a rompu le lien avec la comédie du monde. »
D’ailleurs, les deux récits qui s’entremêlent ont aussi leur indépendance, leurs différences. La passion délétère qui unit Ishtar et Violette est au centre du roman. Si, dans le couple sadomasochiste, Violette tient le rôle de la soumise, elle est beaucoup plus forte qu’Ishtar, incapable d’affronter « les nappes noires de son histoire privée ». Son retour auprès de Violette la fait à nouveau vaciller, mais elle ne se sent pas prête, comme Violette, à regarder son passé en face – « tu réveilles mes pulsions, mes douleurs, les démons de ma jeunesse ». Elle semble en cela à l’opposé de Yehudi, l’amant retrouvé de l’arrière-grand-mère, dont la « prodigieuse énergie vitale, l’optimisme, le sens du combat forcent l’admiration ». Si le roman est centré sur le personnage de la narratrice, c’est peut-être l’évolution d’Ishtar qui en constitue le sujet souterrain. Il faudra pour cela attendre la dernière page, lorsque le passé et le futur seront également interdits et qu’il ne restera plus qu’à vivre intensément le présent.
Le roman n’est donc pas celui de deux femmes qui se retrouvent, ni de deux époques qui se confrontent, mais celui de l’être humain et de sa place dans le monde. Que l’on se trouve ou non marginalisé, par son origine ou par son mode de vie, nous abritons tous en nous des clandestins qu’il nous faut assumer. Ils naissent du regard de l’autre, mais aussi de notre propre regard, s’imposent comme des masques sociaux dont on se défait ou que l’on reprend au hasard des rencontres. Les débusquer en soi pose la question même de l’identité, sinon de l’existence. Et comment mieux le comprendre que par le biais du photographe, métaphore parfaite de ce regard qui nous altère et nous fait vivre – « tragédie assurée de n’exister que par le regard de l’artiste qui vous sacre égérie ». Mais l’artiste n’existe lui-même que par le modèle, par la « muse » qui l’inspire et le sacre artiste. Ce processus de création réciproque est à la base des rapports sociaux élémentaires, mais s’affirme pleinement dans une séance de photographie.
Une quête de soi, donc, qui passe d’abord par une quête des origines. La recherche du père, amant de passage de sa mère. La découverte de la famille juive maternelle, dont sa mère ne voulait plus entendre parler et qu’elle déclarait « ré-vo-lue ». Et les flashes de petite enfance qui ressurgissent au cours de la quête. Violette « remonte vers les images fichées dans les niches troglodytes de [sa] mémoire », les peurs de ses trois ans, les humiliations de ses sept ans… Jusqu’à débusquer l’inaudible, l’Ogre, le prédateur de son enfance. Pour ne trouver, en fin de compte, que le « néant qui [lui] tient lieu d’origine ». Le retour d’Ishtar, dont elle mettra 275 pages à assumer le véritable prénom, est l’élément déclencheur de ce travail, comme si le choc des deux douleurs avait fait jaillir une flamme de libération. Ces retrouvailles repeuplent Violette des multiples personnages correspondant aux noms que son amante lui avait donnés. Ils retrouvent vie, lettre à lettre, recouvrant les multiples facettes de sa personnalité. De même que Nurith porte en elle tous les morts du ghetto, qu’elle égrène comme un chapelet mémoriel, Violette est légion. Dans un chapitre halluciné, d’une terrifiante splendeur, la « tribu » prend vie et se met en route vers le royaume secret d’Ishtar.
Nous sommes là au cœur du projet romanesque. Pourtant, au-delà de la persécution, Nurith et Violette ont conscience d’un destin plus vaste. La juive enfermée dans un ghetto en révolution en prend conscience la première. « Ne voyez-vous pas que notre peuple traverse autre chose que les pogroms, les persécutions séculaires et la guerre ? » Quelque chose d’essentiel tente de se détacher du récit. Devant l’apocalypse, on pense à la Délivrance, « une ère messianique qui nous apportera le salut ». Et cela est plus fort que la mort, puisque l’on sait que toute résistance est vaine, mais nécessaire. « Nous ne voulons pas sauver notre vie. Personne ne sortira vivant d’ici. Nous voulons sauver la dignité humaine. » Voilà pourquoi il est capital de réveiller en soi la petite tribu des morts et des masques sociaux. Chaque homme est l’ensemble de l’humanité. « Les bombardiers ont beau nous pilonner, notre Temple intérieur est éternel. Personne ne pourra tuer notre Humanité, éteindre la flamme qui fait de nous des Grands Vivants connectés à l’infiniment petit et à l’infiniment grand, au brin d’herbe et aux anges du firmament. » En cela, aussi terrible que cela apparaisse au lecteur, l’horreur du ghetto et de l’anéantissement devient une forme de libération. L’atrocité absolue dénude l’individu jusqu’à son essence même, celle de l’humanité.
Voilà ce que comprend Violette à la lecture du journal de sa bisaïeule. Et voilà ce qu’elle vit, à sa manière, transposant dans son vécu les leçons de l’Histoire. Les suspensions savantes de son corps nu et encordé évoquent par la douleur l’avancée de la barbarie, mais ont presque un aspect libérateur : dans les « ondulations de l’apesanteur », les cordes qui entravent la chair libèrent l’esprit, ouvrent « une porte vers le monde intérieur ». La violence, esthétisée, entre dans un autre ordre. « Je me coupe du monde, me replie sur mes sensations fœtales, animales. »
Et l’on atteint ainsi l’ultime parallélisme, celui que tout le monde se cache et qui émerge peu à peu du récit. Voici quatre-vingts ans, les juifs enfermés dans le ghetto de Varsovie, promis à une mort proche, se révoltent et par leur révolte, par la certitude de leur mort, découvrent en eux la dignité humaine. Aujourd’hui, c’est l’ensemble de l’humanité qui se trouve piégée dans le ghetto d’une planète en voie de destruction. « Dans moins de cent ans, l’humain ne sera plus qu’un souvenir. Une poignée survivra. La date de l’humain approche, une obsolescence qu’il a lui-même programmée. » La révolte, quoique inutile, n’est-elle pas, pour nous aussi, une façon de rendre sa dignité à l’homme ? Il est temps de congédier le passé, de trahir Nurith pour mieux servir sa leçon. À notre époque où « la revendication victimaire est devenue un sport international, il est désormais impossible de plonger ses mains dans l’Histoire ». Un monde sans passé ni futur : n’est-ce pas l’affirmation péremptoire du présent ?
Le propos du roman va donc bien au-delà de l’anecdote, de la violence et de la sexualité qui peuvent sembler provocatrices, mais qui se révèlent libératrices. C’est la même violence qui passe dans l’écriture de Véronique Bergen, qui s’affermit de livre en livre. Elle passe bien sûr par l’accumulation de mots très forts, catapulter, happer, déchirer… Elle passe toujours par l’extraordinaire liberté morphologique qui transgresse effrontément les catégories grammaticales par des télescopages vigoureux et suggestifs. Les substantifs partent comme des uppercuts, détrônent les verbes (« je méli-mélo dans le drame », on se « pili-pili l’humeur », les « raisins me pétalent »), les adverbes (« elle musèle double scotch les mots », « il ritualise samouraï »), les épithètes (« tes yeux menthe-à-l’eau, ton sourire grenadine ») comme les attributs (« Je glisse cocon des cordes »). Leur cascade étourdissante dessine soudain des patchworks intraduisibles mais dont le sens est évident : « Je rutabaga superstition et télépathie féline »… Ne cherchons plus à attribuer une fonction grammaticale aux substantifs qui se déversent par mitraille : « Je m’apostrophe insultes de mélusiner hantise de la répétition du pire, de vaciller mauvais augures de la Saint-Barthélemy de l’amour ». Laissons-nous emporter par cette langue vivante, incroyablement expressive, qui semble jaillie d’un volcan mais qui, à l’examen, se révèle minutieusement ciselée. Sous le regard acéré de Véronique Bergen, les mots prennent sens, au-delà de leur signification, y compris les noms propres que l’on pouvait croire arbitraires. Qui a remarqué que Varsovie appelle la vie par son nom français et la guerre par son nom anglais, Warsaw ?
Mais cela va bien plus loin. La langue s’incarne, devient décor, voire personnage du roman : « Je voltige dans un désert de phrases ocre », « la phrase étend son ombre sur moi », les paroles se tissent comme « des tapis kilim bourrés de balles », les oxymores griffent la rétine… Les lettres s’inscrivent dans la peau de la narratrice, comme cette cicatrice en forme de O qu’elle arbore entre les seins. Le texte tout entier devient un appel à l’amie repartie, et peut-être même un piège qui se referme sur elle : « Dans l’écheveau textuel que je tisse pour toi, je creuse des pages blanches afin que tu t’y allonges et les saupoudres de tes mots ou de tes non-mots. » Rendez-vous à la dernière page pour voir si le piège a fonctionné.
Retour au sommaire
Voir aussi : Écume. Icône H. Moctezuma. Le collectionneur.
Perrine Simon-Nahum, Sagesse du politique, L’Observatoire, 2023.

« Comment les démocraties peuvent-elles redevenir désirables ? » La question est particulièrement pertinente à une époque où un peu partout dans le monde, les électeurs (base même d’une démocratie) tendent à privilégier des régimes fort, comme si eux seuls pouvaient répondre aux crises sanitaires, écologiques, démographiques, guerrières qui se multiplient. Il ne s’agit pas d’une impression subjective : les indicateurs mis au point par Freedhom House, organisme chargé d’étudier l’état de la démocratie dans le monde, confirment ce recul, ainsi que des sondages surprenants (16 % des Français sondés en 2021 se disent éloignés de la démocratie).
Perrine Simon-Nahum, professeur à l’ENS, s’est penchée sur la question, d’abord de façon historique, en étudiant les trois âges de la démocratie, puis de façon philosophique, isolant la question sans doute essentielle : comment concilier les deux fondements de la démocratie, l’ordre collectif et l’épanouissement individuel ? La cause philosophique du mal lui semble la montée d’un ressentiment polymorphe mais systématique, qui s’auto-entretient et s’accentue rapidement. Mais aussi le dévoiement de l’idée européenne, qui aurait dû être un recours et un garant de nos libertés, mais qui s’est vue instrumentalisée par les gouvernements pour détourner sur elle la colère de l’opinion face à des mesures impopulaires. L’Europe occidentale porte dès lors une lourde responsabilité dans la faillite de l’idéal démocratique, qui cesse d’être un « horizon régulateur » pour se réduire à un « égalitarisme des conditions » impossible à atteindre, donc toujours décevant.
Ce ressentiment est accentué par les réseaux sociaux et par la tendance générale de l’époque à la simplification et au complotisme. Or, le ressentiment instaure un climat délétère qui a toujours été favorable au populisme et, à sa suite, à l’autoritarisme. Il convient d’en observer les signes avant-coureurs avant qu’il ne soit trop tard pour inverser la tendance. Le principal est l’importance accordée aux émotions collectives qui se focalisent contre un ennemi commun, au détriment du dialogue et de la faculté de juger, qu’il faut sanctuariser.
Pour trouver une solution, Perrine Simon-Nahum propose de suivre les conseils jadis donnés par Raymond Aron et Michel Foucault d’étudier un régime en fonction des contraintes dont il témoigne et des réponses qu’il y apporte, et non en le rapportant aux grands principes dont il se réclame. Cette « conversion du regard » permettrait de transformer la faiblesse des démocraties (l’impossibilité à faire respecter leurs principes) en force (la réponse donnée aux problèmes rencontrés). Il faut éviter de donner à la démocratie des « habits trop grands », des buts trop ambitieux qui conduiront à des déceptions.
En particulier, il convient de la limiter à sa définition de régime politique sans croire qu’elle puisse « s’identifier aux conditions de bien-être qui ont accompagné la croissance économique ». Le mirage d’un État providence aux mesures sociales généreuses, né dans l’après-guerre, a « laissé en suspens la question de l’exercice du pouvoir ». Cela pouvait fonctionner en période de croissance, mais les revendications sont restées les mêmes lorsque celle-ci s’est ralentie. La démocratie a alors cessé, aux yeux des citoyens, de s’identifier à l’égalité et a semblé liée au capitalisme. Cette tendance a été particulièrement visible lors de la réunification de l’Allemagne, qui s’est fait au nom de l’économie (égalité des revenus entre les deux Allemagne) en sacrifiant la dimension politique. La réponse à la crise des subprimes en 2008 est allée dans le même sens. Il en est sorti un « néolibéralisme » qui stigmatisait les plus pauvres, inadaptés au monde de la concurrence, et non l’avidité des plus riches. La fin de l’État providence qui s’en est suivie a augmenté le ressentiment.
Retour au sommaire
Louise L. Lambrichs, Sur le fil, envolées, dessins Granjabiel, Douro, 2024.

Le trait unit et sépare
Divise et souligne
Oriente et touche au vif
Invite et interroge
S’inscrit et s’élance
Déchire et rassemble
Poèmes et dessins, dans ce recueil, semblent posés « sur le fil », sombrant d’un côté, s’envolant de l’autre… Dans les dessins de Granjabiel (qui avait déjà illustré Bris et collages de Louise L. Lambrichs), le fil traverse horizontalement la page, comme un axe entre le noir et le blanc, l’insouciance et la menace, l’envol et la torpeur. C’est le moment où les personnages, hommes ou animaux, s’inversent ou se transmuent. À cet axe horizontal répond, sur la page de droite, l’axe vertical du poème, dont les vers sont centrés comme si un miroir invisible se dressait au milieu de la page.
Côté noir, l’abîme où l’on sombre irrémédiablement, l’abandon à un sommeil sans rêve, à une vie sans idéal, à un confort aveugle aux désastres du monde. Le « monde cannibale », violent ou mercantile. Le poème se fait dur, révolté, devant la barbarie et, surtout, devant l’aveuglement. « Bâtissez encore des cathédrales sur des charniers ». Dans les dessins, les profondeurs sont souvent menaçantes, dépassant à peine le fil, comme des icebergs, ou l’aileron du requin. L’oiseau qui ouvre le bec devant la toute petite tête émergeant de la terre n’imagine pas le monstrueux serpent qui la prolonge…
Côté blanc, tout « ce qui compte et ne se chiffre pas », la « petite lumière » que l’on cherche au fond de soi, du silence, des mots. Car entre les deux, le fil est peut-être celui de la langue. Le monde se dit, s’écrit, bruyamment ou en silence. La parole aussi a ses deux versants. D’un côté, les bavardages bruyants, le « grand brouhaha », les « voix absentes » des beaux parleurs, la « parole lisse / enflée de déjà vu d’inconsistance ». Mais en face, il y a ceux qui écoutent, muets, « les endettés de l’âme ». C’est là que s’opèrent les vrais miracles, dans le silence, « en douce et en coulisses / Au creux des âmes encorbellées ». Ce qui ne nous empêche pas d’écouter aussi « la langue puissante des poètes ancrée dans le vulnérable / les failles de l’être par où surgissent / inattendues / d’insolentes lucioles »…
L’abîme devient alors ce que l’on doit explorer pour en faire jaillir de nouveaux espoirs, une langue purifiée et régénératrice : « Ma pensée s’est tissée en secret dans les creux / Les failles à claire-voie / Les silences bavards / Comme la mer sculpte la roche ». Il ne faut pas craindre d’affronter les monstres souterrains ou sous-marins, il faut toucher le fond de ce « grand sac de larmes » dans lequel on baigne comme dans une mer intérieure. Le désespoir alors se retourne comme un gant, grâce à un regard doux, un sourire clair, une voix tendre.
Pour celui qui sait creuser, piocher, fouiller, forer, dans le monde comme en lui-même, dans le silence, dans la lecture, les abîmes contiennent aussi des pépites. Ce recueil, qui nous invite à « tenir sur le fil sans désemparer », laisse à l’espoir le verso de la révolte. Il écoute les mots pétiller et se répondre : « Ils explosent chacun fourmille de sens qu’il trimballe en tous sens / Caracolant brinquebalant parmi les autres ils s’aiment et s’emboîtent / Se frottent et se repoussent ». Tel est le secret du poète « heureux de son désespoir », et qui sait partager son bonheur avec son lecteur…
Retour au sommaire
Voir aussi : Quelques lettres d’elle, Les amants de V., Malpensa. Bris et collages.
Mathias Lair, Aucune histoire, jamais, Sans Escale, 2021.

« Toute histoire est mensonge dès qu’elle se referme sur elle-même, le réel qu’elle suppose est reconstruit de toutes pièces ou presque. La vraisemblance suffit. » C’est contre ce principe que s’élève le narrateur du récit cadre, un auteur qui tâche de convaincre un interlocuteur rebelle. Le roman se construit donc à deux niveaux : l’histoire qu’il tente de raconter, en caractères italiques, et les conversations, en caractères romains, qu’elle suscite entre son auteur et un « Vieux » perpétuellement insatisfait du résultat.
Pour faire simple, les récits intermédiaires évoquent, en italiques, la conception d’un embryon bavard, durant la dernière guerre, son combat contre une faiseuse d’anges, la rencontre de ses parents, dans des passages tour à tour mystiques, poétiques, tragiques, drôles, et parfois tout cela ensemble. Et d’autres histoires, au fur et à mesure des réflexions des deux personnages qui s’expriment plutôt en romains. Le Vieux a une conception claire et figée de l’histoire, qui doit observer quatre principes, respecter les convenances. Il veille à « l’efficacité narrative ». L’auteur se rebelle contre cette vision étriquée – « Je ne suis quand même pas obligé de sacrifier à la mode de l’autofiction ! » mais il tente malgré tout de satisfaire son interlocuteur, reprend son récit, change d’approche ou de sujet. Il tient à distinguer l’auteur, le narrateur, les personnages. Mais si les personnages mettent à leur tour en place des personnages, deviennent-ils auteurs ou narrateurs ? C’est un jeu de poupées russes, ou de miroirs placés face à face. Une analyse sérieuse, mais entreprise avec un humour efficace.
Les différents récits perdent peu à peu de leur importance, et les réflexions de l’auteur passent eux-mêmes au second plan face à la question qui peu à peu titille le lecteur : qui est le Vieux ? On pense d’abord à un éditeur, bien sûr, mais il n’a pas le projet de publier le texte. Un conseiller littéraire ? Un psychanalyste ? Un universitaire, comble de l’infamie (« Il est de cette tribu qui colonise et infeste les lieux de la narration ») ? Un lecteur exigeant, espèce de Moloch dévoreur d’histoires ? Ou à l’inverse l’écho, en tout écrivain, de toute la littérature antérieure, « celui de milliers de parleurs aujourd’hui disparus, de bâtisseurs d’histoires » ?
Une piste semble bientôt se dégager : et s’il s’agissait purement et simplement de Dieu ? Quand on lui demande qui il est, le Vieux répond « qu’il était ce qu’il était », comme Yahvé — sauf qu’il le fait dans un souffle inaudible (« C’est du moins ce que j’ai cru comprendre »). Les appels du pied se multiplient. Le Vieux se croit omnipotent, tiens ; il est puissant et inaccessible, tiens tiens ; n’est pas du même monde que l’auteur, tiens tiens tiens… « Pour un peu il se prendrait pour un être éternel, vous voyez ce que je veux dire. » On voit très bien (car le « vous » introduit subrepticement un autre niveau narratif, celui du lecteur). Tout nous pousse vers cette interprétation : l’âme en quête d’absolu (« quelle est cette présence dont je n’arrive pas à me passer ? ») préfère se donner un Dieu pour interlocuteur pour exorciser une voix intérieure (« Mieux vaut encore lui parler et la sentir venir de l’extérieur »). Mais celui-ci est étouffé par la tradition et incapable de comprendre le monde moderne (« Passé le XVIIIème, il n’y a plus rien pour lui »), ce qui agace prodigieusement l’auteur narrateur.
Le dialogue, conflictuel, qui tourne au match de boxe, devient alors le vrai sujet du roman. Il s’agit non seulement de faire éclater les règles usuelles de la narratologie, mais aussi toute notion de vérité (« Toute vérité dépend d’un présupposé purement gratuit »). Le Vieux prend coup sur coup, répond, argumente, prend l’auteur à son propre piège (« En clamant que je ne mange pas de ce pain-là, est-ce que je ne fais qu’avaler de misérables hosties ? ») Étrange dialogue entre un homme faisant profession d’athéisme, qui s’interroge sur l’existence du Vieux, qui a même, dans d’autres livres, « décrit sa disparition »… et une figure tutélaire et insaisissable qui a toutes les apparences du divin, même si l’hypothèse est écartée. Si le récit en italiques parle de la conception et la naissance de l’auteur, le récit cadre, en romains, pourrait bien nous décrire l’émergence de la notion de Dieu dans une conscience travaillée par son absence…
Car oui, il y a une incontestable dimension mystique dans la conception racontée par le fœtus friand d’italiques. On croit parfois lire du maître Eckhart : « Car il s’agit, oui, d’un déchirement ; d’une blessure par où s’écoula mon néant, par où je pris densité. » La naissance est un passage du sujet absolu « à un état de larve prise dans mille pincements et petits plaisirs vite pris vite épuisés. » Derrière l’ironie, on perçoit comme une plainte de l’esprit éthéré pris au piège de la matière… « Qu’est-ce que cette mystique ? » grogne le Vieux.
Pour se débarrasser de cet interlocuteur encombrant, l’auteur ose même une parodie de la Genèse, enfermant le Vieux dans l’histoire qu’il raconte, pour pouvoir l’achever – « Il faut pourtant qu’il s’identifie à mon personnage, qu’il en sente le déclin irréversible, et la disparition ». Ainsi le Vieux passe-t-il des romains à l’italiques, où l’on menace de le tuer… Ce saut narratif, qui évoque ce que Genette nommait métalepse, un franchissement du seuil narratif qui sépare deux univers irréductibles, est un des points culminants de ce singulier roman sans histoire, mais non sans sujet. Car si, en fin de compte, une des identités du Vieux peut être le lecteur, n’est-ce pas moi, à mon tour, qui suis invité à disparaître ? Allons, il est peut-être temps de le faire...
Retour au sommaire
Voir aussi : Oublis d'ébloui, Aïeux de misère, Ainsi soit je. L'amour hors sol.
Annie Dana, Le piège des aveux, préface de Michel Host, Éditions unicité, 2023.

« Je crois à la fiction qui porte des mots, je sais jusqu’où elle peut conduire ceux qui les prononcent et ceux qui les écoutent. » Fiction ? Peut-être, peut-être pas… En tout cas, un récit performatif, qui agit sur les personnages et sur le lecteur. Un « piège », nous dit le titre, et le mot s’applique au lecteur aussi bien qu’aux personnages… L’histoire est portée par une triple voix, à laquelle s’ajoutent, par moments, des « portraits » ou des épisodes d’une « passion » à prendre presque au sens biblique du terme. La première voix est celle de Jacques, aumônier d’une prison intrigué par un détenu, Antoine. Une relation qui le remet profondément en question : « Il me semble ne plus rien savoir et devoir réapprendre ce qui hier m’était naturel comme le fait d’être au monde. » Ce sont les pages de son journal que lit le lecteur.
La deuxième voix est celle d’Antoine, donc, mais nous ne connaîtrons pas ses conversations avec Jacques. Il écrit à une femme, une certaine Constance, qu’il ne connaît pas, et peut-être ces lettres ne sont-elles pas envoyées : « Personne ne lira ces pages. Il est des mots faits pour être écrits, non pour être lus. » Mais Constance imprègne son existence, tant il en a entendu parler par un ami, Simon, un peintre, amoureux d’elle à la folie. « Pourquoi Simon m’a-t-il choisi ? Pourquoi vous a-t-il décrite à moi, jusqu’à ce que votre image prenne à mes yeux le poids d’une femme plus réelle que les exilées de ma propre vie ? » Et pourquoi Antoine lui écrit-il ? Qu’attend-il d’elle ?
Elle, Constance, la troisième voix, mais qui n’intervient que tardivement, en nous laissant penser qu’il y a peut-être eu un quiproquo. Quant au quatrième acteur, Simon, il ne prend jamais la parole, mais sa présence traverse le roman. C’est là que l’on sent le piège se refermer sur les personnages. Piège des aveux, d’abord. Simon, en effet, ne se contente pas de prendre Antoine pour confident, « il m’invitait à participer à l’aventure de sa vie. » Les rapports entre Antoine et Simon, en effet, apparaissent comme une mise en abîme dans cette confession. Simon, dont Constance n’a pas voulu, se demande Antoine, pourrait-il être l’amant qu’il n’a pas eu ? À moins qu’il ne soit un double, réel ou fictif ? On qu’à demi étonné qu’Antoine, à la fin du roman, se procure gouaches et pinceaux… alors que le peintre c’est Simon ! Piège des aveux…
Mais il y a une autre confession, donc d’autres aveux : celle qui se fait au prêtre, Jacques, dépositaire à son tour d’une histoire empoisonnée. Car le venin des souvenirs s’insinue en lui, avec les mêmes conséquences : les rôles s’inversent à nouveau, cette fois entre l’aumônier et le détenu : « C’est lui qui est venu me voir dans ma prison, note Jacques dans son journal. Celle où je m’impose, année après année, un cortège de mortifications pour combattre mes peurs. » La fin du roman suggère très discrètement l’inversion suprême des rôles : l’aumônier évoque des « crimes », le prisonnier prépare son bagage… Le piège s’est-il refermé sur le prêtre autour de cette double équation, Jacques devient Antoine, qui devient Simon ?
Pas si simple. Apparemment, il y a eu meurtre, ce qui explique l’emprisonnement d’Antoine. Mais on se demande, dans un chapitre clé qu’il ne faut surtout pas dévoiler, s’il n’y a pas eu erreur de victime. Apparemment Antoine fait ses valises. Mais celui qui voyage, c’est Simon, qui, dans un avion, rédige pour Constance « des lettres de solitaire à la solitude ». Apparemment, Jacques, l’aumônier, est en quête de Dieu, de cette illumination qu’il a vécue et d’où procède sa foi. Mais la quête mystique est celle de Simon, dont le coup de foudre tient de l’illumination et qui finit, faute de vivre sa passion avec Constance, par rechercher sur tous les continents des femmes mythiques, peintes ou sculptées, comme si elles pouvaient lui révéler l’Unique, l’Inconnue, la première femme surgie du Chaos. Ici encore, les trois rôles principaux se chevauchent, dans un rapport à la présence ou à l’absence de l’autre. Lorsqu’Antoine se tait, Jacques croit entendre monter « inconcevable pour lui, la voix audible de la présence de Dieu. »
Et si là était la piste ? Dans le silence d’Antoine, dans l’absence de Simon, qui se prépare à « déserter son histoire », dans le retrait de Dieu ? Et si, en fin de compte, Constance n’existait pas ? La question se pose, pour le lecteur comme, à un moment, pour l’aumônier : « Son récit m’encombre. N’a-t-il fait qu’imaginer les fantômes qu’il évoque ? Simon, Constance, ce double de lui-même qui a pour nom Antoine. Que s’est-il passé entre ces trois êtres qui excède la réalité ? » Même doute pour Constance, qui n’a jamais rencontré Simon : celui-ci a-t-il jamais existé pour elle ? L’hypothèse d’une fiction habile séduit un moment, mais d’autres pistes s’ouvrent aussitôt. Un jour, après un enterrement dans lequel il officie, Jacques aperçoit un homme courir sur les pas d’une femme vêtue de gris, « paraissant la pourchasser avec autant de véhémence que de terreur ». Il se demande s’il ne s’agit pas de Simon et de Constance, ce qui témoignerait impartialement de l’existence des deux personnages insaisissables. Le lecteur est prêt à y croire, mais n’est-ce pas à nouveau un piège ? Après tout, Jacques ne connaît pas le couple, comment pourrait-il le reconnaître ?
On remarque alors le curieux mélange des temps et des modes dans le récit : le conditionnel, le présent, le futur. On sourit, on a évité le piège… Mais à peine en a-t-on pris conscience que la romancière l’assume : nous sommes dans un « temps fluctuant, parfois conjugué au futur, parfois au passé révolu ». L’histoire se poursuit « comme un fil de funambule tendu entre passé et avenir. Ou plutôt entre présent et avenir, le passé cloué sur place, étranglé par le nœud coulant d’une corde. » Le piège s’est refermé sur le lecteur, car avouons-le, on ne parvient pas à se détacher d’une intrigue qui file entre les doigts. Qu’importe, après tout, la réalité de l’aventure entre Simon et Constance ? L’important, c’est ce qu’elle va tisser entre les protagonistes. « Peut-être est-ce même l’apprentissage de la mort auquel je m’initie en trouant l’espace invisible entre vous et moi », remarque Antoine à Constance.
Tenace, le lecteur cherche d’autres pistes. Le mélange des temps ne symbolise-t-il pas le figement spatio-temporel de la prison ? L’espace clos semble inexistant — « Ici, on assiste à la mort de l’espace, dans la pénombre nauséeuse des cellules… » Le temps mis entre parenthèse semble arrêté. La nuit, Antoine garde les yeux grands ouverts, « il s’obligeait à s’éveiller pour contempler le temps immobile ». Alors, Constance, l’insaisissable Constance dont le prénom évoque précisément la durée, ne transforme-t-elle pas la vie en un « destin unique », ne devient-elle pas aux yeux de Simon « une femme dont la trace dans sa vie en annulerait à jamais la brièveté » ? Lorsque celui-ci, frappé d’un coup de foudre, se retrouve paralysé par la « fatalité » de la rencontre, ne revit-il pas la scène inaugurale de l’illumination ?
C’est en tout cas la piste que j’ai suivie pour sortir du piège de la lecture. Je ne garantis pas que ce soit la seule, ni la meilleure. Des trois hommes qui apparaissent dans le récit, deux ont vécu cette scène inaugurale, le peintre Simon, par le coup de foudre, et Jacques l’aumônier, par l’expérience mystique. Les deux portent un nom d’apôtre, puisqu’après tout, on nous invite à suivre une passion… Antoine, de son côté, n’est qu’un égaré de la vie, aux limites de l’inexistence. « Nul ne l’attend, ne le retient, ne l’appelle. Nulle part est le lieu d’où ont surgi Simon et Constance, où ils sont retournés. » Antoine appartient à ces passants qui, dans la rue, « n’ont aucune raison de marcher, sinon de maintenir en eux le sentiment fragile d’exister ». Citadin de fraîche date, « exilé provincial », il reste entre deux eaux, entre deux identités, incapable de se reconnaître lui-même — un jour, en se regardant dans la vitrine d’un magasin de farce et attrapes, il se trouve difforme et velu ; le suivant, imberbe et élégant dans celle d’un maroquinier. Comme un bernard-l’hermite, il se glisse dans la peau des personnages définis par les annonces d’emploi. Il simule devant les amis du club qu’il fréquente. Il incarne le monde muable, labile, qui s’oppose à celui de la constance, de Constance, de la prison, du destin intérieur. Et si c’était lui qui piégeait les deux autres, et du même coup le lecteur ? Réelle ou inventée, l’histoire de Simon lui donne enfin une existence, un destin. « De ma vie propre, je me souviens à peine. Comme si je n’avais pas existé, mon corps habillant une forme vide. » À l’inverse de tous ceux qui se montrent « curieux de vivre », il éprouve très tôt le besoin de s’en abstenir. « Ayant renoncé à faire une œuvre de ma vie, je résolus de m’immiscer dans celle des autres, érigeant ma liberté sur les décombres des histoires dont j’étais spectateur. »
Le roman tout entier est centré sur ces dépossessions successives. Entre Simon qui déserte sa vie, Antoine qui investit celle des autres, Jacques qui s’enferme dans sa prison intérieure, se joue une partie serrée, dont l’enjeu est la vie, la liberté, la mort. « Un jour certains rencontrent cet exil. Et c’est une vraie rencontre, un temps d’épousailles. Alors, on entre en exil dans sa propre peau. » Le livre lui-même disparaît dans cet enjeu, les mots perdent leur signification pour trouver un sens supérieur. « Ce seront des questions issues d’une langue jamais enseignée, une langue de suggestion, d’approche, à laquelle il donnera vie le temps d’être entendu, même si Constance ne l’a pas entendue ni comprise, si personne d’autre de la parle. » Une langue quasi divine, puisque tout est à recréer. « Si elle disait “Oiseau”, entre eux voletterait un oiseau, et ainsi de tout ce qui existe et n’existe pas, ainsi de toute chose créée et incréée. »
Cette dimension mystique s’affirme de plus en plus au cours du roman. Simon fuit la réalité pour découvrir, au-delà du monde, un pays ignoré des atlas où « ce qui n’a pas eu lieu peut enfin survenir », le lieu de l’éternité. Avec néanmoins l’inéluctable doute qui prend le lecteur comme les personnages : n’ont-ils pas en fin de compte sombré dans la folie ? Une chambre où le sommeil s’avale sous forme de pilules nous fait parfois penser à un hôpital psychiatrique, mais prudence : la phrase est rédigée au futur. Peut-être s’agit-il de la nôtre… Alors acceptons notre propre dépossession devant ce labyrinthe magistral où s’égarer devient un délice. « Il y a mille moyens de chercher à se perdre et à se trouver en se prétendant quelqu’un qu’on n’est pas, les acteurs le savent bien, qui pratiquent chaque jour l’art de l’illusion. »
Retour au sommaire
François Henry, N’oubliez pas Marcelle, Rocher, 2023.

Marcelle « fait partie de ces gens semblant n’exister, dans la mémoire des autres, que par leur dévouement ». Parler d’elle, c’est « mal user sa salive », alors, écrire son histoire ? Comment évoquer le destin de quelqu’un qui s’est engagé « sur le chemin de la non visibilité / de la transparence voulue et décidée par d’autres qui n’en ont même pas conscience, sans doute » ? Habile à débusquer les mille nuances d’une âme, même, et surtout évanescente (on se souvient de Loïc, dans Loin du soleil, ou des nouvelles de Jamais le droit de crier), Françoise Henry relève le défi. Ces destins si ténus qu’on les croirait anonymes la fascinent, on n’a pas le droit d’oublier Marcelle ni ses millions de semblables, cousine Bette de Balzac, tante Séraphie de Stendhal, vieilles filles sacrifiées à la carrière d’un frère, au soutien d’un père, à la bonne marche de la maison.
Marcelle Jallard a vécu au bord de la Loire, dans une ville dont le pont canal et les quatre rivières qui la baignent évoquent Digoin. Elle est née entre deux guerres, aînée, et fille, double disgrâce. Ce n’est pas d’elle qu’on s’occupe, « on n’a jamais eu peur de la perdre ». Et le corps, à l’époque, on n’y prête guère attention, par pudeur, imprégnation chrétienne, indifférence. Alors la malformation de la hanche, l’opération à deux ans, l’accident d’autocar, le cancer du sein, le grain de beauté malin, est-ce que cela compte ? Mais sait-on jamais si le corps ne s’exprime pas par ses blessures ? « Tu ne m’as jamais fait jouir, jamais fait exister sous les caresses, alors voilà, moi j’existe quand même ».
Marcelle ne poursuit pas ses études, pour pouvoir travailler à la maison, devient « maîtresse de maison » après la paralysie de son père. Marcelle s’échappe un moment, mais avec un sentiment de culpabilité, assiste un cousin magnétiseur qui la fascine et qui la manipule, revient à la maison. Les hommes, qu’elle érige en demi-dieux, savent profiter d’elle. Sauf celui qu’elle aime, qui l’aime peut-être, aussi, mais dont le père serait un collaborateur. Il faut l’oublier.
Car Marcelle est traversée par l’histoire, la grande, si la sienne reste désespérément étriquée. Le pétainisme conventionnel des parents. Le frère résistant, déporté, jamais revenu de Buchenwald (comme Jacques, dans Plusieurs mois d’avril). La frontière entre zone libre et zone occupée. Mais le père ressort de la guerre essoré, la mère rincée, le frère survivant « pris d’un besoin urgent de s’extirper du moule » et Marcelle, « lestée d’un interdit à vie : tais-toi, tais-toi… »
Alors il reste les rêves. Marcelle rêve. Toute seule dans la nuit, son lit devient une barque — et la phrase se met à sinuer sur la page. Il faut dire que la présence de l’eau, du fleuve, des quatre rivières, est souveraine dans le roman et dans la perception de la vie. « Une vie que n’entaille aucun fleuve ne sera jamais aussi vivante aussi bruissante aussi transparente qu’une ville traversée par de l’eau ». Et lorsqu’à la mort de Marcelle, on retrouve ses carnets (motif également présent dans Plusieurs mois d’avril), on se rend compte qu’ils n’évoquent que les moments de douceur, de calme, de simple bonheur aux côtés du fleuve. « On se dit alors que, peut-être, on a tout faux / on n’aurait pas assez pris en compte / cette douceur / ce sourire ? » Peut-être. C’est si fragile, une vie sacrifiée, si ténue, une voix habituée à taire l’essentiel. Mais ce qui a été écrit, n’est-ce pas justement cela, l’essentiel ? « Nous prenions le bateau, descendions le fleuve, toujours ce calme, c’était beau ».
Pour évoquer ce personnage à la fois fort et évanescent, il fallait une langue neuve, assez souple pour épouser tous les contours d’une personnalité contradictoire. Une langue qui s’écoule comme le fleuve : il n’y a qu’un seul point, dans le livre, le point final, car « on peut même raconter [cette vie] sans mettre de point car dans une vie il n’y a jamais de point si ce n’est le final quand il n’y a plus rien à dire ». La phrase prend le rythme de la page, flotte entre les blancs et les retours à la ligne, comme ballotée par le flot. Elle nous adresse parfois un clin d’œil par un émoji :-) ou par l’écriture inclusive (lesquel-le-s). Des clins d’œil vite passés et jamais répétés, comme le paysage qui borde le fleuve. Légère, tenace, surprenante, Marcelle. Alors, non, on ne l’oubliera pas.
Voir aussi : Le drapeau de Picasso, Plusieurs mois d'avril, Sans garde-fou, Juste avant l'hiver. Jamais le droit de crier. Loin du soleil.
Retour au sommaire