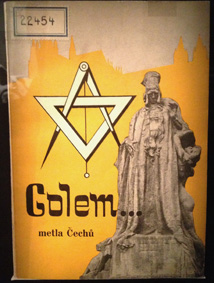Georges d’Amboise (1460-1510) était issu d’une famille de petite
noblesse qui savait placer ses cadets dans le haut clergé : sur les
huit frères, six furent prélats. Georges fut sans conteste le mieux
pourvu, et devint un des hommes les plus influents du royaume. Aumônier
du roi, légat apostolique, il échoue de peu à l’élection pontificale de
1503. Chef de guerre dans la campagne d’Italie lancée par Louis XII, il
obtient la reddition du royaume des Deux Siciles et participe largement
à l’introduction de la Renaissance italienne en France. C’est dans ce
contexte qu’il exerce une importante action de mécénat. Ses prétentions
pontificales le poussent à se doter d’une résidence à la mode — il
restaure le château de Gaillon en faisant appel à des peintres et des
sculpteurs italiens — et d’une bibliothèque digne d’un monarque.
Lieutenant et gouverneur de Normandie, archevêque de Rouen, il est
secondé dans ses fonctions par Raoul du Fou, évêque d’Évreux, qui
partage ses passions et ses ambitions : il fait pour sa part rebâtir le
palais épiscopal d’Évreux et collectionne lui aussi les manuscrits. Il
était tout à fait normal de leur consacrer une exposition au musée
installé dans l’ancien palais épiscopal.
Celle-ci commence par évoquer les deux personnages et leur époque : portrait, sceau, médailles du cardinal d’Amboise, évocation du château de Gaillon, de son mécénat, des commandes aux artistes italiens (merveilleuse tête de Jean Baptiste par Andrea Solario)… Mais la majeure partie de l’exposition est consacrée à la bibliothèque du cardinal, en (petite) partie reconstituée à partir des manuscrits conservés (surtout) à la Bibliothèque nationale, mais aussi à Londres, Rome, Berlin, La Haye, Leyde, Cambridge, Grenoble, Louviers… Ces livres qui n’avaient plus été réunis depuis un demi millénaire rayonnent soudain d’une splendeur oubliée. Dès la mort du cardinal, en effet, ils sont répartis entre son petit-neveu, l’évêché d’Albi et le château de Gaillon ; ils ne tardent pas à être rachetés par des collectionneurs et dispersés dans toute l’Europe. Fort heureusement, parfois : ceux qui étaient restés à Gaillon, par exemple, ont été reliés à neuf en 1593-1594, et la prodigieuse collection de reliures à l’italienne du cardinal a été préservée par des collectionneurs privés qui en avaient déjà acheté certains !
Le fonds de sa collection est constitué par l’achat, en 1502-1504, de manuscrits appartenant au roi d’Aragon, destitué du royaume de Naples. Une petite partie : 138 manuscrits entrent dans la collection d’Amboise sur les 2000 livres qui faisaient de la collection napolitaine la bibliothèque la plus importante d’Europe. Les rois d’Aragon l’avaient constituée à partir de 1435 pour attirer à leur cour les érudits et humanistes capables d’en vanter la splendeur. Lorsque Frédéric d’Aragon, vaincu par les Français, s’exile en France, la « nécessiteuse et très malheureuse reine », sa femme, négocie la vente des plus précieux manuscrits. Fort heureusement, ici encore : les trésors de la cour aragonaise, livres, tapisseries et tableaux, sont partis en fumée en 1504 dans l’incendie du palais où le roi s’était réfugié. À ce fonds primitif s’ajoutent des cadeaux et des achats effectués à Milan, à Florence, à Rome, puis des commandes à des artistes français qui doivent compléter les achats italiens — il y manque, bien évidemment, des livres liturgiques adaptés aux offices français, ainsi que les grands chroniqueurs français, Froissart, Monstrelet, Mansel…
À Gaillon, le cardinal fait aménager pour recevoir ses livres un studiolo ouvragé en or, « avec des joyaux bon marché, mais d’un très bel effet »… On est tout d’abord ébloui par le luxe de ces manuscrits italiens. Le plus beau, le plus fin, venu tout droit de la bibliothèque vaticane, est sans doute le bréviaire romain enluminé à Florence par Attavante degli Attavanti, le plus célèbre des enlumineurs de l’époque, sur commande de Mathias Corbin, roi de Hongrie. Le roi étant mort avant que l’ouvrage soit achevé, le cardinal peut y faire apposer ses armes, et l’acheter. Pour les manuscrits aragonais, ce ne sera pas même nécessaire : par un étrange hasard, les armes d’Aragon sont identiques à celles du cardinal (palées d’or et de gueules).
Le plus émouvant ? Pour moi, des lettres d’Enea Silvio Piccolomini, humaniste, poète et romancier converti et devenu le pape Pie II. C’est alors qu’il a fait recopier ses lettres de jeunesse dans ce manuscrit où il est représenté les écrivant en grande tenue pontificale ! Le plus surprenant ? Des heures à l’usage romain écrites sur des pages entièrement recouvertes d’une feuille d’or, seul exemple connu de ce procédé. Mais l’ensemble des collections italiennes est remarquable, avec des décors à l’antique innovants (portraits en médaillons, pilastres, candélabres, monstres, pierres précieuses…), une finesse exceptionnelle dans les rinceaux réticulés, et une technique inédite des bianchi girari, des rinceaux réservés en blanc sur champ coloré. Le plus surprenant, c’est que les commandes françaises passées à son retour par le cardinal s’inspirent de la mode italienne dans leur écriture comme dans les enluminures. On touche alors du doigt le passage de témoin de la Renaissance. L’écriture humaniste, la littera antiqua renovata que l’on croyait romaine alors qu’elle vient tout droit de la minuscule caroline, est adoptée par les scribes français à la place de la gothique. C’est toujours cette écriture ronde que nous utilisons aujourd’hui. Il est curieux de voir que les œuvres médiévales (en particulier Thomas d’Aquin) sont encore écrites en gothiques majestueuses et confuses, et que les chroniqueurs français ont droit aux gothiques cursives, élégantes et devenues illisibles. Un véritable code graphique se met alors en place. On touche aussi du doigt le travail des enlumineurs : les manuscrits sont copiés à Rouen, envoyés à Paris dans la boutique de Jean Pichore, le plus célèbre enlumineur de son époque, et bien souvent achevés à Rouen par le plus maladroit Robert Boyvin, l’atelier de Pichore étant débordé de commandes ! Des comparaisons avec les livres de la collection italienne montrent alors comment les miniaturistes français s’inspirent des figures Renaissance. Comble d’ironie : le catalogue de ces livres novateurs est rédigé, en 1508, en cursive gothique !
Excellente idée, enfin, d’avoir réservé une place non négligeable à la reliure. La collection du cardinal d’Amboise a en effet introduit en France une pratique jusque-là inconnue, celle du maroquin (cuir de chèvre du Maroc) doré à chaud, quand la France reliait par des planches recouvertes de tissu ou du cuir estampé à froid. Cet art, issu du monde islamique (Perse, Levant, Afrique du Nord) s’est depuis imposé dans toute l’Europe.
¶ Insolite : Le mois de décembre (cuissons de pains ?) dans un bréviaire romain entièrement écrit et illustré sur feuilles d’or. Seul exemple connu de ce procédé spectaculaire… Le manuscrit s’est retrouvé dans la collection d’Henri IV, qui a fait apposer ses armes sur la couverture.
Celle-ci commence par évoquer les deux personnages et leur époque : portrait, sceau, médailles du cardinal d’Amboise, évocation du château de Gaillon, de son mécénat, des commandes aux artistes italiens (merveilleuse tête de Jean Baptiste par Andrea Solario)… Mais la majeure partie de l’exposition est consacrée à la bibliothèque du cardinal, en (petite) partie reconstituée à partir des manuscrits conservés (surtout) à la Bibliothèque nationale, mais aussi à Londres, Rome, Berlin, La Haye, Leyde, Cambridge, Grenoble, Louviers… Ces livres qui n’avaient plus été réunis depuis un demi millénaire rayonnent soudain d’une splendeur oubliée. Dès la mort du cardinal, en effet, ils sont répartis entre son petit-neveu, l’évêché d’Albi et le château de Gaillon ; ils ne tardent pas à être rachetés par des collectionneurs et dispersés dans toute l’Europe. Fort heureusement, parfois : ceux qui étaient restés à Gaillon, par exemple, ont été reliés à neuf en 1593-1594, et la prodigieuse collection de reliures à l’italienne du cardinal a été préservée par des collectionneurs privés qui en avaient déjà acheté certains !
Le fonds de sa collection est constitué par l’achat, en 1502-1504, de manuscrits appartenant au roi d’Aragon, destitué du royaume de Naples. Une petite partie : 138 manuscrits entrent dans la collection d’Amboise sur les 2000 livres qui faisaient de la collection napolitaine la bibliothèque la plus importante d’Europe. Les rois d’Aragon l’avaient constituée à partir de 1435 pour attirer à leur cour les érudits et humanistes capables d’en vanter la splendeur. Lorsque Frédéric d’Aragon, vaincu par les Français, s’exile en France, la « nécessiteuse et très malheureuse reine », sa femme, négocie la vente des plus précieux manuscrits. Fort heureusement, ici encore : les trésors de la cour aragonaise, livres, tapisseries et tableaux, sont partis en fumée en 1504 dans l’incendie du palais où le roi s’était réfugié. À ce fonds primitif s’ajoutent des cadeaux et des achats effectués à Milan, à Florence, à Rome, puis des commandes à des artistes français qui doivent compléter les achats italiens — il y manque, bien évidemment, des livres liturgiques adaptés aux offices français, ainsi que les grands chroniqueurs français, Froissart, Monstrelet, Mansel…
À Gaillon, le cardinal fait aménager pour recevoir ses livres un studiolo ouvragé en or, « avec des joyaux bon marché, mais d’un très bel effet »… On est tout d’abord ébloui par le luxe de ces manuscrits italiens. Le plus beau, le plus fin, venu tout droit de la bibliothèque vaticane, est sans doute le bréviaire romain enluminé à Florence par Attavante degli Attavanti, le plus célèbre des enlumineurs de l’époque, sur commande de Mathias Corbin, roi de Hongrie. Le roi étant mort avant que l’ouvrage soit achevé, le cardinal peut y faire apposer ses armes, et l’acheter. Pour les manuscrits aragonais, ce ne sera pas même nécessaire : par un étrange hasard, les armes d’Aragon sont identiques à celles du cardinal (palées d’or et de gueules).
Le plus émouvant ? Pour moi, des lettres d’Enea Silvio Piccolomini, humaniste, poète et romancier converti et devenu le pape Pie II. C’est alors qu’il a fait recopier ses lettres de jeunesse dans ce manuscrit où il est représenté les écrivant en grande tenue pontificale ! Le plus surprenant ? Des heures à l’usage romain écrites sur des pages entièrement recouvertes d’une feuille d’or, seul exemple connu de ce procédé. Mais l’ensemble des collections italiennes est remarquable, avec des décors à l’antique innovants (portraits en médaillons, pilastres, candélabres, monstres, pierres précieuses…), une finesse exceptionnelle dans les rinceaux réticulés, et une technique inédite des bianchi girari, des rinceaux réservés en blanc sur champ coloré. Le plus surprenant, c’est que les commandes françaises passées à son retour par le cardinal s’inspirent de la mode italienne dans leur écriture comme dans les enluminures. On touche alors du doigt le passage de témoin de la Renaissance. L’écriture humaniste, la littera antiqua renovata que l’on croyait romaine alors qu’elle vient tout droit de la minuscule caroline, est adoptée par les scribes français à la place de la gothique. C’est toujours cette écriture ronde que nous utilisons aujourd’hui. Il est curieux de voir que les œuvres médiévales (en particulier Thomas d’Aquin) sont encore écrites en gothiques majestueuses et confuses, et que les chroniqueurs français ont droit aux gothiques cursives, élégantes et devenues illisibles. Un véritable code graphique se met alors en place. On touche aussi du doigt le travail des enlumineurs : les manuscrits sont copiés à Rouen, envoyés à Paris dans la boutique de Jean Pichore, le plus célèbre enlumineur de son époque, et bien souvent achevés à Rouen par le plus maladroit Robert Boyvin, l’atelier de Pichore étant débordé de commandes ! Des comparaisons avec les livres de la collection italienne montrent alors comment les miniaturistes français s’inspirent des figures Renaissance. Comble d’ironie : le catalogue de ces livres novateurs est rédigé, en 1508, en cursive gothique !
Excellente idée, enfin, d’avoir réservé une place non négligeable à la reliure. La collection du cardinal d’Amboise a en effet introduit en France une pratique jusque-là inconnue, celle du maroquin (cuir de chèvre du Maroc) doré à chaud, quand la France reliait par des planches recouvertes de tissu ou du cuir estampé à froid. Cet art, issu du monde islamique (Perse, Levant, Afrique du Nord) s’est depuis imposé dans toute l’Europe.
¶ Insolite : Le mois de décembre (cuissons de pains ?) dans un bréviaire romain entièrement écrit et illustré sur feuilles d’or. Seul exemple connu de ce procédé spectaculaire… Le manuscrit s’est retrouvé dans la collection d’Henri IV, qui a fait apposer ses armes sur la couverture.
Musée d’Art, Histoire et Archéologie (Évreux) du 8 juillet au 22 octobre 2017